TEXTE COMPLET (18 CHAPITRES)
Edition Michel Delord et Spinoza1670 à partir de l'exemplaire de Gallica/BNF.
L'ouvrage de Pauline Kergomard, L'éducation maternelle dans l'école, paru en 1886, a contribué à installer définitivement en France l'idée d'école maternelle.
I- Education
Edition Michel Delord et Spinoza1670 à partir de l'exemplaire de Gallica/BNF.
L'ouvrage de Pauline Kergomard, L'éducation maternelle dans l'école, paru en 1886, a contribué à installer définitivement en France l'idée d'école maternelle.
I- Education
1. L'école maternelle - 2. Le local - 3. Qu'est-ce qu'une école maternelle ? - 4. L'école maternelle éducatrice - 5. L'école maternelle mixte - 6. L'éducation, ensemble de bonnes habitudes - 7. Education morale
II- La section des petits
8. Eléments éducatifs dont dispose l'école maternelle
9. Le sectionnement
Voir aussi l’article « Maternelles
(Ecoles) » de P. Kergomard dans le dictionnaire Buisson de 1911 : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3142)
11. La lecture (numérisé par Michel Delord)
12. L'enseignement du chant
13. L'enseignement du dessin
14. Les récits historiques
15. Leçon de choses
16. Le calcul (numérisé par Michel Delord)
17. La géographie
18. Résumé
12. L'enseignement du chant
13. L'enseignement du dessin
14. Les récits historiques
15. Leçon de choses
16. Le calcul (numérisé par Michel Delord)
17. La géographie
18. Résumé
source image : http://www.amazon.fr/Pauline-Kergomard-Alain/dp/2912470226/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1320492026&sr=1-2
PAR
Mme
P. KERGOMARD
INSPECTRICE
GÉNÉRALE DES ÉCOLES MATERNELLES
LIBRAIRIE
HACHETTE ET Cie, PARIS, 1886
PRÉFACE
La plupart des chapitres qui composent ce volume
ont paru, sous une forme à peu près identique, dans l'Ami de l’enfance[1]. Toutes les idées
qu'il renferme, je les ai semées partout où j'ai passé depuis que j'inspecte
les écoles maternelles. Ce n'est donc pas une nouveauté que j'offre à mes
lecteurs.
Si j'ai rassemblé mes articles, élaguant
ici, ajoutant là; si j'ai essayé de coordonner mes idées et d'en faire un tout,
c'est qu'on m'a dit : « L'enseignement au jour le jour du journal s'échappe
par petits canaux et s'en va par petits filets ; il faut amener et ramener
l'eau dans un bassin où chacun viendra puiser à
sa soif. »
Certes,
je n'ai ni la prétention ni l'espoir de « désaltérer » complètement les bons
esprits et les cœurs vaillants qui ont soif de la vérité; mais je serai bien
heureuse si, tel qu'il est, avec ses idées peut-être bien rebattues, ce livre
aide dans leur tâche quelques éducatrices - sans préjudice de quelques
éducateurs- et s'il sauve surtout quelques
enfants de « l'Éducation homicide » contre laquelle il est une protestation.
Pauline Kergomard
PREMIÈRE PARTIE - ÉDUCATION
CHAPITRE PREMIER - L'ÉCOLE MATERNELLE
L'enfant a besoin de la mère. – Pourquoi l'école et pas la famille. –
II faut un gîte pour l'enfant dont la mère travaille au dehors. – Ce que doit
être d'abord l'école maternelle
Cette association de mots « l'École
maternelle » parait d'abord étrange. Le mot « Famille » aurait-il perdu sa
valeur ? Sinon, pourquoi lui donner un synonyme, qui l'amoindrit ?
Appellera-t-on dorénavant la mère « maîtresse d'école », et le bébé au berceau sera-t-il
un « écolier » ? Une école, quelque riante qu'elle soit, ne vaudra cependant
jamais la chambrette où l'enfant cueille les baisers maternels; le titre
d'institutrice évoque, quoi qu'on fasse, une idée moins intime que le nom de «
maman », et un écolier ne sera, longtemps encore, qu'un enfant à tablier noir
blanchi de craie, et les doigts tachés d'encre.
La maman se doit à son enfant, et l'on sait
combien de tout cœur elle se donne à lui; son sacrifice n'en est pas un, parce
qu'il porte avec lui sa douce récompense. D'ailleurs, l'amour maternel est si
naturel qu'on a fini par décider que, au lieu d'être un sentiment, il est
simplement un instinct.
« Instinct » si l'on veut, dans le
principe, autrefois ; mais, comme la nature humaine fait, jour par jour,
son évolution vers le mieux, l'instinct fait peu à peu place au sentiment, et à
son tour le sentiment s'éclaire, s'épure, de sorte que plus une femme est vraiment
cultivée, plus elle est mère dans le sens élevé du mot. L'amour maternel tel
que nous le comprenons se développe en raison directe de la civilisation.
Malheureusement, le peuple est resté dans
l'ignorance pendant de longs siècles, et l'ignorance ne développe pas la
moralité ; d'autre part, l'éducation mondaine a exercé une influence détestable
sur un grand nombre de femmes privilégiées par la naissance, par la fortune ou
par le rang ; de sorte qu'ici et là on rencontre des mères qui ne connaissent
pas ou ne semblent pas connaître leurs devoirs maternels. Les unes abandonnent
leurs enfants à des nourrices mercenaires, puis les confient à des domestiques,
puis les mettent en pension ; les autres les laissent vagabonder, les privent
de soins matériels, leur donnent l'exemple de la grossièreté, du désordre, de
la brutalité, si bien que ceux qui, par tempérament, sont enclins au
pessimisme, en sont venus à nier presque l'instinct maternel et à déclarer que
ce qui peut arriver de meilleur à l'enfant, c'est d'être élevé loin de sa mère.
Les pessimistes ont raison, pour
aujourd'hui peut-être, et dans certains cas particuliers; mais ils auront certainement
tort demain, grâce à l'éducation de l'école primaire. En tout cas, même pour
aujourd'hui, si l'on veut éveiller l'instinct maternel chez les déshéritées qui
en sont dépourvues, le cultiver et en faire un sentiment chez les femmes bien douées,
mais à qui l'éducation a manqué, il y a un procédé unique : laisser
l'enfant à sa mère. L'instinct s'éveillera, le sentiment naîtra des soins mêmes
qu'elle donnera à son enfant, des relations qui s'établiront entre elle et lui.
Un regard du bébé, un sourire, le gazouillement qui précède la parole, l'adorable
babil qui le remplace, plus encore l'instinct qui pousse l'enfant vers sa mère
au moindre danger, enfin, et primant tout pour qui a quelque sentiment au cœur,
la faiblesse du petit être, seront plus éloquents, plus persuasifs que tous les
discours, plu irrésistibles que les meilleurs exemples.
Si nous voulons que la mère s'attache à son
enfant, que, pour lui, elle se moralise, s'élève, s'épure, faisons-le élever
par elle.
Si nous voulons aussi que l'enfant ait les
soins, la liberté, les caresses auxquels il a droit et que l'école ne peut lui
donner, laissons-le encore à sa mère.
Laissons-le
toujours à sa mère.
Mais ce « toujours » est un idéal, car
notre état social ne permet pas toujours à la mère de s'occuper de son enfant.
Si tout travail nourrit l'ouvrier, à la condition que l'ouvrier soit bien
portant et de bonne conduite, il ne nourrit pas toujours sa famille. La femme
se voit forcée, elle aussi, d'aller travailler au dehors ; elle ne peut laisser
l'enfant seul à la maison ; elle ne peut pas davantage le laisser errer
dans les rues ou sur les routes, exposé à mille dangers, il faut un abri à cet
enfant; il lui faut des soins.
Cet abri et ces soins, il les a d'abord
trouvés à la salle d'asile, qui a, pendant une période de soixante ans, rendu
d'immenses services aux familles.
Mais les salles d'asile n'ont pu échapper à
la loi du progrès.
Le progrès qui saute aux yeux d'abord,
c'est qu'elles ont changé de nom ce sont aujourd'hui des écoles maternelles, et ce simple changement de nom a sa raison
d'être. C'est, en effet, dans l'école à tous les degrés que se fait la fusion
des différentes classes de la société ; l'école est le vrai berceau de la
démocratie mais encore faut-il que son titre n'éloigne pas les uns et n'humilie
pas les autres. Or, d'une part, la salle
d'asile était considérée comme un établissement de charité où les familles
aisées n'aimaient pas à envoyer leurs enfants si, accidentellement, elles
étaient forcées de s'en séparer ; d'autre part, il n'est pas bien, il n'est pas
moral qu'à peine hors des langes l'enfant se sache l'objet de la charité
publique.
Le nouveau titre « École maternelle » obvie
à ces deux inconvénients il sauvegarde la délicatesse de ceux-ci, la dignité de
ceux-là ; il explique en deux mots le but de l'institution.
L'école maternelle est d'abord un gîte dans
la grande et noble acception du mot, un gîte où l'enfant de la classe
travailleuse et celui de la classe indigente sont à l'abri des éléments, à
l'abri des accidents, à l'abri des mauvais exemples, à l'abri de toutes les
laideurs. Mais toutes ces éliminations ne suffisent pas ; nous ne pourrions
nous contenter, pour l'école maternelle, de ces qualités négatives, et voici
que notre gîte s'ennoblit; car l'enfant doit y être placé dans les meilleures
conditions de bien-être, entouré d'une atmosphère morale et moralisante ;
il y voit de jolies choses, il y entend de bonnes paroles ; il y prend de bonnes
habitudes ; son corps s'y développe, son intelligence et son cœur s'y épanouissent.
L'école maternelle doit être d'abord et
surtout cela. Elle doit être d'autant plus « cela » que les enfants qui la
fréquentent sont, pour des causes diverses, plus dignes de tendresse et de
pitié. L'enfant, dans la famille pauvre, est un être déshérité, à qui l'école maternelle
doit ce qui fait, à celui des parents aisés, les joues roses, les yeux
brillants, le rire clair ; elle lui doit la douce chaleur du nid. L'enfant
pauvre a froid et il a faim ; il n'est pas vêtu et il est malpropre ; il
manque du « soleil du bon Dieu » et de cet autre soleil non moins
indispensable : le bonheur des joyeux ébats, de la tendresse. L'école maternelle
lui doit tout cela.
CHAPITRE II - LE LOCAL
Trois catégories de locaux. - La conception nouvelle en ce qui concerne
l'éducation des enfants. - Peu de personnes l'acceptent encore ; le matériel et
le mobilier scolaires en sont la preuve. - Ce qu'il faut faire pour avoir une
idée exacte de ce que doit être l'école maternelle.
L'école maternelle payera peu à peu, nous
l'espérons, les dettes contractées par la salle d'asile envers les enfants.
Mais il y a fort à faire. Elle ne date réellement que de 1882 ; le décret de
réorganisation l'a trouvée dans les locaux des anciennes salles d'asile, et il
a bien fallu l'y laisser, en attendant.
Ces locaux des anciennes salles d'asile
peuvent être rangés en trois catégories : d'abord le local modèle (il l'était autrefois), se composant d'une grande salle,
parfois même d'une salle immense, d'un non moins immense préau couvert, et
d'une cour, rarement plantée d'arbres, presque toujours trop petite, relativement
surtout aux constructions dont elle dépend.
Ces grands locaux sont clairs, bien aérés,
mais trop sonores ; le bruit des enfants y devient du vacarme ; c'est fatigant
pour eux et pour les directrices.
Il y a ensuite les locaux jugés autrefois
médiocres, plus ou moins appropriés à leur usage, dont, avec beaucoup de bonne
volonté et d'intelligence, on peut cependant tirer un assez bon parti.
Il y a enfin une grande quantité de réduits
misérables, où les enfants manquent d'espace, d'air par conséquent, de soleil,
de tout.
Comment a-t-on pu tolérer des écoles dans
de telles conditions ?
La réponse est tout entière dans l'ancien
nom de ces établissements. C'étaient des salles d'asile. Les enfants étaient
dans la rue, exposés au soleil qui brûle, à la pluie qui glace, à la lourde
charrette qui écrase ; on a couru au plus pressé ; on les a arrachés au danger
et placés en lieu sûr. Qu'importait alors qu'ils fussent bien ? Il fallait d'abord qu'ils fussent moins mal.
D'ailleurs, le soin à la fois scientifique
et attendri que nous prenons aujourd'hui de l'enfant est le résultat d'une
étude toute récente, en même temps que d'une conception nouvelle de nos devoirs
envers lui.
Cette petite chose exquise a, pendant
longtemps, été traitée avec beaucoup de sans-gêne. Tout était toujours assez
bon pour elle.
Sous prétexte que, sa vie durant, l'homme
est exposé à la souffrance physique, aux privations, aux crève-cœur, on inventait
presque pour l'enfant des souffrances physiques, des privations, des crève-cœur.
Ses vêtements, souvent trop chauds en été, étaient systématiquement trop froids
en hiver ; à table, il avait le monopole des morceaux les moins délicats et les
moins fortifiants ; pour l'accoutumer aux déceptions, on lui promettait à la
légère des plaisirs que l'on n'était pas sûr de pouvoir lui donner. Cela s'appelait
élever les enfants à la « Jean-Jacques ». En poussant le système à sa dernière
limite, il y aurait eu une chose à faire : les tuer d'abord, sous prétexte
qu'ils devaient mourir un jour.
Aujourd'hui nous avons appris à
généraliser, et nous savons qu'un principe essentiel en économie politique et
sociale ne peut être qu'essentiel aussi en éducation. Pour consommer, il faut
des provisions ; pour avoir des rentes, il faut faire des économies. Ce qui est
vrai pour les produits manufacturés, pour la fortune publique et privée, est
vrai aussi pour la force physique et morale de l'individu. Autrefois nous
prêchions à nos enfants la prévoyance de la fourmi, et nous agissions à leur
égard en cigales… Il était temps de changer cela.
Les constructions nouvelles sont, autant
que possible, en harmonie avec cette conception nouvelle des besoins de
l'enfant et de nos devoirs envers lui. Elles sont encore en très petit nombre,
mais l'élan est donné.
Il ne faudrait pas cependant se faire
illusion sur l'étendue de notre conquête. Quelques pionniers de l'idée
seulement ont accompli l'évolution, et ils peuvent dès maintenant envisager ce
qu'il leur faudra de persévérance pour faire pénétrer leur conviction dans les
esprits et dans les cœurs. Le plus pressé, c'est de convaincre de qui dépend
l'organisation matérielle de l'école, c'est-à-dire les municipalités,
auxquelles incombent les dépenses du mobilier et du matériel scolaires.
L'ancienne salle d'asile comportait pour
tout mobilier un gradin, des bancs latéraux et un lavabo ; nous trouvons le
gradin, les bancs latéraux et le lavabo dans toutes les salles d'asile types,
transformées en écoles maternelles ; presque toutes les autres sont pourvues
de bancs et de gradins ; quant au lavabo, il est trop souvent regardé comme un
luxe inutile.
Le matériel fondamental de la salle d'asile
se composait d'un claquoir, d'un boulier-compteur, de tableaux de lecture et de
scènes de l'histoire sainte ; ce matériel, on le trouve encore dans la plupart
des écoles maternelles ; quelques-unes, cependant, sont assez misérables pour
n'avoir même pas cela ; les plus riches possédaient des tableaux
d'histoire naturelle.
Cette pénurie de mobilier et de matériel
était une conséquence logique du but de l'institution. On avait voulu tout
d'abord, disais-je, abriter les enfants, les garder. Mais garder un grand
nombre d'enfants sans les occuper, c'était absolument impossible ; les
occuper pour le plus grand profit de leur corps et de leur intelligence, les
cultiver, les élever, en un mot, avait sans doute semblé plus impossible
encore, et l'on avait inventé une sorte de discipline-dressage pour laquelle le
mobilier et le matériel cités plus haut étaient suffisants.
Dans ces grandes salles sonores, la voix de
la directrice se perdait ou se fatiguait trop ; le claquoir obviait à cet
inconvénient. Le besoin de mouvement était, croyait-on, satisfait par les
marches dans la classe, par l'escalade et la descente du gradin ; la
discipline, absolument nécessaire avec un si grand nombre d'enfants, était
sauvegardée par un rythme et un cérémonial convenus; enfin on pourvoyait aux besoins
intellectuels par l'enseignement de la lecture et de l'histoire sainte et par
quelques exercices de calcul au boulier-compteur. Que fallait-il de plus ? Des
tables pour l'heure des repas ? Les genoux des enfants suffisaient.
Ce sont les idées nouvelles en pédagogie
enfantine, idées que l'école maternelle
devra réaliser, qui nécessitent un mobilier et un matériel différents. Mais
les municipalités sont difficiles à persuader. Ah ! si le mobilier et le
matériel dépendaient de l'État ! de l'État dont nous avons en France la
déplorable habitude de tout attendre ! S'ils dépendaient de l'État, nos écoles
des petits seraient bien meublées et bien fournies ; mais ils dépendent
des communes, – habituées à compter sur l'Etat ; – aussi les mieux dotées
sont-elles encore très pauvres ; et, malgré nos efforts, l'école maternelle se
pare encore d'un titre usurpé ; nous en sommes le plus souvent à la salle
d'asile.
Les efforts matériels que nécessitera la
transformation complète de la salle d'asile en école maternelle ne sont pas
ceux qui nous préoccupent le plus ; nous savons que, la chose une fois reconnue
nécessaire, il ne s'agira que de quelques mois, quelquefois même de quelques
semaines, pour améliorer un local pour le meubler, pour le pourvoir d'un
matériel suffisant ; nous savons aussi que l'intelligence de la directrice
peut atténuer les inconvénients d'une installation défectueuse. Mais ce qui
nous inquiète, nous étreint le cœur, c'est la crainte de voir encore pendant de
longues années l'école maternelle détournée de son but essentiellement éducatif, l'école maternelle mal comprise. Nul ne
la comprendra jamais s'il n'a étudié l'enfant, et l'on dirait parfois que, parmi
ceux qui l'étudient, le plus grand nombre l'étudient à rebours.
CHAPITRE III - QU'EST-CE QU'UNE ÉCOLE MATERNELLE ?
L'école maternelle est une
famille agrandie. - A l'école maternelle, il faut de l'air, de l'activité, de
la nourriture, de la propreté. - La cantine scolaire. - Ce que c'est qu'un enfant
propre. - Nécessité de convaincre les parents. - II faut cependant user
d'indulgence dans les premiers jours, à cause de la difficulté pour l'enfant de
s'acclimater à l'école maternelle. - Aguerrir n'est pas faire souffrir. - Les
engelures. - L'enfant apportera un jouet dans sa poche ou dans son panier. - L'assiette de la petite fille.
« Les écoles maternelles, dit le règlement
du 2 août 1882, sont des établissements d'éducation où les enfants des deux
sexes reçoivent les soins que réclame leur développement physique, intellectuel
et moral. », comme ils les recevraient, ajoutons-nous, dans leur famille, d'une
mère intelligente et tendre.
L'école maternelle est une famille agrandie ;
la directrice est la mère d'un grand nombre d'enfants. Or, que font les enfants
de deux à quatre ans élevés dans leur famille ? Ils rivalisent avec les oiseaux
d'activité incessante et de gazouillements ininterrompus. Ils ne font rien de
précis, – ils ne prennent pas de leçons,
surtout, - mais ils font ce qu'ils ont à faire, puisqu'ils se développent
physiquement, intellectuellement et moralement, sans effort, au moins sans
effort apparent, d'une façon normale, et sans que leur mère ait l'air d'y
toucher. Ils bougent tant qu'ils ont besoin de bouger ; ils s'occupent - comme s'ils
étaient payés à la journée - à essayer, puis à dépenser leurs forces : ils
apprennent, sans s'en douter, le nom et les usages des objets qui les entourent ;
leur vocabulaire, d'abord restreint au simple « papa » et « maman », s'enrichit
tous les jours ; heureux de leurs conquêtes quotidiennes, ils causent avec leur
mère, avec leur père, avec les animaux, avec eux-mêmes, de ce qu'ils voient, de
ce qu'ils font, de ce qui les fâche, de ce qui leur fait plaisir ; sans s'en
douter aussi, ils apprennent à vivre en société. Puis, quand ils sont las,
d'eux-mêmes ils se reposent.
Quoi de plus facile et de plus intéressant
que de les guider dans la voie où ils s'engagent ?
Je n'ai jamais vu oisif un enfant bien
portant ; mais encore faut-il quelques éléments à son activité. Dans une
chambre nue, sans aucun objet à portée de sa main, l'enfant deviendrait triste
ce qui serait anormal.
Mais il est si accommodant sur le matériel
qu'on met à sa disposition ! Terre, sable, chiffons, papier, morceau de
bois, feuille verte ou feuille sèche, tout lui est bon pourvu qu'il puisse en
faire, lui, quelque chose, et qu'à ce quelque chose il imprime sa petite personnalité.
Tel jouet luxueux, mais immuable dans sa forme, ne lui plaît qu'un instant,
tandis que le sable, les cailloux, la ficelle l'intéressent tous les jours.
Mais n'anticipons pas.
Le développement physique de l'enfant
réclame de l'air, de la lumière, du mouvement, de la nourriture, de la
propreté.
L'air.
- La plupart des écoles maternelles, sauf celles qui sont de construction
récente, ne peuvent en donner que dans une mesure bien parcimonieuse, mais
encore faut-il qu'elles donnent tout ce qu'elles peuvent donner, et que les
directrices s'appliquent à tirer le meilleur parti possible de conditions trop souvent
défectueuses.
La plus grande partie de la journée devrait
se passer dans la cour, à l'ombre l'été, au soleil l'hiver ; pendant le même
temps il faudrait tenir grandes ouvertes les fenêtres de la classe et du préau.
On a, en général, trop peur de l'air, qui est un des éléments essentiels de la
vie ; on ne redoute pas assez l'air vicié, qui est un poison.
En faisant entrer l'air dans le local de
l'école maternelle, on y fait également entrer le soleil, le grand purificateur.
L'activité.
– Elle dépendra surtout de la façon judicieuse dont les directrices régleront
l'emploi du temps de leurs petits élèves, et du matériel que les municipalités
mettront à leur disposition. Ce matériel doit être un matériel de jeux. Les enfants sont-ils dans la cour :
les uns joueront avec le sable, remplissant des seaux, les vidant pour faire
des « pâtés », creusant des puits, construisant des fours ; les autres, à
l'aide de brouettés, feront les
charrois ; d'autres iront jouer au ballon,
aux quilles.
A un signal donné, tous se mettront en rang
et feront des mouvements gymnastiques,
ou encore ils danseront des rondes.
Mais la lassitude viendra, le jeu languira,
quelques querelles s'élèveront peut-être ; c'est le moment de changer
d'occupation. Les enfants s'assoiront devant leurs tables, - dans les écoles
maternelles privilégiées ; - armés d'un crayon, ils exécuteront sur l'ardoise
de beaux dessins qui feront leur
joie, puis ils tisseront des lacets, ils élèveront des édifices de cubes. Enfin, la directrice
leur montrera des images et leur apprendra à regarder, à reconnaître et à désigner
par leur nom les choses qu'ils auront sous les yeux.
Et si le sommeil vient ? L'enfant dormira.
Et, à ce sujet, je ne serais pas éloignée, pour ma part, de rétablir, dans
certaines conditions, quelque chose d'analogue à ce qu'on appelait autrefois le
sommeil obligatoire. - Le terme est à
changer ; le système, dans sa stricte régularité, aussi ; car il y a des natures
réfractaires au sommeil pendant la journée ou chez lesquelles le sommeil du
jour empêche celui de la nuit. - Mais enfin ce sommeil de tous, ou de presque
tous, à une heure déterminée, que, toute la première, – j'en conviens – j'ai
critiqué et quia été proscrit depuis quelque temps, ne laisse pas d'avoir en
soi quelque chose de bon.
Dans la famille, en effet, l’enfant de deux
ans, de trois ans, dort chaque jour l'après-midi, et il s'en trouve bien. Les mêmes
besoins existent certainement dans la petite population de l'école maternelle.
Une heure régulière de sommeil vaudrait mieux que les petits sommeils – à
bâtons rompus – auxquels succombent, plusieurs fois par jour, les enfants assis
dans la classe ou au préau, et je ne vois pas pourquoi le sommeil ne ferait pas
partie de l'emploi du temps dans la section des petits. Ce serait là, dans tous
les cas, une question digne de l'étude de nos lectrices.
La
nourriture. - Quels sont les aliments nécessaires à de tout jeunes enfants?
quels sont les aliments dangereux? quel intervalle doit-on mettre entre les
repas des enfants qui fréquentent l'école maternelle, de ceux surtout qui
composent la section des petits ?
Les aliments nécessaires sont le lait et la
soupe, puis viennent les œufs, et les légumes de digestion facile.
Les aliments dangereux sont ceux qui
demandent les efforts de mastication impossibles à réaliser pour les enfants
dont la première dentition n'est pas encore achevée. Que de pauvres petiots
sont débiles parce qu'on leur fait manger une nourriture qu'ils ne peuvent
s'assimiler ! Que de parents ignorent, en cela, les vrais besoins de leurs
enfants !
La cantine scolaire, qui fonctionne à
Paris, à Bordeaux, à Marseille et dans beaucoup d'autres villes, est d'une
incontestable utilité. Pour 5 centimes, l'enfant reçoit une portion de soupe ou
de ragoût. C'est chaud, c'est nourrissant, c'est sain.
Dans les écoles où il n'y a pas de cantine,
la complication est grande et la surveillance multiple. Les aliments sont-ils
appropriés à l'âge des enfants, à leur tempérament, aux conditions sanitaires
du pays ? Cela dépend des parents, et il est du devoir de la directrice de
donner des conseils à ceux qui, par ignorance ou par paresse, compromettent la
santé de leurs enfants. Mais parmi les aliments même sains, si les uns peuvent
être mangés froids, tels que la viande bouillie, rôtie, grillée, le poisson et
certains légumes frais, d'autres, tels que les ragoûts, les farineux : haricots,
lentilles, pommes de terre, sont peu agréables et indigestes quand ils sont
froids. Il faut donc surveiller très sérieusement la femme de service chargée
de faire réchauffer les déjeuners.
Combien de fois le petit enfant doit-il manger?
Toutes les trois heures au moins. Chez lui,
avant de partir, vers huit heures ; à onze heures on lui servira la soupe à
l'école maternelle ; à deux heures il boira du lait apporté dans son panier ;
à cinq heures, seconde soupe, qui lui permettra d'attendre le repas du soir,
assez tardif dans les familles d'ouvriers.
La
propreté. – C'est d'abord une affaire d'influence, car elle devrait être
obtenue en premier lieu dans la famille, et l'école maternelle devrait seulement
être chargée de l'entretenir.
Mais l'enfant ne doit pas être considéré
comme propre, parce qu'on lui aura lavé la figure et les mains. Ce n'est pas
l'apparence de la propreté que nous voulons, c'est la propreté. Ce qu'il faut obtenir des mères de famille, c'est le
lavage complet du corps chaque matin ; c'est la propreté absolue de la tête. II
faut en finir avec ce préjugé, presque partout répandu, consistant à croire que
la santé dépend de cette horrible calotte de crasse qui sent mauvais et qui
empêche les fonctions de la peau ; avec cet autre encore plus odieux, qui, dans
certaines provinces, mesure le bon tempérament des enfants au nombre des poux
qui grouillent dans leurs cheveux.
L'enfant doit venir propre à l'école
maternelle, parce que c'est une nécessité d'hygiène physique, et puis parce que
c'est une nécessité d'hygiène morale. Les directrices ne sauraient être trop
rigoureuses sur ce point ; c'est leur devoir, c'est une de leurs plus nobles
prérogatives. Il faut que les enfants soient propres, parce que le sentiment de
la dignité ne s'éveille pas ou ne persiste pas chez des êtres crasseux et
déguenillés. Les directrices exigeront donc tout le possible; sans oublier
cependant que, parmi les enfants qui fréquentent les écoles maternelles, quelques-uns
ont des parents indignes, et d'autres des parents qui, malgré leur bonne
volonté, ne peuvent suffire à leurs charges. A ces divers titres, tous ont
droit à leurs égards, à leur sympathie, à leur tendresse, d'autant plus chaude
qu'ils sont plus malheureux. La directrice doit être au courant de la situation
de chaque enfant elle doit s'occuper de chacun eu égard à sa situation
particulière. Elle est la maman d'une nombreuse famille qui attend tout d'elle.
Ce tout, elle le lui donnera.
Quand l'école maternelle sera bien
comprise, et tant que notre état social l'exigera, un vestiaire renfermant
surtout le linge de corps : chemises, caleçons, jupons, camisoles, bas,
sera la base du matériel, le matériel indispensable. Ce vestiaire permettra
d'arracher à leurs taudis sans air, à leurs taudis fétides, les petiots qui y
végètent à peine vêtus, et de vêtir décemment ceux qui viennent en loques à
l'école.
Dans cette école maternelle, vraiment
maternelle, la majeure partie de la matinée, toute la matinée, s'il le faut,
sera consacrée aux soins matériels (répugnants aujourd'hui, parce qu'ils ne
sont qu'un palliatif), à l'éducation physique, au bien-être, au rayonnement des
enfants ; ils seront nettoyés, habillés, dorlotés, mis en harmonie avec le
local, où, dès lors, ils s'épanouiront vraiment car, à l'heure actuelle, ils y
sont gênés par leurs vêtements malpropres, par leurs cheveux en désordre, par
leur peau même insuffisamment lavée, et surtout, j'en suis convaincue, par leur
misère matérielle et morale, qui produit une discordance, une sorte de cacophonie
dans cet intérieur bien soigné.
J'insiste : il faut d'abord s'adresser
aux parents, dont un grand nombre, soit de parti pris, soit par insouciance de
leur propre intérêt, loin d'aider la directrice, rendent plus ardues encore les
difficultés de son œuvre. Si les enfants sont malpropres, en guenilles, à qui
la faute, le plus souvent, sinon à leurs parents, à leur mère surtout ? Il
s'agit de faire comprendre, dès le premier jour, à la mère, que la directrice
de l'école maternelle et la famille ont des droits et des devoirs réciproques,
et que la directrice, absolument pénétrée du sentiment de ses devoirs, entend
qu'on ait pour elle les égards qui lui sont dus. Or, comme la propreté est une
question de dignité ; comme il faut être propre par respect pour soi-même
et par respect pour les autres ; comme il faut inculquer à l'enfant le respect
de lui-même et le respect d'autrui, – surtout de ceux qui se dévouent à son
éducation, - il doit arriver propre le matin à l'école maternelle. La
directrice a le droit et le devoir de l'exiger.
Ceci, c'est la théorie. Voyons pour la
pratique.
Nous engageons la directrice à se mettre en
rapport direct avec les parents. Une fois par semaine, lorsque les mères ont
fini leur journée de travail, une réunion est possible à l'école. La directrice
questionnera et conseillera.
Il sera entendu
1° Que l'enfant sera exact ; qu'il viendra
tous les jours et s'en ira tous les jours aux heures fixées par le règlement,
si sa mère ne peut s'occuper de lui quand il n'est pas à l'école ce qui est la
règle générale. Les mamans vont au travail, tous les jours à la même heure ;
beaucoup, par négligence, laissent l'enfant dans son lit. La chambre solitaire
manque d'air et souvent de lumière ; l'enfant, qui n'a plus sommeil, s'ennuie ;
il prend des habitudes déplorables, tant au point de vue de l'hygiène physique qu'au
point de vue de l'hygiène morale. Combien y perdent leur santé et leur
intelligence ! Dans les longues journées passées hors de l'école maternelle, les
petits restent enfermés seuls ou confiés à des frères un peu plus âgés ; la
chambre est presque toujours trop exiguë, il y a un poêle, une fenêtre. Les
faits-divers des journaux nous racontent tous les jours à ce sujet des choses
lamentables.
Donc il sera entendu 1° Que l'enfant sera
exact.
2° Que la propreté de la figure et des
mains est absolument insuffisante, et que l'école exige la propreté du corps.
Donc lavages complets tous les jours, bain une fois par semaine, si possible.
3° Que la propreté du corps ne suffit pas
encore, si la tête est malpropre. La croûte ne vient pas plus sur une tête
lavée et savonnée que sur les mains et sur le cou également lavés et savonnés.
Quant au préjugé de la calotte de crasse et de la vermine, il a fait son temps.
D'ailleurs l'école est faite pour extirper les préjugés et non pour les
entretenir.
4° Que la propreté du corps implique celle
du linge ; d'abord celle du linge de
dessous, ensuite celle des vêtements de dessus. Or le linge de dessous, c'est-à-dire
la chemise, ne sera assez propre que
lorsque l'enfant aura une chemise de jour
et une chemise de nuit, l'une
étant mise à l'air, lavée même quand il fait chaud, pendant que l'autre est sur
le corps, et réciproquement.
Beaucoup de parents objecteront leur
position précaire. Mais, en général, la directrice n'aura pas de peine à
réfuter l'argument.
En effet, la majorité des enfants qui
fréquentent les écoles maternelles sont des enfants de cultivateurs,
d'ouvriers, et non des indigents. Le dimanche, les jours de fête, ils sont très
convenablement vêtus, quelques-uns même avec trop de recherche. La directrice
conseillera aux mères de mieux équilibrer à l'avenir : plus de simplicité
le dimanche, moins de laisser-aller les autres jours. Elle ajoutera qu'elle a
le droit d'être d'autant plus sévère pendant la semaine que l'enfant aura été
plus luxueux le dimanche.
Elle parlera de dignité à ces femmes ; et,
si quelques-unes se montrent réfractaires à ce sentiment, elle excitera en
elles l'orgueil maternel ; elle se fera persuasive. Cette question de propreté
ne peut être plus longtemps séparée de la question de la morale. Mais la
directrice prêcherait dans le désert si elle n'ajoutait pas les actes aux
paroles, et si l'inspection quotidienne de propreté, trop souvent jusqu'ici
regardée comme sans importance, était accomplie à titre de simple formalité.
Persuadée que tout le temps consacré à l'éducation est du temps gagné, elle
fera elle-même minutieusement cette inspection examinant le cou, les oreilles,
les cheveux, les genoux, déchaussant ou faisant déchausser quelques enfants pris
au hasard, jamais les mêmes, visitant le linge, renvoyant l'enfant malpropre à
sa mère toutes les fois que la chose est possible. Quand la mère verra que
c'est sérieux, que c'est, pour elle, une question d'être ou de n'être pas
déchargée de son enfant aux heures du travail, elle prendra, pour lui, et peu à
peu, sans s'en douter, pour elle-même, des habitudes de propreté.
J'engagerai cependant les directrices à
être très indulgentes les premiers jours, pour qu'aucun nuage, soit entre la
mère et elles, soit entre elles et l'enfant, n'assombrisse l'arrivée de ce
dernier ; car une des grosses difficultés qu'elles rencontrent d'abord, c'est l'acclimatation
de l'enfant. Il y a des petiots pour lesquels c'est un vrai désespoir de perdre
de vue leur mère pour un instant, à plus forte raison quand il faut la quitter
pour aller dans une maison inconnue, parmi des individus inconnus. Pour tous,
sans distinction de tempérament physique et moral, c'est un changement complet
d'habitudes ; enfin un grand nombre ont déjà entendu parler de l'école comme d'un
épouvantail, comme d'une espèce de maison de correction. Beaucoup de parents se
souviennent encore de l'ancienne férule, et la brandissent en imagination sur
les menottes des futurs écoliers. Il ne faut donc pas s'étonner de toutes les
larmes qui coulent, de tous les cris qui attristent, le matin, les préaux de
nos écoles maternelles.
Il faut accueillir ces dépaysés, ces
apeurés avec des sourires, des bras tendus, des paroles de tendresse et des
baisers ; il faut qu'ils comprennent qu'à l'école maternelle ce que l'on
trouve, ce sont des soins, des chants, des jeux, du bonheur.
Au lieu de les asseoir, dès qu'ils
arrivent, sur un banc du préau, on les mettra en présence de jouets. Comme
exercice d'entrée, on organisera un jeu bien mouvementé, auquel tous prendront part. Pas toujours le
même, surtout un jeu à surprises. Dès que le petit monde sera bien lancé, si la
directrice est un peu fatiguée, si elle veut se conserver pour les heures suivantes,
- ce qui est très légitime - elle donnera la direction du jeu aux plus grands.
(Il faudrait former des moniteurs de jeux, comme on forme dans quelques écoles
des moniteurs de lecture.)
Enfin la directrice s'ingéniera pour que
l'enfant, en mettant le pied dans l'école, éprouve une impression agréable, et
certainement, chaque matin, il se mettra gaiement en route pour y revenir.
Le gai soleil, une température douce
aplanissent bien des difficultés que l'hiver accroît au contraire. Or
l'ouverture des écoles coïncide avec la saison mauvaise. C'est alors que le
génie maternel de la directrice doit se multiplier. Les enfants ont froid et
ils sont grognons; ils ont des bobos qu'on traite légèrement, parce que ce ne
sont pas des maladies. Ce ne sont pas des maladies, c'est vrai, mais ce sont
des souffrances, et parfois des souffrances aiguës, pour lesquelles il faudrait
les plaindre, les dorloter. Je ne veux citer que les engelures, un des fléaux
de l'enfance. Peut-on demander à un enfant qui a les doigts gonflés ou des
plaies aux doigts de faire du tressage, du tissage, du pliage, du dessin,
toutes choses pour lesquelles il faut de la dextérité, de l'adresse ? Ses menottes,
généralement malhabiles, refusent le service quand elles sont endolories.
Beaucoup de personnes disent « Il faut
aguerrir les enfants ! » Aguerrir n'est pas torturer. On aguerrit par l'hygiène
générale, et l'on peut empêcher ainsi les engelures de se produire ; mais,
quand elles sont là, il s'agit de soigner l'enfant et, j'en reviens à mon mot,
de le dorloter pour lui faire oublier sa souffrance.
L'hygiène générale consistera en lavages à
grande eau, - lavages froids en toute saison avant l'apparition des engelures,
- en frictions de la peau avec de l'eau aromatisée, en un régime tonique.
Quand les engelures sont venues, il faut de
la chaleur, des émollients, par exemple de la graisse très fraîche.
Les mains couvertes d'engelures sont
généralement malpropres, un peu parce qu'elles se salissent plus facilement,
beaucoup parce qu'elles sont mal lavées. Or elles sont mal lavées parce qu'on
s'obstine, en général, à les laver à l'eau froide, ce qui est un supplice pour
les pauvres enfants. Il serait facile et peu coûteux d'entretenir sur le poêle
une grande terrine pleine d'eau de son, dans laquelle on puiserait pour laver
les mains malades.
L'acclimatation de l'enfant se ferait plus
facilement s'il apportait son jouet à l'école maternelle. Le petiot qui
sentirait sa petite charge de billes dans sa poche, celui qui aurait sa trompette
en bandoulière, la fillette qui aurait sa poupée dans ses bras et sa petite provision
de chiffons dans son panier, partiraient les uns et les autres de meilleur cœur
le matin, et peut-être entendrait-on moins de pleurs pendant la première heure,
peut-être verrait-on moins de petites poitrines soulevées par les sanglots, car
il faut avouer que le cas est fréquent.
L'enfant qui apporterait son jouet à
l'école y viendrait avec plus de plaisir. Cela est incontestable. Mais nous
trouvons d'autres avantages non moins précieux à cette combinaison. Ce jouet
serait un élément éducatif, et nous sommes si pauvres sous ce rapport ! D'abord
il serait facile à la directrice d'étudier le caractère des enfants. La façon
dont ils se mettraient au jeu serait pour elle un précieux indice. L'un irait tout
seul dans un coin avec sa propriété ; un autre la montrerait avec orgueil
et ne permettrait pas qu'on y touchât ; un troisième proposerait un
échange qu'il chercherait bientôt à renouveler ; d'autres se grouperaient pour
des parties en commun.
L'enfant maladroit de ses mains ou
paresseux d'intelligence apprendrait, de son camarade industrieux, à
transformer en instrument récréatif un objet qui lui avait paru jusqu'alors
avoir une destination toute différente.
Nous pourrions étendre l’énumération, mais
nous nous contentons d'une dernière idée. Il y aurait sans doute par
comparaison, du moins, de beaux jouets qui exciteraient l'admiration et la
convoitise du plus grand nombre. Leurs propriétaires apprendraient à les prêter
de bonne grâce, et leurs petits obligés, à se servir de la propriété d'autrui
en l'entourant de soins. Ceux-ci et ceux-là éprouveraient un des sentiments les
plus exquis que l'âme humaine puisse ressentir : les propriétaires, la
satisfaction d'avoir fait plaisir ; les autres, la reconnaissance.
Grâce au jouet, la glace serait vite
rompue, et en quelques instants on serait camarades.
Non seulement on n'a pas encore admis ce
principe, mais c'était le principe contraire qui était jusqu'ici en honneur.
Comme les directrices se méprenaient sur le but de l'école maternelle, - j'aurai
cent fois à revenir sur cette idée - le petit jouet, le compagnon, le
consolateur était, à certaines heures, confisqué.
J'ai à ce sujet un souvenir récent. Il
faisait chaud ; l'air était lourd dans la salle trop peuplée ; la plupart
des enfants luttaient contre le sommeil ; quelques-uns, vaincus, dormaient par terre.
La directrice faisait le possible pour intéresser son petit monde à une leçon,
dont le défaut capital était d'être une leçon.
Une petite fille de quatre à cinq ans attira mon attention. Elle était bien
éveillée celle-là, mais à cent lieues de ce que disait la maîtresse. Ce qui la
captivait, c'était la poche de son tablier, qu'elle caressait du regard. De
temps en temps elle jetait un coup d'œil furtif vers la directrice, et, quand
elle espérait n'en être pas vue, elle glissait sa main dans sa poche et en
retirait à moitié une petite assiette de métal, une assiette de ménage, qu'elle laissait bien vite
retomber au fond de sa cachette.
Je m'approchai de la fillette ; elle
tressaillit et devint rouge jusque dans les cheveux. Elle se faisait le
raisonnement suivant, la pauvrette : La directrice me prendrait mon jouet ;
que va faire cette dame… une inspectrice générale !!
« Tu as une bien jolie petite assiette,
mignonne, lui dis-je; veux-tu me la montrer ? »
L'enfant mit la main dans sa poche et, avec
un air étonné et peu rassuré, lentement elle me tendit son trésor.
« Tu
as eu une bien bonne idée d'apporter ton jouet. Amuse-toi, et puis apporte-le
encore demain. »
Les yeux de l'enfant rayonnèrent; elle
n'était plus dans une classe, mais dans un pays lumineux.
CHAPITRE IV
L'ÉCOLE MATERNELLE ÉDUCATRICE
Pourquoi l'enfant vient-il à l'école ? - Ce qu'on est convenu d'appeler
éducation. - L'éducation intérieure. - L'ancienne salle d'asile a fait
seulement de la discipline matérielle. - Cette discipline-dressage ne permet pas
de faire connaissance avec l'enfant. - Que se propose l'éducateur ? - Nous ne
nous y prenons pas bien. - Ce qu'est pour l'enfant la vie normale.
« L'école maternelle, dit le règlement du 2
août 1882, réorganisant les salles d'asile, l'école maternelle est un
établissement d'éducation. »
Dès
qu'on s'occupe d'éducation, on se trouve en présence d'une œuvre à la fois
grandiose et redoutable ; il faudrait, pour bien-faire, avoir la faculté de
tout voir, il faudrait en quelque sorte tout savoir. Or on n'a souvent pour tout
bagage qu'un peu d'expérience et beaucoup de bonne volonté. C'est mon cas, et
j'avoue que, si j'ai osé aborder ce sujet ardu, pour lequel on ne saurait
creuser assez profond; ni s'élever assez haut, c'est bien plutôt pour chercher avec mes lectrices que pour
leur apporter une science et surtout la leur imposer.
Il est élémentaire, au moins, de se
demander dès le début quel est le résultat vers lequel on tend.
L'éducateur se propose, n'est-ce pas ? de
semer, puis de faire naître, grandir et fructifier toutes les bonnes graines.
Pourquoi se le propose-t-il ? Pour que l'individu arrive à sa plénitude ou, si
vous le préférez, à la perfection, et, quand je parle ici de perfection, je veux dire au meilleur de
ce que chacun peut donner. L'éducateur se propose donc le bonheur de
l'individu, un bonheur qui n'a rien de commun avec l'égoïsme, et par conséquent
le bonheur de l'humanité.
Quand je dis l' « éducateur », je
généralise, parce que je prends mon idéal pour une réalité. Il faut, au contraire,
reconnaître que beaucoup de personnes qui font de l'éducation partent d'un
principe tout opposé « l'homme, disent-elles, n'est pas né pour être heureux ».
A force de le dire, à force de l'entendre dire, elles ont fini par en être
convaincues ; plus encore, elles ont cru qu'il était coupable d'essayer de le
rendre heureux, et, sous prétexte de tremper l'enfant en vue des difficultés
futures, elles l'ont privé de la chose à laquelle il a droit : elles l'ont
privé du bonheur.
« Pourquoi l'enfant serait-il heureux,
disent-elles, puisque le paradis n'est pas sur la terre ? » Il n'y est pas,
c'est vrai ; mais il y serait si chacun s'élevait à toute la hauteur morale
qu'il peut atteindre ; il y serait si chacun était travailleur, juste, sincère,
dévoué, désintéressé, enthousiaste du beau et du bon ! Un seul être qui ne
remplit pas tout son devoir, qui ne cherche pas à monter, à monter encore, à monter
toujours, dérange l'équilibre. Le malheur de l'humanité est fait de toutes les
infractions au devoir commises par tous les humains ; le bonheur de l'humanité
sera fait, au contraire, de tous les progrès accomplis par les hommes qui se
succéderont ici-bas. Quel idéal à semer dans les cœurs que de persuader à
chacun qu'il détient une parcelle du métal précieux qui doit faire l'âge d'or
de l'humanité, cet âge d'or que l'on s'obstine à placer derrière nous, tandis
qu'il est devant nous … là-bas, là-bas, si nous avons des défaillances, mais à
portée du regard si nous sommes des travailleurs de bonne volonté !
Mais encore faut-il, je le répète, avant d'entreprendre
une œuvre aussi délicate que celle de l'éducation des enfants, se rendre compte
d'abord du point de départ et du point d'arrivée, et chercher les meilleurs
procédés pour aller de l'un à l'autre. Il faut savoir d'abord ce que c'est que
le bébé, puis ce que c'est que l'enfant, puis ce que c'est que l'homme.
Le point de départ, le voici : Le
petiot sort à peine des langes ; il porte en lui, à l'état de germe,
toutes les possibilités d'arriver au but, c'est-à-dire de devenir un être fort,
intelligent et bon, utile à lui-même et à ses semblables. Il s'agit pour nous,
instituteurs, de développer ses forces physiques et intellectuelles et de les
faire tendre vers l'intérêt et le bien communs.
Il faut avouer que nous nous y prenons fort
mal. Nous prétendons faire « l'éducation » de l'enfant, sans avoir fixé l'idée
que ce mot représente.
En effet, on appelle généralement éducation
un certain ensemble de qualités extérieures qui donne entrée dans la bonne
société ou qui prouve qu'on y a toujours vécu. Avoir de l'éducation, c'est
vivre selon le code de la civilité puérile et honnête ; manquer
d'éducation, c'est être en rupture plus ou moins ouverte avec ce code.
L'éducation ainsi comprise, c'est un vernis.
Certes, ce vernis a sa valeur. Il a sa
valeur partout, mais surtout dans une démocratie, où toutes les classes de la
société se coudoient constamment, et où la classe dès longtemps privilégiée ne
peut, malgré son incontestable bonne volonté, faire taire ses répugnances pour
le laisser-aller de la tenue, la grossièreté des propos, la brutalité des
relations.
Cette importance du « vernis » est
cependant relative ; ce n'est que le côté matériel de l'éducation, ce n'est
que la conséquence de l'éducation intérieure, de l'éducation morale. On dit que
la politesse vient du cœur, et l'on a raison, s'il s'agit de la vraie politesse ;
nous pouvons même affirmer que toutes les qualités sociables qui font le charme
des relations viennent, elles aussi, du cœur et de l'esprit.
Or c'est cette éducation intérieure, qui a
son reflet à l'extérieur, que nous voulons poursuivre à l'école. Nous voulons
la commencer à l'école maternelle, la continuer à l'école primaire et la voir
se perfectionner chaque jour de la vie de l'individu.
Jusqu'à présent, l'école maternelle - héritière
en cela, comme en beaucoup d'autres choses, de l'ancienne salle d'asile - s'est
appliquée surtout à discipliner, à discipliner matériellement ; elle ne s'est préoccupée
que d'un des côtés de l'éducation, et justement du moins élevé.
Grâce à la discipline matérielle, on a
évité les bousculades, le tumulte, on a obtenu le silence, sans lequel il n'y a
pas d'enseignement possible. C'est certainement un succès; mais c'est le cas de
dire, ici, que certaines victoires équivalent à des défaites car le triomphe de
la discipline a été là défaite de l'éducation.
En effet, les procédés exclusivement
collectifs qui ont fait de chaque enfant une unité abstraite dans le nombre,
empêchent l'éclosion de l'individualité.
A peu d'exceptions près, on ne remarque, dans les enfants qui peuplent nos
écoles maternelles, ni qualités ni défauts saillants. Je suis souvent effrayée
de l'extrême facilité avec laquelle ils peuvent être conduits. Cette facilité
provient de leur sommeil moral.
Interrogez une mère de famille, une mère
consciencieuse, qui étudie ses enfants, qui s'efforce de développer en eux
certaines dispositions et d'enrayer certaines autres elle vous dira non
seulement les différences absolues qui sautent aux yeux dans le caractère de
chacun d'eux, mais aussi les différences de détail, les nuances. Dans certaines
familles privilégiées, les qualités de chacun des enfants compensent ses
défauts; dans d'autres familles, au contraire, tout concourt à rendre la tâche
difficile ; mais au moins, bonnes ou mauvaises, les dispositions diverses se
font jour, et l'éducation a prise. Ce que la mère de famille redoute le plus,
c'est un être terne, sans qualités ni défauts apparents.
Dans le milieu social où se recrutent les
quatre-vingt-dix-neuf centièmes des enfants de l'école maternelle, les mères
n'ont ni le temps ni la culture nécessaires pour s'occuper avec fruit de
l'éducation de leurs enfants ; cependant elles connaissent au moins les grandes
lignes du caractère de chacun : celui-ci est tendre, celui-là sans
expansion ; l'un est généreux, l'autre avare ; il y en a qui n'en font qu'à
leur tête, d'autres qui sont naturellement soumis. Ces différences sont
inséparables de la vie même.
Pourtant, à l'école maternelle, les enfants
se ressemblent tous ; la discipline en a fait des espèces de machines ;
ils ne sont réellement pas en vie. La vie reprend ses droits dès qu'ils mettent
le pied dans la rue, chacun redevient spontanément lui-même, ayant secoué la
discipline qui en fait toute la journée un être factice.
Le dressage matériel, qui arrête les
manifestations de la vie, est un crime de lèse-enfance ; le dressage intellectuel
n'est pas moins coupable.
Cependant, toutes les fois que je fais
cette question : « Mes petits, pourquoi venez-vous à l'école maternelle ? »
je reçois invariablement cette réponse « C'est pour apprendre, c'est pour
devenir savants ». Cette réponse, ce ne sont pas les enfants qui l'ont inventée
; ils l'ont apprise ; et la preuve, c'est que, à une des dernières sessions
d'examen pour le certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles,
toutes les aspirantes, très nombreuses, toutes,
même celles qui avaient été élevées au cours normal, commençaient ainsi leur
leçon :
« Pourquoi venez-vous à l'école maternelle ?
- Pour devenir savants, répondait en chœur
toute la classe.
- Oui, pour devenir savants », affirmait
l'aspirante.
Hélas oui ! nos écoles, avec leur
discipline factice, leur enseignement prématuré, leur parti pris d'instruction
à outrance, étouffent les germes prêts à éclore. Grâce à ce dogme « L'enfant
est à l'école pour devenir savant », nos écoles du premier âge sont des écoles
inhumaines, des écoles contre nature.
La nature, en effet, veut pour l'enfant le
rayon de soleil qui réchauffe, l'air qui vivifie, le mouvement qui accélère la
circulation, le jeu des muscles qui les fortifie, l'exercice naturel des
organes qui les perfectionne ; la nature veut que l'enfant vive, et, quand
je parle de vie, j'entends
l'expansion de toutes les forces de l'être.
Pour l'enfant, la vie normale, c'est la
liberté d'allures. Il est fait pour se rouler par terre quand il ne sait pas
marcher ; pour courir après le papillon ou après le nuage que le vent
emporte ; il est fait pour cueillir des fleurs, pour grimper aux arbres,
pour se parler à lui-même quand il n'a pas d'autre interlocuteur. Il est fait
pour cela; il a droit à tout cela.
Mais il a droit aussi à être nourri, à être
vêtu, à être logé ; et, pour qu'il mange, pour qu'il soit à l'abri des
intempéries, pour qu'il dorme dans un lit, il faut que ses parents travaillent,
et c'est pour cela que l'enfant pauvre va trop tôt à l'école. Je dis trop tôt,
car le petit enfant est fait pour rester auprès de sa mère ; l'école
maternelle est, il ne faut pas s'y tromper, un mal nécessaire, ou plutôt
l'atténuation d'un mal. Il tombe donc sous le sens qu'elle doit être autant que
possible en rapport avec les besoins de l'enfant, car l'enfant pauvre ne doit
pas avoir par aggravation une vie anormale. Elle est anormale cependant, la vie
du tout petit à l'école. Le décret du 2 août, qui avait pour but d'améliorer
son sort, est resté presque impuissant. Notre idéal le plus cher est de ramener
l'école maternelle à son but, c'est d'en faire l'école éducatrice.
CHAPITRE V
L'ÉCOLE MATERNELLE MIXTE
L'école maternelle mixte. - Les avantages de l'éducation en commun des
garçons et des filles. - La discipline de défiance tue la pudeur de l'enfant. -
Pourquoi l'éducation mixte est-elle nécessaire, surtout pour les enfants du peuple
? - L'incident des deux petits
écoliers et d'un groupe de petites filles. - Un principe absolu pour les écoles
mixtes.
Dès qu'on aborde la question d'éducation à
l'école maternelle, il faut appeler l'attention des directrices sur un sujet des
plus délicats : sur l'éducation en commun des garçons et des filles.
Certes, si nos écoles du premier âge avaient, dès le principe, mérité le titre
définitif d'écoles maternelles qu'on
vient de leur décerner, la question n'aurait pas besoin d'être posée ; malheureusement,
les faits existants porteraient à croire que les premiers initiateurs de
l'œuvre, n'ayant pas assez étudié les enfants, ne se doutaient pas de la
naïveté exquise qui constitue leur noblesse, et qu'ils ne les aimaient pas
assez pour les respecter ; car ils en ont eu peur ; et, comme la peur est une mauvaise
conseillère, elle leur a inspiré une discipline de défiance grâce à laquelle
les écoles maternelles mixtes manquent leur but, absolument identique à celui
de la famille, leur but de moralisation.
Entrons dans une de ces écoles maternelles
en miniature qu'on appelle la famille, et regardons ce qui s'y passe. Frères et
sœurs y sont élevés ensemble, recevant les mêmes soins, jouant aux mêmes jeux,
en un mot, vivant en commun, et se développant d'autant mieux qu'il s'établit
un certain équilibre entre les facultés des uns et celles des autres : les
garçons modèrent leurs forces physiques, dont l'exubérance dégénérerait en
brutalité, ils deviennent courtois ; les filles, par tempérament plus timides, plus
craintives, s'aguerrissent, deviennent vaillantes, habiles aux exercices du
corps, tandis que leurs frères deviennent adroits aux exercices des doigts. Le
garçon apprend, presque sans s'en douter, que le devoir du plus fort est de
protéger le plus faible ; la fillette commence avec lui son apprentissage de conseillère,
de consolatrice ; grâce à cet échange incessant, une famille composée de
garçons et de filles est une famille modèle. Une école mixte devrait réaliser
l'idéal de l'école.
Comme nous sommes loin de cet idéal !
La discipline de défiance dont je parlais
tout à l'heure a imaginé une séparation entre les sexes au préau, au gradin,
dans la cour ; et le zèle de l'inspection, tendant à supprimer ces barrières,
échoue souvent devant la force du préjugé. Cette distinction, ce triage
rejettent d'abord les enfants en dehors des idées contractées dans la famille
et dans la société ; elle excite leur étonnement, puis leur curiosité ; mais ce
n'est pas encore tout : vingt fois par jour, pour ne pas dire constamment,
les leçons, les remarques, les encouragements, les blâmes appellent leur
attention sur cette différence de sexe qu'ils auraient encore longtemps
ignorée, et fait entrer dans leur esprit des idées malsaines, dont la plus
dangereuse est celle-ci, que les relations de bonne camaraderie enfantine peuvent
être coupables. « Pourquoi est-ce mal ? » se demandent-ils. La candeur
enfantine, plus délicate que la poudre colorée semée par la nature sur l'aile des
papillons, ne résiste pas à cette curiosité. L'école a commis un crime :
elle a tué la pudeur de l'enfant. Ou l'école mixte doit être impitoyablement
supprimée, ou elle doit être dirigée avec une délicatesse toute maternelle, et,
encore une fois, fondée sur le respect de l'enfant.
La vie en commun à l'école est une garantie
de la bonne tenue, de la délicatesse dans les relations et dans les propos, toutes
choses nécessaires à inculquer et à développer dans tous les milieux, mais qui
acquiert une importance capitale dans celui où se recrute le personnel qui
peuple nos écoles maternelles.
Une seule pièce renferme le plus souvent la
famille tout entière, depuis l'aïeul jusqu'au bébé. Cette seule pièce est à la
fois cuisine, buanderie, salle à manger, chambre à coucher. Il arrive là,
hélas! ce qui arrive dans tous les entassements ; on se gêne les uns les autres,
on souffre les uns par les autres, on s'aigrit et l'on s'exaspère. Non
seulement les délicatesses et les raffinements, qui sont un des grands charmes
de notre vie, manquent à ces familles nécessiteuses, mais la plupart de leurs
membres renoncent à rechercher la propreté, presque impossible à entretenir
dans ces conditions ; ils n'ont même plus l'idée de sauvegarder la pudeur.
Dans ces entassements, les plus faibles
sont trop souvent victimes des plus forts; la femme souffre par l'homme, les
enfants par les parents, par les sœurs et les frères aînés. On vit ensemble
dans des conditions mauvaises ; partant, on ne se connaît pas ; bien pis
encore, on se méconnaît, et ces impressions laissent une empreinte douloureuse
et ineffaçable sur les petits cerveaux et dans les petits cœurs.
Il est de toute nécessité que l'école
maternelle enseigne aux enfants des deux sexes à vivre harmoniquement et proprement côte à côte. Elle le leur apprendra
non par des raisonnements et des discours appris par cœur, mais par les bonnes
habitudes prises le plus tôt possible. Ces enfants, garçons et filles, parqués
ensemble dans leurs réduits, où ils ont vu tant de choses tristes et laides, ne
doivent pas être séparés juste au moment où les conditions matérielles et
morales changent. Chez eux ils ont avalé le poison : l'école maternelle
doit être l'antidote, et, pour cela, l'école maternelle doit être une école mixte,
dirigée avec une délicatesse extrême.
Les écoles maternelles de Suisse et
d'Angleterre nous donnent à ce sujet de bons exemples. Ces écoles mixtes sont
réellement mixtes, et aucune préoccupation pudibonde ne vient augmenter les
difficultés du système, ni en paralyser l'action éminemment éducatrice. Les
enfants, arrivés à l'école par groupes, s'assoient côte à côte, je dirais au
hasard, si je n'avais constaté un ordre remarquable dans tous les établissements
que j’ai visités ; ils travaillent ensemble, jouent ensemble, jouissent
d'une liberté toute fraternelle. – J'ai vu de petits couples dansant et
s'embrassant le plus gentiment du monde. – Cela repose de nos clôtures et de
nos terreurs, qui vont d'ailleurs totalement à l'encontre de leur but; c'est une
science à acquérir. Cette science sera basée sur un principe tout nouveau, peu
répandu : sur le respect de la nature humaine, sur le respect de l'enfant.
En attendant, nous entendons parfois, dans
les écoles, de soi-disant leçons de morale qui nous font frissonner, et nous
constatons dans la rue les pernicieux effets de ces leçons.
Il y a quelque temps, je passais dans une
rue peu fréquentée de Paris ; les petits enfants sortaient d'une des écoles du
quartier. Sur le trottoir opposé à celui que je suivais marchait un petit
couple, que je regardais avec émotion c'était une fillette de quatre ans et un
petit garçon d'un ou deux ans plus âgé peut-être. La fillette portait son petit
panier, le garçon portait aussi le sien, puis il avait passé son bras resté
libre autour de la taille de sa petite compagne, et ils causaient… peut-être
des moineaux qui prenaient leur bain dans le ruisseau, peut-être de la dernière
incartade d'un gros chat noir, peut-être encore de leur prochaine tartine de
confitures.
« Je le dirai à la maîtresse ! » « Je le
dirai à la maîtresse ! Oh! la vilaine… » criait-on derrière moi. Je me
retournai, et je vis un groupe de quatre ou cinq petites filles, les
contemporaines et les condisciples de mon petit couple charmant. « Je le dirai
à la maîtresse! Oh! la vilaine, qui va avec les garçons!» Ces pauvres petites
étaient déjà déflorées par une éducation malsaine... Il me sembla voir un
bouquet de roses sur lequel on aurait jeté de la boue.
Nous poserons donc en principe absolu que la directrice d'une école
maternelle doit parler et agir, non pas comme ayant sous sa direction des
garçons et des filles, mais simplement des enfants.
Rien dans la discipline, rien dans l'enseignement ne doit établir la distinction.
CHAPITRE VI
L'ÉDUCATION, ENSEMBLE DE BONNES HABITUDES
L'éducation, ensemble de bonnes habitudes. - L'éducation doit
s'adresser au physique d'abord. - Comment l'enfant entrera-t-il à l'école et
que fera-t-il en y arrivant ? – Les habitudes d'ordre. - L'heure des repas. - Les
habitudes matérielles impliquent une discipline. - Cette discipline doit sauvegarder
le besoin de vivre. – L'enfant occupé se garde presque seul. - Souvenir
d'Auxerre. - Le jeu libre donne des indices précieux à l'éducation. - Souvenir
de Nice. - Le sable, les cubes, les jouets. - L'école primaire pourvoyeuse de
l'école maternelle. - L'exemple de Bordeaux.
Le règlement des écoles maternelles donne
la première place au développement physique. C'est logique, tout simplement,
car, sans le développement physique, les autres seraient inutiles. Un enfant
frêle, délicat, maladif est dans de mauvaises conditions pour apprendre ; ses études
sont presque toujours enrayées, imparfaites ; l'ouvrier qui n'a pas de santé est
fatalement destiné à la misère. Tout éducateur doit donc se pénétrer de ce
principe : c'est qu'il faut aller du physique au moral. Le corps est la
maison de l'esprit ; pour que l'esprit se porte bien, il lui faut une maison
saine. L'éducation du corps doit précéder celle de l'intelligence, comme les
habitudes matérielles doivent précéder les habitudes intellectuelles. Les deux
éducations, d'ailleurs, s'aident et se complètent sans qu'on s'en doute.
Nous prenons l'enfant dès le seuil de
l'école, et nous voulons qu'il y entre, non pas en rampant, par la porte à chien, mais par la porte grande
ouverte, comme des petits hommes,
comme des petites femmes, en un mot
comme des humains que l'on élève dès maintenant avec le sentiment de leur
dignité.
La directrice est là, pour l'inspection de
propreté, qui plus tard perdrait beaucoup de sa raison d'être ; elle accueille les enfants qui lui disent
bonjour. A celui-ci elle dit un mot, à cet autre elle passe la main sur la joue
ou sur la tête ; à cet autre encore qui a été, la veille, bien gentil, elle
donne un baiser ; ne me parlez pas de jalousies excitées ; une mère de
famille ne caresse pas toujours mathématiquement ses enfants les uns après les
autres; les incidents de la vie amènent le tour de chacun.
Les grands
vont eux-mêmes déposer leur panier à la place qu'il doit occuper. C'est une
première habitude d'ordre. Si l'école maternelle est bien agencée, si elle est
pourvue de grands placards garde-manger, les rayons devront être disposés de
manière à être accessibles, aux enfants. La directrice réservera la planche la
plus basse pour les plus petits, la seconde pour les plus grands. Si les
paniers et la place qu'ils doivent occuper sont numérotés, les enfants, même ceux
qui ne savent pas lire les chiffres, apprendront à reconnaître leur numéro
d'ordre et feront dès les premiers jours leur petit ménage.
Ce premier acte : mettre son panier en
place, souffrirait quelque difficulté si les cent ou deux cents enfants de
l'école arrivaient en masse ; mais il n'en est pas ainsi dans la pratique :
ils viennent par petits groupes et quelquefois un à un.
Le panier déposé, les enfants se
débarrassent eux-mêmes de leur chapeau et de leur vêtement. Ceci est de toute
nécessité ; un enfant de cinq ans élevé par sa mère - même dans les
familles aisées ayant des domestiques - se rend à lui-même ces petits services ;
à plus forte raison, un enfant du peuple doit-il le faire.
Je réponds d'avance à une objection qui me
sera faite et qui se renouvellera, je le crains, à chaque conseil de ce genre :
« Cela prendra du temps ! »
Oui, cela prendra du temps, mais il faut faire la différence entre le temps employé, occupé, et le temps perdu. C'est de l'éducation, et l'école
maternelle a en vue l'éducation, non
pas une éducation spéciale à tel lieu et à telle heure, non pas une éducation dont
l'enfant devra se débarrasser comme d'un fardeau, dès qu'il aura quitté l'école
pour la maison paternelle, mais une éducation qui lui servira dans la vie. « Le
temps employé à l'éducation est du temps gagné » ; je voudrais voir cette
devise inscrite sur les murs de nos préaux, de nos classes, de nos cours.
Je reprends : La directrice,
l'adjointe, la femme de service aident les maladroits.
Quant aux petits, on les débarrasse de leur
panier et de leur vêtement, mais en leur parlant « Donne-moi ton panier ». «
Allons ensemble mettre ton panier à sa place, veux-tu ? » « Quand tu seras
grand comme Louis, comme René, comme Marguerite, tu le placeras tout seul. »
Et de même pour le chapeau, et de même pour
le manteau. C'est un sujet de conversation tout trouvé ; les directrices en
cherchent ; or ceux qu'elles trouvent tombent dans le convenu, - parce qu'elles les ont cherchés, - tandis que la
conversation s'engage naturellement dès qu'il s'agit d'un acte de la vie du petit
écolier.
Cette habitude de se servir soi-même
d'abord, puis d'aider ceux qui sont trop jeunes à se servir eux-mêmes, et
enfin, pour les plus grands, de prendre, chacun à son tour, sa part du travail
de tous, doit être encouragée dans la classe et au réfectoire. Un quart d'heure
avant l'heure des exercices dans la salle, deux garçons et deux filles (en plus
grand nombre, ils se gênent mutuellement), pas toujours les mêmes,
alternativement, de manière que tous les plus grands fassent à leur tour le
service, iront disposer les ardoises, les cubes, les bâtonnets.
Au réfectoire…
En principe, nous désirons que les enfants
rentrent chez eux à midi pour prendre leurs repas en famille ; nous le désirons
pour les enfants et pour leurs parents ; mais ce principe doit être
subordonné aux circonstances : à la
distance qui sépare la maison paternelle de l'école, à la santé de l'enfant, au
temps qu'il fait.
En tout cas, l'heure du repas à l'école
maternelle devra attirer, plus que par le passé, l'attention des maîtresses ;
ce repas devra même être l'objet de leur sollicitude. Ce que l'enfant mange, et
dans quelles conditions il le mange, est intéressant à savoir au point de vue
de l'hygiène ; comment il le mange est intéressant au point de vue de
l'éducation.
Quant aux repas, nous pouvons diviser les
écoles maternelles en deux classes : 1° les écoles où fonctionne la
cantine scolaire ; 2° les écoles où l'enfant apporte lui-même sa nourriture.
Partout où fonctionne la cantine, le choix
des aliments est bien approprié à l'âge des enfants ; ces aliments sont cuits
avec soin et distribués en quantité suffisante, donc l'hygiène est sauve. Mais
combien l'éducation laisse à désirer !
D'abord les enfants mangent, neuf fois sur
dix, sans serviette, de sorte que, dès le commencement du repas, leurs
vêtements sont souillés ; ensuite, ils sont, en général, entassés à table.
N'ayant pas la liberté de leurs mouvements, ils sont dans l'impossibilité de contracter
de bonnes habitudes. A deux ans, à trois ans, un enfant ne sait pas manger ;
à quatre ans, s'il est placé dans de bonnes conditions et s'il est surveillé,
il commence à peine à se tirer d'affaire.
Faisons deux tables, ou deux tablées. A
l'une, mettons les enfants de cinq à sept ans, auxquels nous pourrons adjoindre
de plus petits sachant manger seuls et que les plus grands surveilleront. Un
coup d'œil donné de temps en temps à ce groupe suffira, je l'espère. Groupons à
l'autre table les petits et les maladroits, et que, pour les surveiller, « tout
le monde soit sur le pont » la directrice, les adjointes, la femme de service.
Mais, si la directrice est toute seule,
j'engage la pauvre déshéritée à servir le dîner par escouades. Le repas se
prolongera, c'est vrai ; mais, encore une fois, l'hygiène et l'éducation
doivent primer le reste à l'école maternelle.
Ces habitudes matérielles impliquent déjà
la discipline à l'école. Chacun apprend peu à peu à faire ce qu'il doit faire
et à le faire au moment opportun ; et c'est justement en cela que la discipline
de l'école maternelle diffère du tout au tout de celle de la salle d'asile. La
discipline de l'école maternelle est un résultat : le résultat de
l'occupation ; celle de la salle d'asile prétendait se suffire à elle-même :
c'était du dressage, du mécanisme. Il est vrai qu'on arrivait, grâce à elle, à
maintenir sans bruit trois cents
enfants dans une salle. Eh bien, entre cette discipline, trop en honneur encore
dans nos écoles maternelles, entre cette discipline qui décerne le prix de
sagesse à l'enfant « qui ne fait rien », et le désordre et le bruit, je préfère
le désordre et le bruit.
Cette discipline qui tient les enfants
assis au préau, dans le silence et l'immobilité ; cette discipline qui les
accroche les uns aux autres quand ils marchent et qui, sous prétexte de les empêcher
de tomber, les empêche d'apprendre à marcher seuls; cette discipline qui leur
croise les mains au dos ou sur la poitrine comme à des suppliciés ; cette
discipline qui ne leur permet que les mouvements commandés par le claquoir ;
cette discipline qui endort leurs facultés, qui tue dans le germe leur esprit
d'initiative, qui les ankylose au moral et au physique ; cette discipline est contraire à la raison,
contraire à l'hygiène, contraire à la nature ; l'école où elle est encore en usage
est une école malsaine, pour l'esprit et pour le corps ; cette école ne
mérite pas son titre d'école maternelle.
Oh oui ! je préfère cent fois le désordre
et le bruit, car au moins le désordre et le bruit, c'est la vie !
Et cependant je ne veux ni le désordre ni
le bruit. Je ne le veux ni pour la directrice, qui n'y pourrait vivre, ni pour
les enfants, qui doivent s'habituer à une atmosphère de douceur et d'harmonie,
pour aimer plus tard l'harmonie et la douceur. A l'école maternelle, les
enfants doivent faire l'apprentissage de la vie en commun ; or la vie en
commun n'est possible qu'avec une certaine discipline, à laquelle nous nous
rompons peu à peu, sans nous en rendre compte, à l'école, dans la famille, puis
dans la société. Cette discipline, la vraie, ne relève pas d'un règlement
inscrit en grosses lettres sur la muraille : elle relève de la raison et
du cœur, de l'intérêt de chacun et de l'intérêt de tous… Certaines règles fixes
y achemineront les enfants.
La grosse difficulté vient du nombre
considérable d'enfants réunis dans les écoles maternelles ; mais cette
difficulté serait fort atténuée, elle serait presque tranchée si l'on occupait
les enfants.
Il y a quelque temps, déjeunant dans un
hôtel, à une petite table près d'une fenêtre, mon regard mélancolique, – c'est
très triste de prendre ses repas toute seule lorsqu'on est habituée à les
prendre en famille - mon regard mélancolique plongea dans la cour. Il y avait
là un petit enfant, celui du maître d'hôtel. Cet enfant de vingt-trois mois qui
remplissait la maison de ses caprices et de ses cris lorsqu'on l'y tenait
enfermé, était tout seul. Sa mère, dans le bureau, veillait sur lui en
travaillant. Dans la cour il y avait une caisse pleine de pommes de terre, un
mannequin rempli de paille, quelques sarments épars sur les dalles, et un
cheval de bois dont les blessures attestaient les services. L'enfant commença
d'abord par déménager une à une les pommes de terre, dont il fit un tas dans un
coin de la cour. Entre-temps, il allait à son cheval, lui faisait une caresse,
prenait de la paille dans le mannequin et lui en offrait avec sollicitude.
Quand il en eut assez de faire passer les pommes de terre d'un coin à l'autre
de la cour et de faire manger son cheval, il prit un sarment, et, avisant une
ficelle, il essaya d'en faire un fouet. Ce fut long ; le bébé avait de la
persévérance, mais il ne savait pas faire les nœuds. Un essai plus malheureux
que les autres cassa le sarment en deux parties inégales, mais encore unies. «
Malheureux », ai-je dit. Mais comment donc ! voici qu'une des parties
représente la ficelle, une ficelle pour
semblant ; l'autre partie, que l'enfant tient à la main, c'est le manche.
Le bébé de vingt-trois mois eut un
cri de triomphe.
« Il n'est sage que quand il travaille »,
me dit sa mère, qui m'avait vue suivre de l'œil son petit manège.
« Mais il était seul, me dira-t-on; tandis
qu'à l'école maternelle… »
Dans nos appartements de Paris, presque
toujours trop exigus, où les locataires sont superposés comme des objets dans
les tiroirs d'une commode, nous sommes obligés, autant pour nos voisins que
pour nous, d'imposer à nos enfants certaines catégories de jeux et de leur en
interdire certaines autres. Dans toute famille où l'on fait vraiment de
l'éducation, où l'on habitue les enfants à n'être pas égoïstes, à respecter la
tranquillité et les goûts d'autrui, il y a les jeux de l'appartement et les
jeux du dehors. Dans les jardins et dans les squares, le long des avenues, les enfants
jouent au cerceau, aux chevaux, aux barres, aux quilles; ils dansent des
rondes, sautent à la corde, traînent des charrettes; ils font du bruit, ils s'épanchent.
Pour l'appartement, il y a les jeux
tranquilles : la boîte de construction, ou de mosaïque, ou de petits soldats
; la poupée, l'album d'images, le cahier ou l'ardoise qu'on barbouille à
plaisir…
Comparons maintenant.
Nos squares, nos jardins de Paris, c'est la
cour de nos écoles maternelles. Heureuse l'école qui aurait son petit jardin du
Luxembourg, ensoleillé dans les belles journées d'hiver, parfumé par les lilas
au printemps, plein de roses l'été, de roses et d'ombre et de chants d'oiseaux !
En été et dans les beaux jours de l'hiver
il y a des centaines d'enfants dans la partie basse du jardin qui s'étend
devant le palais ; ces enfants jouent les uns tout seuls, les bébés ; les
autres par bandes. Les accidents et les conflits sont d'une rareté vraiment remarquable.
« Ils ont chacun leur bonne ou leur mère »,
direz-vous.
D'accord mais il est intéressant de constater
que les mamans apportent un livre ou un ouvrage, qu'on les trouve réunies par
groupes comme dans un salon, et que les bonnes causent entre elles, veillant
seulement à distance sur les enfants, qui ainsi s'ébattent en liberté.
Ils sont faciles à garder, parce qu'ils se
livrent chacun à l'occupation, au jeu qui les intéresse ; le nombre des mamans
et des bonnes pourrait être notablement diminué sans que les enfants eussent à en
souffrir.
Continuons notre comparaison. Le préau, la
classe même, c'est l'appartement pour lequel nous avons réservé des jeux
spéciaux. Que la table à manger, transportée selon les besoins de la cause,
d'une salle dans l'autre, si l'école est pauvre, soit dès aujourd'hui la table
sur laquelle on joue aux jeux tranquilles. Que les enfants y trouvent dès le
matin les objets dont ils aiment à se servir (ils aiment les objets qu'ils
manient librement) : les cubes, les boîtes à sable, les boutons, les
bâtonnets, le papier que l'on plie ou que l'on déchire, l'ardoise sur laquelle
on barbouille, - et les disputes, le vacarme ne seront plus qu'une exception,
un accident.
Que dans la cour chacun des petits soit
muni d'un instrument de travail : pelle, seau, chariot ; que les grands se
groupent, et l'heure du jeu libre ne sera plus, pour la directrice, la plus
écrasante de la journée. Que dans la classe l'enfant soit pris, intéressé, empoigné
par l'histoire qu'on lui raconte, qu'il ait l'ambition de répondre quand on
l'interroge, de rectifier une erreur de son camarade, il écoutera,… et l'on se
tient tranquille quand on écoute.
Que la directrice ait gagné la confiance
des enfants, qu'elle se soit attiré leur tendresse respectueuse, qu'elle les
ait conquis, et un de ses regards fera plus pour rétablir l'ordre que tous les
coups de sifflet et tous les coups de claquoir du monde. Je le répète, la
discipline-dressage d'autrefois avait été établie parce que l'on n'occupait pas
les enfants. Occupons-les, et nous
aurons résolu le problème.
L'enfant élevé près de sa mère développe
simultanément ses forces physiques et intellectuelles par les occupations
auxquelles il se livre librement par les jeux, soit qu'il ait en main un jouet
approprié, soit que, avec un objet quelconque dont il finit toujours par
découvrir la véritable destination, il s'en soit fait un, qu'il préfère en
général de beaucoup à tous les autres.
Le jeu libre devrait donc être, à lui seul,
presque tout le programme de la section des petits, que j'appellerais bien
volontiers la « garderie » maternelle, si ce mot n'était pris en mauvaise part.
Je ne vois même pas où la directrice peut
puiser des éléments d'éducation intellectuelle et morale en dehors du jeu
libre. Quelle prise a-t-elle, en effet, sur un enfant dont elle ne connaît ni
les aptitudes ni les penchants ? Pour que ces aptitudes se produisent, pour que
ces penchants se révèlent, ne faut-il pas que l'individu ait un libre essor ?
Si l'enfant est assis sans rien faire, s'il est aux prises avec une occupation qui
ne l'intéresse pas, dont il ne comprend pas le but, il s'endort moralement, et
l'on ne peut faire connaissance avec lui.
Au jeu, au contraire, et surtout au jeu en
commun, l'enfant est lancé dans la société de ses pareils, et il y fait
l'apprentissage de la vie. Les petites passions se révèlent, les petits angles
se heurtent, les motifs de discordes se produisent. Nous pouvons étudier en petit,
dans la cour des écoles, ce que les philosophes étudient en grand dans
l'histoire des peuples.
Il y a, parmi les enfants, des
propriétaires convaincus de la supériorité du mien, et il y a des collectivistes. Parfois les deux types se
trouvent réunis dans le même individu, - ce qui ne l'embellit pas. - c'est-à-dire
que tel enfant veut garder son bien à lui seul et prétend partager, accaparer
même celui des autres. Il y a des fondateurs d'empire qui édifient des
monuments de sable et de cailloux, et des conquérants qui détruisent leur œuvre ;
il y a des paresseux égoïstes qui veulent jouir des résultats obtenus par
autrui, après avoir refusé de participer à ses efforts ; il y a des capricieux,
des autoritaires, des boudeurs, des brutaux… Il y a aussi de bonnes humeurs
presque inaltérables, des pacifiques, des généreux, des dévoués.
Dans les écoles dites maternelles, quand
tous les enfants, obéissant au claquoir, sont enserrés dans l'engrenage
mécanique que l'on a pris longtemps pour de la discipline, rien de tout cela ne
surgit. La petite machine marche, s'arrête, s'assied, se lève, fait
automatiquement, aux questions qu'on lui pose, des réponses apprises par cœur.
Il n'y a pas d'observations psychologiques à faire pour la maîtresse.
Au jeu, au contraire, il est nécessaire
d'apporter sa part d'initiative et sa part de souplesse, sa part d'activité, sa
part d'attention et de réflexion, sa part de sollicitude pour le succès, sa
part de force morale dans la déception, sa part de bonne humeur, sa part de
renoncement.
Le jeu, c'est le travail de l'enfant ;
c'est son métier, c'est sa vie. L'enfant qui joue à l'école maternelle s'initie
à la vie sociale, et l'on oserait dire qu'il
n'apprend rien en jouant ?
L'école éducatrice, celle où il apprendrait
à vivre, serait l'école idéale.
Mais pour le jeu libre, qui développe
sûrement les forces physiques et les qualités de l'enfant, encore faut-il un
matériel quelconque. Or les préaux sont nus, les cours sont nues. S'il était
dans la rue, l'enfant jetterait un morceau de bouchon, une feuille, un morceau
de papier dans le ruisseau qui coule, et suivrait avec des cris de joie ou des
soupirs d'anxiété son bateau, filant
lestement ou allant doucement vers un gouffre ; s'il était chez lui, il
jouerait avec un ustensile de ménage quelconque. Je ne passe pas une fois dans
la rue, je ne traverse pas une fois un village, sans envier, pour nos petits
des écoles maternelles, le sort des enfants élevés en liberté, et sans acquérir
une idée nouvelle qui pourrait devenir féconde si elle était transportée dans
nos écoles. J'ai vu, cette année, pendant vingt jours de suite, un bébé de
dix-huit mois s'amusant, sans se lasser, à remplir de sable une fiole qui avait
contenu un médicament quelconque. Sa mère, aux heures où elle ne pouvait
s'occuper de lui qu'à distance, le plaçait devant la maison, près d'un banc qui
lui servait de table ; elle lui donnait la fiole, une cuiller de bois et du
sable, et l'enfant s'occupait, et il se gardait tout seul. Un autre, un peu
plus loin, s'amusait avec quelques bouchons. Tantôt il les faisait rouler à la
poursuite les uns des autres, tantôt il les dressait comme des quilles;
d'autres fois encore, il s'en servait comme de balles.
Avec quelques chiffons on fait des poupées
plus précieuses aux petites filles que les plus somptueux bébés de cire achetés
dans nos grands magasins de jouets ; et une vieille boîte percée d'un trou par
lequel passe une ficelle devient une charrette que l'enfant traîne en
tressaillant de joie.
Oh! ces charrettes sans roues, sans timon,
sans chevaux !...
Un jour, – je demande pardon à mes
lectrices de tous ces souvenirs personnels, mais que vaut la théorie en
comparaison de la chose vécue ? – un jour, je venais d'inspecter une école,
superbe comme construction, triste comme un désert, faute de matériel et, pour
éviter la chaleur, - c'était à Nice, en plein été, - j'étais entrée dans la
vieille ville. Dans ces villes italiennes, le soleil, c'est l'ennemi ; on s'en gardait,
autrefois, en perçant des rues si étroites qu'il est impossible à une voiture
d'y pénétrer. De plus, chaque étage surplombe au-dessus de l'étage inférieur,
si bien que, sans l'étroite bande d'azur que l'on aperçoit en levant la tête,
on se croirait plutôt sous une voûte. Ces rues, dallées à grands carreaux, et
où l'on vit presque dans le demi-jour des églises, sont de vrais paradis pour
les enfants, qui n'y courent aucun danger.
Dans un de ces paradis, une trentaine
d'enfants faisaient un bruit d'enfer, mais un bruit de bon aloi ; pas de disputes,
des cris de joie ; et ils étaient splendides avec leurs belles couleurs, leurs
cheveux envolés, leurs yeux étincelants ! Tout ce bonheur était fait de
quelques boîtes de carton qui avaient autrefois contenu du fil et auxquelles
une maman industrieuse avait fait un trou pour passer une ficelle.
Et le sable ! le sable avec quelque chose pour travailler dedans !
Le sable est un des bonheurs des enfants ; je crois que, si on le retranchait à
nos bambins de Paris, ils feraient leur petite révolution. L'enfant qui a du
sable se garde tout seul. Il fait des puits, il fait des jardins, il fait des
montagnes, il charge des charrettes, de vraies ou de semblants.
Et les cubes ! mais quand on en a, on
en a trop peu, et le plus souvent on s'en sert mal : on les donne aux
grands, et on les emploie à faire des leçons
de géométrie ; on ne les donne jamais aux petits ; parfois ceux-ci sont
admis à l'honneur de regarder la
directrice élever une construction quelconque ! Ce n'est pas cela du tout,
du tout, du tout ! Ce que l'enfant veut, c'est faire usage de ses doigts, c'est
mettre en œuvre sa petite initiative ; il veut imiter, il veut inventer, et
puis il veut, sa construction faite, l'ébranler, la renverser. Cela fait du
bruit, et il adore le bruit.
« Mais on n'a pas assez de cubes pour tous !...
» Il faut en demander. Et en attendant ? - User du don de persuasion que
possèdent les apôtres auprès d'un menuisier de la commune, père, oncle, parrain
d'un des petits élèves, pour qu'il donne à l'école ses déchets de planches. Ils
seront plus ou moins cubiques ? Qu'importe ! les pierres dont on construit
les maisons ne sont pas cubiques, elles non plus.
Ce n'est pas encore assez. Il faut des
pelles, des seaux, des brouettes, des jouets enfin. Il faut des jouets solides,
non pas de ces jouets de bazar qui ne durent qu'une heure, mais des jouets
bâtis à fer, à chaux et à sable par les entrepreneurs de matériel scolaire. Ces
jouets coûtent cher. C'est encore le cas d'être industrieuses et de faire
preuve de bon sens. Tous les ans, les municipalités, même celles qui sont le
plus réfractaires, allouent une somme quelconque pour la distribution des prix.
Une distribution de prix pour ces enfants, c'est insensé ! Et, de plus, comme
des prix impliquent des leçons, une école, ils sont contraires à l'idée de notre école maternelle.
Il faut employer la somme allouée à acheter
des jouets qui appartiendront à l'école, au lieu d'appartenir à l'enfant, des
jouets qui dureront. A la place de
ces jouets de distribution de prix qui ne durent pas même autant que les roses,
il faut acheter des cubes, acheter des images, de belles images bien
cartonnées. Chaque année, le matériel - le trésor - s'accroîtra, le budget
n'aura pas été grevé, et l'école sera riche.
Car après la cantine, après le vestiaire,
l'indispensable, ce sont les jouets ;
vous suivez bien la gradation : la nourriture et la chaleur, puis la
dignité, puis la joie.
Jusqu'ici on peut dire que les
municipalités ont été intraitables. « De la joie à l'école ! et pourquoi ?
l'enfant ne va pas à l'école pour s'amuser ; d'ailleurs, rendre l'école trop
attrayante, c'est enlever à l'élève une partie de son mérite ; l'attrait
n'était pas ce qu'on allait chercher à l'école autrefois. » Mais, puisque nous
avons supprimé les lettres de cachet, la torture ! D'ailleurs, même cette idée
subversive est en train de germer dans les esprits ; tout à l'heure, en
désespoir de cause, nous disions aux directrices d'école maternelle : il y
a peu d'enfants, quelque malheureux qu'ils soient, qui n'aient pas un jouet à eux,
soit de première, soit de seconde main ; en tout cas, il n'y a pas un enfant
qui ne se fasse lui-même un jouet d'un objet quelconque. « Un vieux gobelet ou
une boîte à sardines se remplit de sable aussi bien que le seau le mieux
conditionné ; une cuiller de bois au manche plus ou moins cassé remplace la pelle
; un petit paquet de chiffons sert à faire une poupée, plus choyée souvent que
la traditionnelle poupée aux yeux d'émail et à la chevelure frisée. Que chacun
apporte son jouet à l'école. » Aujourd'hui, sans renoncer à cette première
combinaison, nous en avons une autre, - meilleure, vu la loi du progrès; nous
avons vu une exposition scolaire, celle de Montauban, riche en objets en bois
fabriqués par les élèves des écoles primaires chariots, brouettes, instruments
de jardinage, animaux ; la collection est des plus intéressantes. Il m'a
semblé que l'école primaire était destinée à devenir la manufacture du matériel
scolaire que nous rêvons pour les enfants de l'école maternelle. On
intéresserait ainsi les grands à l'éducation et au bonheur des petits. Ce
serait pour l'école primaire une leçon de morale pratique qui vaudrait bien des
leçons du Manuel.
J'ai fait part de cette idée à un maire,
qui y a fait le meilleur accueil et qui m'a promis - je sais ce que valent ses
promesses - de la réaliser au plus tôt. J'espère que l'exemple de Bordeaux,
pourquoi ne mettrais-je pas au tableau d'honneur cette ville, aussi généreuse
que grandiose ? J’espère que l'exemple de Bordeaux sera suivi par toutes les villes
où le travail manuel est organisé dans les écoles primaires.
CHAPITRE VII
ÉDUCATION MORALE
Education morale. - L'éducation doit être d'abord autoritaire. -
L'obéissance. - Le sentiment de la liberté. – L'amour du travail. – La bonne
humeur, la complaisance, la patience, la sincérité, la bonté. - Le but de
l'éducation est de rendre l'enfant fort, intelligent, bon et beau. - La directrice
distinguera entre les actes ceux qui relèvent de la justice des choses et ceux
qui relèvent de la conscience. - Pour devenir éducateur, il faut savoir
descendre en soi-même, il faut avoir ses idées
en morale comme on a ses idées en dessin, en calcul. - L'exemple, les récits
sont les premiers et meilleurs procédés éducatifs. - Inspirer l'horreur du mal
par la contemplation du bien. – Punitions, récompenses.
Les directrices, disais-je tout à l'heure,
trouveront dans le jeu, et surtout dans le jeu libre, les éléments de culture
intellectuelle et morale que la discipline mécanique leur avait dérobés
jusqu'ici.
Un coup de claquoir étant frappé, qui se
levait pour y obéir ? Était-ce Pierre ? était-ce Paul ? était-ce Marguerite ou
Thérèse ? C'étaient les cent, les cent cinquante enfants réunis dans la classe.
Ils se levaient mus par une espèce d'impulsion matérielle. Au premier signal de
la marche, la masse entière s'ébranlait, chacun entraîné par celui qui le
précédait et poussé par celui qui le suivait. Où était, dans ce grand nombre,
l'enfant obéissant à encourager ? où était au contraire celui chez qui il
fallait faire naître le sentiment de l'obéissance ? La directrice l'ignorait. Cependant
l'obéissance, qui est, de toutes les qualités, la moins élevée dans l'échelle
morale, puisqu'elle est d'abord passive, inconsciente, habituelle, avant de
devenir raisonnée, consentie, voulue, l'obéissance est indispensable en
éducation.
L'éducation, on ne peut le nier, doit être
d'abord autoritaire. Ici le mot autoritaire n'est pas synonyme de sec,
de sévère, d'implacable. Il est mis
en opposition avec l'éducation par le raisonnement. Quand un enfant est trop
jeune pour comprendre le pourquoi d'une défense ou d'une prescription,
l'éducateur est bien obligé de se contenter de « Il faut » ou de « Il ne faut
pas ». Il y a même un degré au-dessous. L'éducateur empêche de faire la chose ou il la fait faire.
Prenons un exemple, pour qu'il ne reste
aucun doute.
Nous supposons trois enfants d'âges
différents qui se sont emparés d'une allumette. On la retire des mains du
premier, qui est un bébé ; au second, on dit : Il ne faut pas toucher aux allumettes, jamais, jamais. Au troisième :
Tu te brûlerais les doigts ; tu pourrais mettre
le feu à tes vêtements, à la maison. A un enfant vraiment développé, on
fait comprendre qu'un incendie est, au moins, préjudiciable, non seulement à
celui qui l'a allumé, par imprudence, mais à beaucoup d'autres, et qu'il ne
faut faire de tort à personne.
L'utilité de la gradation se touche du
doigt. L'éducation autoritaire a été aussi douce que l'éducation raisonnée mais
l'une a agi, puis défendu ; l'autre a parlé et a éveillé les sentiments.
En quoi consistera l'obéissance pour les
plus petits enfants ? Mais, me répondra-t-on, à obéir. Ma question est donc mal
posée. Que défendrons-nous au petit enfant ? Que lui ordonnerons-nous ? ou
plutôt que lui demanderons-nous ?
Nous l'empêcherons de faire tout ce qui
pourrait lui être nuisible, tout ce qui pourrait être nuisible à ses camarades,
tout ce qui pourrait détériorer ce qui l'entoure et, par conséquent, porter
préjudice à quelqu'un.
S'il a un bobo, nous l'empêcherons d'y
toucher ; nous l'empêcherons d'avoir dans les mains un objet tranchant ou
pointu, de porter à sa bouche un objet malpropre ou malsain, ou un objet qu'il
serait dangereux d'avaler ; d'introduire dans son oreille quoique ce soit qui
pourrait le blesser ; de se tremper dans l'eau quand il a chaud ; de se
traîner dans les endroits malpropres ou humides. Nous l'empêcherons d'égratigner
ou de battre ses petits camarades, de leur prendre leurs jouets ; nous l'en
empêcherons du geste, de l’acte ; mais il faut que le geste,
l'acte ait de la douceur. C'est le regard qui doit dire « II ne faut pas ».
Cela a l'air très simple, et c'est pourtant
difficile, non seulement parce que cela exige beaucoup de douceur, mais aussi
parce que cela exige beaucoup de persévérance, je dirai plus, beaucoup de
ténacité. Une seule fois où l'éducateur, par négligence ou lassitude, laisse
faire à l'enfant une chose qu'il l'empêche de faire ordinairement, lui fait
perdre le fruit d'une longue sollicitude, et c'est parce que c'est difficile
que je n'admets pas que les petits soient confiés à la femme de service, qui
n'a jamais étudié cette question délicate.
Mais l'obéissance ne procède pas seulement
par élimination. Elle ne consiste pas uniquement à ne pas faire ce qui est
défendu : elle consiste aussi à faire ce qui est prescrit ou demandé.
La directrice de l'école maternelle
inculquera ce genre d'obéissance au petit enfant en lui donnant de petits
ordres « Mets ton mouchoir dans ta poche », « Ramasse ton chapeau », «
Apporte-moi une ardoise », « Pousse la porte ». L'ordre donné doit être exécuté ; si l'enfant résiste,
la directrice le prend par la main et, tout doucement, sans montrer
d'impatience, elle lui fait faire ce qu'elle lui avait demandé.
Il est indispensable au succès de
l'éducation que l'enfant sente dès les premiers jours la supériorité morale de celle
qui s'occupe de lui, et qu'il ne surprenne jamais ses défaillances, dont il se
hâterait de profiter. Il faut s'être intéressé à la psychologie enfantine pour
se rendre compte du tact merveilleux avec lequel l'enfant reconnaît le fort et
le faible de ses guides. Il est notre juge, ne l'oublions jamais ; dès qu'il a
compris que nous sommes à la fois bons et forts, que nous nous occupons de lui
avec tendresse et logique, il est conquis, et nous avons désormais sur lui une
entière influence.
Ce point acquis, nous arrivons, de nuance en nuance, de l'éducation
autoritaire à l'éducation raisonnée, des tout petits aux petits, des petits aux
moins petits. Nous passons de la défense ou de la prescription toute nue à la
défense ou à la prescription fondée sur l'intérêt personnel, puis à la défense ou à la prescription fondée sur un
sentiment désintéressé.
Encore des exemples, voulez-vous ?
Je disais tout à l'heure qu'il faut
empêcher l'enfant de détériorer les objets dont il se sert.
Or voici plusieurs enfants d'âges
différents comme ci-dessus ; tous tiennent en main leur chapeau, le froissent,
le mordillent, le déchirent. On l'enlève des mains du n° 1 ; au n° 2 on
dit : « II ne faut pas; si tu continues, je le prendrai, tu ne l'auras
plus » ; au n° 3 : « Si tu gâtes ton chapeau, il ne sera plus joli, tu
n'en auras pas d'autre » ; au n° 4 « Ton papa et ta maman travaillent et
se fatiguent pour t'acheter des vêtements; si tu aimes bien tes parents, si tu veux
leur rendre la tâche moins lourde, tu soigneras tout ce qu'ils achètent pour
toi ».
Un bébé tourmente un chien, on prend le
bébé dans ses bras et l'on caresse le chien ; à un plus grand on dit : «
Il te mordra » ; à un troisième : « Ne fais pas de mal à ce pauvre
chien ! tu ne veux pas être cruel, n'est-ce pas ? »
A mesure que l'enfant se développe, que sa
personnalité se fait jour, ses devoirs, naguère d'un ordre tout matériel,
s'élèvent et prennent un caractère plus moral. L'éducation s'élève à mesure
aussi, sans jamais perdre de vue ces principes, qui doivent lui servir de base :
Ne demander que le strict nécessaire ;
Ne pas permettre aujourd'hui ce qui a été
défendu hier,… j'ajouterai dans des
conditions identiques ; car telle chose, parfaitement légitime à certaines
heures, est inacceptable à d'autres heures. Ainsi la liberté absolue des
mouvements, - pourvu qu'elle ne nuise à personne - excellente dans la cour, ne
peut être tolérée en classe pendant un exercice. Le devoir se modifie d'après
les heures et les milieux.
L'obéissance, disais-je plus haut, est
indispensable à l'éducateur. Il la lui faut. Mais il commettrait une faute
irréparable si, pour l'obtenir, il étouffait un autre sentiment qui se
manifeste un des premiers et qu'il est nécessaire de diriger, je veux parler du
sentiment, du besoin, je dirais presque de la soif de liberté.
La question est vaste, très élevée ; si
élevée que j'ose à peine l'envisager, me sentant trop chétive, en présence de
tant de grandeur et d'inconnu. La restreignant à mes propres limites, j'indique
seulement ceci : c'est que le sentiment de la liberté est un des plus
beaux apanages de l'homme ; c'est qu'une de ses grandeurs est le culte qu'il
lui rend. L'homme préfère la mort à l'esclavage. L'amour de la liberté a
produit des héros ; au contraire, le mépris de la liberté est le signe d'un
abaissement moral irrémédiable. L'homme libre dans la patrie libre doit être le
cri de la dignité humaine.
L'éducation ne met pas ce sentiment dans le cœur de l'enfant : il y est. Elle
peut, hélas ! l'étouffer ; et alors c'est une éducation criminelle ; elle doit le
développer en le dirigeant. Y a-t-il une date à laquelle on doive s'occuper de
ce développement, de cette direction ? Cette date… c'est l'instant où l'enfant,
agissant de lui-même, nous prouve que le sentiment est bien en lui.
Nous pourrions étudier l'enfant dans son
berceau ; cependant nous attendrons un peu. Voici que sa mère vient de
l'installer sur un tapis, ou sur l'herbe, ou sur le sable. Il ne marche pas
encore, il se traîne. Peut-on dire d'avance de quel côté il se dirigera ? Eh non
! Il regarde ; il a l'air de faire son choix ; un objet l'attire, … et le voilà
parti. Bientôt sa mère va vers lui, le prend dans ses bras, le dépose à la
place qu'elle lui avait choisie. Puis bébé se remet en route, tantôt vers le
même but, tantôt d'un autre côté. Qui pourra jamais préciser ce qui se passe
dans ce petit esprit mobile ?
Quand l'enfant arrive à l'école maternelle,
il a donc déjà une certaine habitude de la liberté. Dans quelle mesure la lui
a-t-on laissée ?
Dans quelle mesure la lui laissera-t-on
désormais ?
La réponse à ces questions nous conduit
naturellement à définir la liberté de l'enfant. La mère - si elle est
intelligente - laisse faire à son enfant tout ce qui lui est agréable, à la
condition que ce qui lui est agréable ne soit nuisible ni à lui ni aux autres ;
c'est ainsi, d'ailleurs, que, pendant toute sa vie, il devra comprendre la
liberté : droit absolu, en principe, mais droit relatif aux milieux dans
lesquels nous vivons ; droit sans cesse restreint par le sentiment de la
solidarité qui unit l'humanité tout entière.
Si l'enfant ne peut avoir chez sa mère
l'usage de sa liberté absolue, encore moins peut-il l'avoir à l'école, où le
grand nombre d'enfants a forcé d'établir une discipline inutile dans la
famille. Combien cette discipline est loin de la discipline rationnelle que nous
rêvons, nous l'avons dit, nous osons à peine le redire. Mais qui sait ?,
peut-être touchons-nous, en cela comme en bien d'autres choses, le but que nous
nous sommes proposé.
En effet, que l'enfant, dès son entrée à
l'école, soit considéré comme un être libre, non seulement de ses mouvements,
mais de ses goûts, de ses jugements, de ses sentiments ; que la directrice
s'applique à ne restreindre les manifestations de sa liberté que quand elles
pourraient nuire à l'enfant lui-même ou à ses camarades, et bientôt elle se
demandera comment elle a pu accepter cette discipline-dressage que nous critiquons
avec tant de persévérance et de conviction. Or, vous le savez, chères
lectrices, il ne s'agit pas seulement ici du dressage matériel, il s'agit tout
autant du dressage intellectuel, auquel ne doit jamais être soumis un être
libre. Mettre un enfant au régime des vérités toutes faites et apprises par
cœur, le soumettre à un enseignement qu'il ne peut s'assimiler, c'est attenter
à sa liberté intellectuelle et morale. L'enfant, lui-même, doit provoquer
l'enseignement il ne doit, en aucun cas, le subir.
J'aimerais que les mots « liberté », «libre
» fissent partie du vocabulaire de l'école maternelle. « Tu es libre de faire
cela, mon enfant, puisque cela te plaît et ne peut faire de mal ni à toi ni aux
autres. Tu serais libre de faire cela si tu étais tout seul ; mais, puisque tu
vois que cela fait du mal ou que cela est désagréable à ton camarade, tu n'es
plus libre de le faire. Tu es libre de prêter ton jouet à ton camarade, tu n'es
pas libre de lui prendre le sien. » Sans définitions, sans phrases, sans leçon
spéciale de morale, l'enfant apprendrait son droit et son devoir.
Cette idée bien nette, bien précise, se
développerait en même temps que lui; elle présiderait à toutes ses actions, et
la directrice de l'école maternelle aurait ainsi posé la base du meilleur de
tous les enseignements civiques. Cette idée de la liberté matérielle et morale
de l'enfant doit, je le répète, présider à l'éducation qui a pour but de
développer tous les bons germes au détriment des mauvais, le dévouement ne
pouvant vivre dans le même cœur avec l'égoïsme, le mensonge avec la sincérité.
Mais encore faut-il mettre l'enfant dans des conditions où cette conquête du bien
sur le mal puisse se produire ; il faut qu'il puisse faire mal, il faut d'autant plus qu'il puisse faire bien. Or, pour faire mal, pour faire bien, pour arriver
à la comparaison de l'un et l'autre, il faut agir, penser par soi-même, il faut
vivre, tandis que, dans un trop grand nombre de nos écoles, la discipline toute
mécanique ne permet pas aux écarts de se produire, pas plus qu'elle ne permet
aux bons sentiments de rayonner. Ces petits cœurs, ces petites intelligences
paraissent engourdis comme la terre en hiver, alors que nous voudrions les
comparer à l'éclosion du printemps, éclosion riante et parfumée.
Comment distinguer sous cet engourdissement
ce qu'il faut aider à croître de ce qu'il faut étouffer ? Gomment arriver à
connaître non seulement l'enfant, mais chaque enfant ?
En quelque sorte pétri par cette discipline
factice de l'école, l'enfant grandit sans personnalité. Ses défauts couvent
tout au fond, comme un incendie qui n'attend que de l'air pour lancer des jets
de flamme ; ses qualités, en quelque sorte inutilisées, s'étiolent. S'il
n'avait pas, deux ou trois fois par jour, la rue où il prend sa revanche, les
dimanches et les congés où l'incendie éclate, nous aurions des générations d'êtres
apathiques, sans ressort moral, sans caractère,
une ruine pour une nation.
Et cependant ces revanches de la rue, ces
incendies des dimanches et des congés ne doivent pas entrer en ligne de compte
pour l'éducateur. Ce sont des exutoires qui deviendront inutiles dès que
l'école donnera satisfaction au besoin qu'éprouve l'enfant d'être lui-même.
La liberté est un instrument bien dangereux
dans des mains inhabiles ; l'enfant ne saurait donc apprendre trop tôt à
le manier. Si vous supprimez la liberté, l'éducation devient un métier,
l'éducateur un manœuvre ; tandis que l'éducation est une mission, l'éducateur
un apôtre.
Un des besoins physiques les plus impérieux
chez l'enfant, le besoin d'activité, devient, s'il est bien dirigé, le point de
départ d'une qualité maîtresse : l'amour du travail.
Ce besoin d'activité est un besoin vital et se manifeste dès les premières
heures de la naissance. Ce n'est d'abord que du mouvement : l'enfant agite ses bras et ses jambes ; bientôt il
se traîne par terre, marche « à quatre pattes » ; plus tard il grimpe, saute,
danse, court, et chacun de ses amusements, choisi par lui, tend à le faire agir
des membres et de l'esprit.
Tout naturellement, par instinct, il
recherche la difficulté pour la vaincre. Regardez celui qui essaye de soulever
un objet trop lourd pour lui, d'en atteindre un placé hors de sa portée ;
que de fois celui que vous voyez perché sur un meuble en avait vainement tenté
l'assaut !
L'immobilité,
le « rien faire » est absolument antipathique à sa nature.
Le devoir de l'éducateur est de tirer parti
de cette antipathie, d'exercer peu à peu et méthodiquement ce besoin
d'activité, de le transformer par degrés et méthodiquement en amour du travail.
L'enfant a besoin de bouger, de marcher, de
courir, d'exercer ses forces, de les développer ; mais bouger pour bouger,
marcher, courir à l'aventure sans savoir pourquoi, le lasse bientôt : il
lui faut un but. Lancer un ballon, courir pour l'atteindre ; une boule, pour qu'elle
renverse des quilles ; sauter d'un point à un autre par émulation : voilà
autant de buts auxquels tendent certains jeux libres, qu'on ne saurait trop encourager
dans les écoles. Puis viennent les évolutions variées, qui remplacent le
désordre, la poussée, la cohue, par la discipline, par le rythme, par
l'harmonie.
L'enfant apprécie ce résultat ; c'est
agréable parce que c'est à la fois vivant et joli ; et puis c'est commode, à
l'heure de la soupe, par exemple, ou à l'heure de la distribution des bons
points, d'avoir sa part, à son tour, sans bousculade !
Après les évolutions variées, voici les
mouvements gradués : la gymnastique, qui rend le corps souple, qui donne
de l'adresse pour tous les jeux. L'enfant aimera bientôt aussi ce travail-là,
croyez-le.
L'enfant a besoin d'exercer ses poumons. La
preuve, ce sont les cris qu'il pousse pour crier ; c'est le tumulte assourdissant
qui s'élève dès que la petite population de l'école est libre. Faites chanter
souvent, mettez tous vos soins à ce que l'on chante avec goût : l'enfant comprend
bientôt que les cris poussés aux récréations sont inutiles et désagréables ;
que le chant, au contraire, est charmant, et peu à peu, sans s'en douter, il
renonce aux cris sauvages et il chante ; non seulement il chante, mais il veut
chanter bien, et il apprend à chanter.
Les mains, dès qu'elles sont des outils
inutiles, deviennent des outils dangereux. Faute de leur donner des raisons d'agir, on laisse le champ libre
aux prétextes. L'enfant aux mains
oisives détériore ce qui est autour de lui, frappe ses camarades et se fait parfois,
inconsciemment, beaucoup de mal à lui-même.
Mettez-lui entre les mains un jouet, une
ardoise, un crayon, du papier, des cubes : ses petites mains vont
s'occuper avec grand profit pour elles-mêmes(elles deviendront adroites), avec
grand profit aussi pour l'être intellectuel et moral qui vit en lui.
Car il n'y a pas que son corps qui veuille
agir il ya aussi son esprit. Sa curiosité s'éveille : il veut voir, il
veut comprendre, il veut savoir. Une montre fait constamment son tic-tac :
pourquoi? on lui en montre le mécanisme ; le mécanisme arrêté, le tic-tac ne s'entend
plus. La porte s'entre-bâille, puis s'ouvre toute grande, puis se referme,
tandis que la cloison de la chambre reste immobile. Pourquoi encore ? - Voici
les charnières, qui établissent la différence. Il faisait jour ce matin,
maintenant voici le crépuscule. Pourquoi? Et la démonstration est facile.
Mais ce qui entoure l'enfant ne suffit
bientôt plus à son activité intellectuelle ; son imagination lui ouvre des
horizons enchantés ; il veut voir… de loin…
« Lis, étudie », lui disent ses parents,
ses maîtres. Et l'activité intellectuelle le conduit ainsi à l'étude, comme l'activité
physique l'a conduit aux travaux manuels.
L'enfant a travaillé d'abord, poussé par un instinct, instinct irrésistible chez tout être
bien doué.
Il a travaillé ensuite pour ne pas s'ennuyer et pour ne pas faire de sottises (l'éducateur
qui a persuadé, à l'enfant qui s'ennuie ou qui fait des sottises, qu'ennui et
sottise sont les fruits de l'oisiveté, a fait une conquête inappréciable).
Mais ces deux résultats ne sont encore que
des résultats terre à terre ; or vous savez qu'en éducation nous ne cherchons
pas l'utilité seulement, que nous
tendons surtout vers le bien, vers l'idéal.
Un jour l'enfant, devenu, par le travail,
adroit de ses mains ou souple de son corps, rend service à un camarade, il lui
enlève une épine du doigt ou le tire d'un pas difficile ; une fillette raccommode un accroc fait à sa manche,
épargnant ainsi à sa mère la peine de le faire, sa journée finie ; un autre,
garçon ou fille, fait la lecture à un des siens, retenu au lit et trop faible
pour lire lui-même. Ceux-ci et ceux-là comprennent que le travail permet aux sentiments du cœur de se traduire en actes,
que le travail est une des formes du dévouement, et le travail s'ennoblit à
leurs yeux. L'éducateur leur montre alors, peu à peu, que tout ce qui a été
fait de grand, de beau et de bon sur la terre résulte du travail des mains et
du travail de la pensée, et l'enfant, qui aimait d'abord le travail parce qu'il
était utile, arrive à l'aimer parce
qu'il est bon. Ainsi, dès les premières
années, l'éducation autoritaire, dans le sens que nous avons donné à ce mot,
fera travailler l'enfant pour lui en donner l'habitude, et peu à peu
l'éducation raisonnée le fera travailler par plaisir.
Heureux les enfants pénétrés de cette
vérité : que, si l'oisiveté engendre tous les maux, le travail est le grand
libérateur !
Une discipline très large, à peine
sensible, permettra seule d'étudier les dispositions, de les diriger dans le
but de former peu à peu les caractères. L'obéissance, le sentiment de la
liberté, l'amour du travail ont des relations plus intimes avec la discipline
que les autres qualités morales. Les idées d'ordre s'inculquent facilement par
l'habitude donnée aux enfants de travailler à l'arrangement des choses dans l'école
; ils mettront eux-mêmes à la place convenue leurs vêtements, leurs paniers ;
ils iront prendre eux-mêmes leurs jouets ou leur matériel scolaire ; ils les remettront
eux-mêmes à l'endroit où ils les auront pris. Les plus grands aideront la
maîtresse dans les soins à donner aux plus petits : ce qui développera en eux,
en même temps que les idées d'ordre et de propreté, un sentiment de protection
affectueuse d'une part, et une tendre reconnaissance de l'autre.
Les enfants seront amenés à l'obéissance
par habitude d'abord, par raisonnement ensuite, à l'amour du travail par
l'attrait des occupations ; mais tous les sentiments qui font la sociabilité et
la camaraderie : la bonne humeur, la complaisance, la patience, ceux qui
sont d'une nature plus intime et plus noble encore, la sincérité, la bonté,
seront le résultat d'une discipline morale, plus délicate à régler et pour
laquelle les directrices ne sauraient trop étudier l'enfant et s'étudier
elles-mêmes.
Quel est le but auquel elles tendent ?
Elles veulent, – elles doivent vouloir - en développant les forces physiques de l'enfant,
ouvrir son esprit à l'intelligence du vrai, former son cœur à l'amour et à la
pratique du bien, le rendre fort et le rendre bon, bon… et beau en même temps,
car la beauté est le rayonnement sur le visage des idées droites et des nobles
sentiments ; elles auront, pour ainsi dire, mesuré à quel degré du thermomètre moral
s'élèvent ou s'abaissent les bons et les mauvais sentiments, d'où résultent les
bonnes et les mauvaises habitudes. Elles auront compris que, la gourmandise ayant
des effets directs sur la santé, la sobriété relève plutôt de l'hygiène
physique ; que, la paresse paralysant le développement de l'individu et par conséquent
celui de la masse, l'amour du travail est à la fois un devoir individuel et un
devoir social ; que le mensonge, nous faisant perdre l'estime de nous-mêmes et
l'estime des autres, est un avilissement, tandis que la sincérité, seule, élève
l'individu à la hauteur morale à laquelle nous devons tous tendre. Elle
distinguera bien nettement, pour que les enfants arrivent peu à peu à faire
aussi la distinction, les actions qui sont punies par la justice des choses (la
gourmandise procure l'indigestion), celles qui relèvent de l'opinion publique,
- et il doit y avoir, même à l'école maternelle, une opinion publique, - et
enfin celles qui n'ont affaire qu'au juge souverain toujours présent, toujours
en éveil, qui apprécie à leur valeur nos intentions, nos sentiments, nos actes.
Ce juge souverain - la conscience - nous paraît bien oublié, ou plutôt presque
inconnu à l'école maternelle ; il semble qu'on n'ait pas le temps
d'évoquer sa voix. Je voudrais que les directrices eussent fait la distinction
entre les devoirs des petits et les devoirs des grands, entre ceux des enfants
et ceux des hommes, pour ne pas continuer à demander à ceux-là ce que ceux-ci
seulement peuvent donner. Je voudrais aussi qu'elles comprissent bien que
certains devoirs des enfants ne sont qu'une conséquence des nôtres, et que de
nos sentiments et de nos actes dépendent par conséquent leurs sentiments et
leurs actes à eux. L'amour filial (l'amour pour ses instituteurs est une sorte
d'amour filial) est inspiré par l'amour et le dévouement paternels et maternels
; l'obéissance, par l'amour ; la confiance naît peu à peu de la pratique même
de l'obéissance : l'enfant comprend que c'est pour son bien qu'on lui a
ordonné telle chose et défendu telle autre. La confiance fait naître la
sincérité, le respect, la vénération, – ce doux respect mêlé de tendresse, - et
ce souvenir du cœur, souvenir exquis entre tous, qu'on appelle la reconnaissance.
Je voudrais enfin que la directrice développât dans les enfants le sentiment de
la justice, et en même temps celui de sa charmante sœur, dont elle ne doit
jamais être séparée, la bonté.
Oh ! ce n'est pas instantanément qu'on
devient éducateur. Il faut avoir, de longue date, contracté des habitudes de descente en soi-même ; il faut savoir s'étudier,
se creuser, se fouiller pour ainsi dire ; il faut arriver à faire la différence
entre la morale égoïste et utilitaire, qui ne mérite pas le nom de morale, et
la morale qui, du cœur où elle a germé et qu'elle épure, rayonne au dehors,
élargit de plus en plus son cercle, éclaire, soutient, réconforte ; il faut connaître
la « morale », en un mot.
L'individu qui a fait cette étude sur
lui-même sait quel chemin il a parcouru, quelles étapes il a faites ; il
pourrait raconter l'histoire du développement de ses facultés morales comme il
raconte l'histoire du développement de ses facultés intellectuelles ; il
saurait dire, par exemple, comment peu à peu il a compris, d'abord l'utilité du
travail au point de vue matériel, puis son utilité au point de vue moral, comment
il s'est convaincu peu à peu que le travail de chacun concourt au bien-être et
au perfectionnement de tous ; il saurait le dire comme il sait dire les
évolutions intellectuelles qu'il a faites pour voir clair sur tel ou tel point
de la science, autrefois absolument obscur pour lui.
Cette connaissance de l'être moral,
nécessaire à tout le monde et indispensable à l'éducateur, n'a pas eu, jusqu'à
maintenant, dans la préparation des futures institutrices, la place d'honneur à
laquelle elle a droit. C'est faute de se souvenir des étapes successives de
leur vie intellectuelle qu'elles sont, en général, portées à demander à
l'enfant des choses notoirement trop fortes pour son intelligence. Quant aux
possibilités morales des enfants, la question est à peine posée ; d'une part,
la discipline empêche l’élève de se révéler ce qu'il est véritablement ; d'autre
part, il est presque toujours mis en présence de leçons de morale qui passent
si haut, si haut au-dessus de sa tête, qu'il n'en a pas la moindre perception.
C'est toujours et toujours de l'alimentation prématurée. De même que l'enfant
passe trop tôt du lait à la viande, il subit trop tôt un enseignement au-dessus
de ses forces. De même qu'on prétend le faire lire avant qu'il sache parler, on
s'adresse à des sentiments non encore éveillés ; demain, peut-être, il aurait
été ému, il aurait souri ou il aurait pleuré… ; aujourd'hui, il reste
froid, et, si chaque jour on persiste, si l'enseignement continue à ne pas
toucher juste, il est à craindre que l'enfant ne soit et ne reste figé.
Mais, pour toucher juste, il faut avoir
étudié l'enfant ; il faut l'aimer et le respecter assez pour ne lui donner
que le plus pur de soi-même, le plus pur de soi-même approprié à son âge. Il
faut avoir ses idées en morale comme
on a ses idées en dessin, en calcul ;il
faut avoir réfléchi aux procédés à employer.
Comme procédé, à l'école maternelle ou dans
la famille, je ne vois pas autre chose que l'exemple d'abord, les histoires
ensuite.
L’exemple, d’abord.
Je ne suis pas, je l’avoue, de ceux qui
croient que l'enfant naît « désespérément malin par-dessus toutes choses »,
mais je sais qu’il tombe le plus souvent soit dans un milieu réellement
mauvais, soit dans un milieu indifférent en matière d'éducation, soit enfin
dans un milieu où le système d'éducation est défectueux. Or la conscience du
petit enfant n'est pas faite, pas plus que son œil, pas plus que son goût, et
bien moins encore, puisque la conscience fait partie de son être moral, tandis
que l'œil et l'oreille appartiennent à son être physique. L'enfant est comme un
terrain où tout peut se semer et où tout peut germer. Or, pendant la période de
formation où la conscience s'ignore elle-même, où le raisonnement n'a pas
encore de prise, l'exemple est le seul
éducateur. En général (il est évident que les exceptions sont nombreuses), en
général, un enfant élevé dans un milieu où chacun s'oublie soi-même devient
généreux sans s'en douter ; celui qui vit dans un milieu où les relations sont
empreintes de bienveillance, de courtoisie, de douceur, de bonté, ne sera pas
brutal ; celui qui aura vu pratiquer le respect de la vie, la pitié pour
la souffrance, même des animaux, et des animaux les plus infimes, cet enfant ne
sera pas cruel.
Je connais des enfants qui n'ont jamais tué
par plaisir ; qui n'ont jamais tracassé les animaux ; qui ont eu pour eux des
délicatesses à faire croire qu'ils voyaient presque en chacun une personnalité. Un charretier brutalisant
son cheval, un chasseur corrigeant
son chien avec dureté, les indignait ; la maladie d'un oiseau les rendait
malades, et une rixe dans la rue ou une simple dispute les faisait pâlir. Ces mêmes
enfants couraient la maison sans lumière, s'endormaient tout seuls, se
baignaient à la mer sans sourciller et, par les orages les plus violents,
prenaient plaisir à regarder les éclairs et à entendre gronder la foudre.
Au
contraire, dans des familles où l'on ne s'est pas dit que l'éducation est une
chose sérieuse, réclamant pour les parents une étude persévérante d'eux-mêmes ;
dans celles où l'on confiait le plus souvent les enfants aux bonnes, dans
celles où on les laissait jouer avec les premiers venus, j'ai vu des enfants
nés cependant de parents honnêtes et bons (bons de la bonté vulgaire, qui court
les rues), j'ai vu des enfants commettre des actes de cruauté révoltante ; j'ai
vu une petite fille de douze ans, élève d'une école primaire supérieure, -
circonstance aggravante -attrapant des mouches pour son frère âgé de trois ans,
et leur arrachant les ailes afin que l'enfant pût s'en faire un jouet, et cela
sous les yeux de la mère, pis encore, d'après le conseil de la mère !
Le petit enfant de trois ans n'avait pas
inventé cela. La famille le lui avait enseigné. Ah ! la famille et la société
enseignent bien des choses douloureuses, contre lesquelles l'école doit réagir.
Non ! ce n'est pas respecter l'enfant que
de lui donner un mauvais exemple ! ce n'est pas le respecter que de lui
montrer des choses coupables ; ce n'est pas le respecter non plus que de
supposer qu'il peut être coupable lui-même : paresseux, vindicatif,
voleur, cruel, menteur !
Dites-vous à un petit enfant en bonne santé
que la méningite, la fièvre typhoïde, le croup peuvent fondre sur lui ? Lui
décrivez-vous les symptômes de ces maladies, les souffrances qu'il endurerait
s'il en était atteint? Le conduisez-vous voir
les maladies contagieuses?
Or les défauts, les vices sont des maladies
contagieuses. L'enfant doit les
ignorer. Les qualités, les vertus sont contagieuses aussi ; il faut, pour les
lui inculquer, les lui montrer agissantes autant que possible.
La conscience à peine formée de l'enfant,
mise constamment en présence des choses mauvaises, ne les juge plus ; elle les
a toujours côtoyées, elle les croit naturelles. Il faut avoir le jugement formé
pour se moraliser à la vue de certains spectacles répulsifs. C'est pour cela
que les Lacédémoniens faisaient, à mon avis, fausse route, en montrant aux
enfants les ilotes ivres. D'ailleurs il y a si longtemps de cela, qu'il nous
est permis de douter de la légende.
Quelques individus pourront être dégoûtés
de l'ivrognerie en voyant tituber un ivrogne, et de la brutalité en voyant la
force abuser de la faiblesse. Cependant nous ne pouvons pas dire que la
publicité des affaires de cours d'assises, pas plus que le spectacle de la
guillotine, ait moralisé les futurs assassins.
Quant aux récits, qui devraient être, à
l'école comme dans la famille, un des meilleurs éléments éducatifs, ils sont
presque toujours impuissants ou dangereux, impuissants parce qu'ils visent trop
haut, parce que, pour être compris, ils exigeraient de l'enfant des qualités
d'homme : parfois, ils visent même si haut, qu'ils dépassent ce que
j'appellerai le sentiment humain. On les dirait inventés pour des individus
vivant au-dessus de notre sphère. Quand, par exemple, on parle de générosité
aux enfants, il n'est pas question de la générosité qui partage, mais de celle
qui se dépouille ; ce n'est plus de la générosité, c'est du renoncement,
vertu presque extrahumaine. Un enfant qui n'a qu'un gâteau ne le donne pas
spontanément tout entier, pas plus qu'un homme généreux ne donne tout ce qu'il
possède, ce qui ne ferait d'ailleurs que déplacer la question. Si l'enfant donne
tout son gâteau, c'est qu'il y a été contraint ; il éprouve alors un sentiment
de regret et de dépit ; un ferment d'égoïsme se lève et apparaîtra à la prochaine
occasion ; quant aux petits auditeurs, ils sont beaucoup plus émus en entendant
parler d'un enfant qui a partagé son
gâteau ; ils comprennent mieux qu'en entendant parler de celui qui a donné
tout son gâteau; et cependant presque toutes les histoires racontent de ces
renoncements si peu naturels à la nature humaine.
Voici le canevas d'une de ces histoires
Deux enfants, le frère et la sœur, ayant
été bien sages, leurs parents leur promirent de les conduire au cirque, et ce
fut une joie dans la maison. Comme ils allaient partir, une voisine vient et
raconte l'état de dénûment dans lequel se trouve une pauvre famille logée non
loin de là ; la mère propose à ses deux enfants, qui ont quatre et six
ans, de renoncer au cirque ; ils le font avec enthousiasme (ce qui me paraît
d'autant plus excessif que l'enfant ne comprend que la misère qu'il souffre).
Le lendemain, pour récompenser de leur générosité le frère et la sœur, leur
père les emmène à la pêche. Le poisson mord, la friture sera excellente, les
enfants s'en lèchent déjà les lèvres… Mais voilà que la mère propose de vendre les
poissons et de donner l'argent à la malheureuse famille. Nouvel enthousiasme
des petits héros… Mais pas de ceux qui écoutent l'histoire, car ils restent inertes.
« N'est-ce pas, dit alors la directrice, que vous auriez fait comme les autres
enfants ? n'est-ce pas que vous n'auriez pas voulu aller au cirque ? n'est-ce
pas que vous auriez vendu, vous aussi, les poissons ? » Et les enfants
répondent ce qu'on veut qu'ils répondent, parce que c'est toujours ainsi lorsqu'ils
ne sont pas convaincus.
Non seulement les récits sont souvent
impuissants, mais ils sont souvent dangereux. Ils sont presque une école de
vice. J'explique ma pensée. Le héros est un enfant menteur, un désobéissant, un
voleur, un joueur ; et, comme aggravation, les détails enseignent aux petits
auditeurs comment on ment, comment on désobéit, comment on vole, comment on joue.
« La maman d'un petit garçon lui donnait
chaque jour pour son goûter une tartine beurrée. L'enfant raclait soigneusement
le beurre, qu'il mangeait d'abord, et il allait dire à sa grand'mère ou à la bonne
qu'on avait oublié de lui beurrer sa tartine. » Ce petit gourmand, qui ajoute
le mensonge à la gourmandise, pourra faire école,… ce n'est pas plus difficile
que cela.
« Un petit garçon avait chaque jour un sou
que lui donnait sa mère. Un jour, en passant sur la place, il rencontre des
gamins installés à jouer. Il joue et perd son sou. Le lendemain, il joue de
nouveau ; et le surlendemain encore. Bientôt un sou ne lui suffit plus, il joue
l'argent qu'on lui donne pour acheter des cahiers, celui qu'on lui confie pour
faire des commissions, il joue son chapeau, ses vêtements. »
Les moralistes s'élèvent en ce moment, et
avec raison, contre les feuilletons des journaux, qui suscitent des crimes en
enseignant par le menu les moyens de les commettre ; il ne faut pas que nos petits
récits enfantins aident aussi à la démoralisation.
Si les enfants n'entendaient jamais parler
que du beau et du bien ; s'ils ne voyaient jamais que le beau et le bien ;
s'ils vivaient au milieu du beau et du bien, le premier contact avec le laid et
le mal leur causerait une douloureuse impression. La vie à laquelle ils sont
mêlés les initie trop tôt, hélas ! à ce qu'ils devraient toujours ignorer ;
mais l'école est là pour réagir. Si malheureusement, dans la rue, dans la
maison paternelle même, ils rencontrent trop souvent la laideur morale, c'est à
l'école de ne leur montrer que la beauté morale.
Je raconterais, moi, l'histoire d'un enfant
qui, ayant cassé un verre, déchiré son vêtement, perdu en route les sous que sa
mère lui avait donnés pour faire une commission, vient à elle et lui dit « J'ai
cassé un verre » « en jouant, j'ai déchiré ma blouse ou ma robe »; « je suis tombé,
mes sous ont roulé, et je n'ai pu les retrouver » ; celle d'un enfant qui, ayant
bien envie d'un jouet ou d'un livre, d'un gâteau ou d'une pièce de monnaie,
qui, désirant aller chez un petit ami, ou à la promenade ou au cirque, le raconte
naïvement à sa mère en la regardant droit dans les yeux ; celle d'un enfant
qui, à cette question « Qui a fait cette maladresse, ou cette sottise », ou
même pis, répond « C'est moi ». Et je raconterais ces histoires de telle sorte
que les enfants comprendraient que la franchise, la sincérité, l'amour de la
vérité est la plus précieuse qualité des enfants et des hommes. Ils sentiraient
que ce qui paralyse la franchise, c'est la peur, c'est la lâcheté, tandis que la
franchise, c'est du courage, et ils voudraient être courageux. Le héros d'une
de mes histoires ayant partagé avec un camarade ses billes, ses cerises, ses bonbons,
aurait été si heureux de sa générosité, ses petits yeux auraient reflété tant
de choses charmantes, que tout mon petit auditoire se sentirait devenir généreux
à son tour.
Et puis mes histoires se passeraient dans
des jardins plus beaux encore que nature, si l'on pouvait rêver quelque chose
de plus admirable que les perles liquides du ruisseau qui le rafraîchit, de
plus ravissant que les roses veloutées qui le parent, de plus gracieux que les
papillons qui entrent dans le calice des fleurs, de plus élégant et de plus
superbe que le grand arbre sous lequel l'enfant, plus séduisant encore que tout
cela, - la perle de cette belle nature - jouait à l'abri d'un brillant soleil.
Je ne dédaignerais pas les belles dames généreuses vêtues de robes couleur du
temps, et les oiseaux merveilleux qui donnent en gazouillant de bonnes leçons
aux petits cœurs ; je me rappellerais aussi que, si le rire est le propre
de l'homme, il est un des besoins absolus de l'enfant.
Je voudrais enfin inspirer l'horreur du mal
par la contemplation du bien, l'horreur du laid par la contemplation du beau ;
je voudrais aussi faire la part, la grande part de l'imagination, que l'on
chasse du logis sous prétexte qu'elle en est la « Folle », alors qu'elle en est
le charme ; je voudrais de la joie à l'école, parce que la joie est saine et
morale.
Me voici naturellement amenée à traiter la
question des punitions et des récompenses à l'école maternelle. « Traiter » est
prétentieux de ma part ; je ne puis qu'effleurer ce sujet, parce que je n'ai pas
encore trouvé.
Les enfants qui fréquentent l'école
maternelle ont de deux ans à sept ans; le plus grand nombre sont entre trois et
six ans. Peut-on punir des enfants de cet âge ? Non, dans le sens rigide de ce mot.
La directrice doit empêcher le petit, le
tout petit, de faire ce qui serait nuisible à lui et aux autres ; elle
doit l'en empêcher, sans se lasser, autant de fois qu'il recommence l'acte
répréhensible. Grâce à cette persévérance, l'enfant perdra la mauvaise habitude
et prendra la bonne. L'enfant gênant, le brutal sera mis à l'écart ; le
boudeur, laissé à lui-même, reviendra quand il en aura assez de sa solitude
maussade ; il sera bon d'encourager ses premiers pas, de le bien accueillir ;
le paresseux ne sera admis à partager les jeux en commun que quand il aura
partagé aussi le travail en commun ; l'égoïste, qui n'aura pas voulu faire la
part de ses camarades, pourra être mis en dehors des partages.
En tout cas, si la directrice est la maman
que nous rêvons pour chaque école maternelle, son attitude avec les enfants
sera le moyen disciplinaire le plus irrésistible. Un regard grave, attristé, la
privation d'une caresse, ordinairement aussi vite reçue que désirée, feront
grand effet sur le petit coupable, au moment même de la faute, car à cet âge
les impressions ne laissent pas plus de trace sur l'esprit que les ailes de
l'hirondelle sur 1'eau transparente. S'il est trop tard, il ne comprend plus.
La directrice-maman se gardera de décourager ceux dont le tempérament moral est
moins précoce ou moins solide que celui de leurs camarades ; car, s'il y a des
enfants qui nous payent de prime saut et tout en or fin, il y en a, au contraire,
qui nous paraissent insolvables. Il faut
savoir faire crédit à ces derniers ; il faut leur répéter qu'ils peuvent, pour
les aider à pouvoir ; il faut faire appel au plus léger indice d'énergie, il faut
enfin, au lieu de leur prêcher l'impuissance morale et de les faire descendre à
l'humilité, il faut élever ces petites consciences au sentiment de la fierté,
de la dignité humaine.
Et les récompenses, maintenant?
En bonne et saine morale, en morale pure,
la récompense consiste dans le sentiment de bien-être intérieur qu'éprouve
celui qui a fait pour le mieux. Ajouter à ce sentiment l'appât d'un objet
matériel, c'est le rabaisser. Aussi suis-je personnellement hostile aux
récompenses matérielles. Dans l'école telle que je la rêve, il n'y aura ni bons
points ni distributions de prix. Pas de croix d'honneur surtout.
Mais je n'oublie pas que nous sommes dans
une période de transition, - si j'étais tentée de l'oublier, trop de faits plus
ou moins brutaux se chargeraient de me rafraîchir la mémoire. - Quelle que soit
l'intelligente bonne volonté des maîtres et des éducateurs, certaines qualités,
certaines connaissances sont difficiles à acquérir, et l'enfant, privé de sa
liberté matérielle, soumis à un régime intellectuel sévère, se dit qu'il a
droit a quelques dédommagements. Puis les parents, qui ont derrière eux des siècles
d'ignorance, tiennent aux témoignages de satisfaction qui sautent aux yeux de
tous. C'est pour eux une question d'orgueil, pis encore, hélas ! de
vanité.
Les concessions étant nécessaires, nous
admettons les récompenses, les distributions de prix à l'école primaire. Mais
l'école maternelle ne devrait pas être une école ; ce devrait être un centre
d'éclosion où l'enfant se développerait sans s'en douter, où chaque exercice
serait si bien approprié à ses aptitudes, à ses goûts, à sa nature enfin, que
l'exercice lui-même serait sa récompense, et alors je ne vois plus de place pour
ces distributions de bons points, de médailles et de croix d'honneur dont on
fait un abus si ridicule.
On m'objectera peut-être que les
concessions sont nécessaires aussi à l'école maternelle, à peine entrée dans
nos mœurs. Cherchons alors. Un enfant a réussi un tissage, un tressage, un
pliage : l'objet lui appartient ; il peut l'offrir à sa mère. Une
fois par semaine, le dessin sera fait au crayon sur du papier : même convention.
Toute feuille attestant un progrès, mais surtout le bon vouloir, sera la
propriété du petit travailleur. Le bon point illustré sera donné à l'enfant qui,
dans un langage clair et précis, - approprié à son âge - en aura fait la
description.
Quant à l'effort intime, je voudrais qu'il
fût récompensé par des joies intimes : c'est-à-dire que l'enfant obéissant,
sociable, affectueux, sincère, fût amené à comprendre que c'est bon d'être
obéissant, sociable, affectueux, puisqu'on recueille la bonne camaraderie, la
tendresse, la confiance, et que ce qu'il y a de plus adorable à semer autour de
soi, c'est la joie, puisque, semblable à la semence de la parabole, un grain en
rapporte trente, un autre soixante, et un autre cent.
DEUXIÈME PARTIE - LA SECTION DES PETITS
CHAPITRE VIII - ÉLÉMENTS ÉDUCATIFS DONT DISPOSE L'ÉCOLE MATERNELLE
L'école maternelle n'est pas une école. - Les directrices ne sont pas
des professeurs. - Difficulté que ces idées ont à pénétrer dans les esprits. –
Au lycée, à l'école primaire, à l'école maternelle, l'intelligence est
surmenée. – Revue à vol d'oiseau de la salle d'asile-garderie à l'école maternelle.
- Le nouveau programme se réclame de la famille. - Ce que fait l'enfant dans la
famille. - Comment on doit interpréter
le nouveau programme. – Règlement du 2 août 1881. - Programme.
La première partie de ce travail a appelé
spécialement l'attention des directrices d'école maternelle sur le double but
philanthropique et éducatif desétablissements qui leur sont confiés. Je désire
maintenant mettre sous leurs yeux le décret de réorganisation des écoles
maternelles et étudier avec elles les éléments éducatifs qu'il met à leur
disposition, tout en les ramenant sans cesse vers les idées qui doivent se dégager
de ce volume. L'école maternelle n'est
pas une école, c'est un établissement où l'enfant doit s'épanouir en santé
physique et en santé morale, en force, en grâce, en intelligence, en esprit de
conduite. Les directrices sont des éducatrices et non des professeurs ;
l'école doit désormais être faite pour l'enfantet non l’enfant pour l'école.
Hélas ces idées sont lentes à pénétrer dans
les esprits
Depuis quelques années, ceux qui aiment
vraiment les enfants sont hantés par une inquiétude qui s'augmente chaque jour.
Cette inquiétude est provoquée par le travail prématuré et disproportionné
auquel sont soumises les jeunes intelligences. Au lycée, à l'école normale, à
l'école primaire, à l'école maternelle même, les enfants sont surmenés. Chaque année,
les programmes se compliquent. Ce qu'autrefois on mettait toute une vie à
apprendre, il faut que la génération actuelle le sache à dix-huit ans ; une même
intelligence doit s'assimiler les sciences et les lettres, se distinguer dans
les langues vivantes et dans les langues mortes ; on demande à nos enfants
d'être des hommes, et des hommes universels.
Dans tous les ordres d'enseignement,
l'espace à parcourir est si étendu et le temps est si limité que le voyage se
fait à toute vapeur ; on effleure et l'on ne creuse pas ; on a des aperçus
et pas de lumières. A peine hors des classes, l'élève se débarrasse d'un bagage
qui n'était qu'un fardeau. A l'essoufflement de l'étude succède la lassitude,
puis l'oubli. C'est cette instruction superficielle qui fait les déclassés. Pendant
les longues années d'école, la population des campagnes se déshabitue du
travail manuel ; elle n'acquiert pas une instruction suffisante pour les carrières
libérales, et elle encombre les villes, au grand détriment de l'agriculture.
A ce régime, le corps ne s'étiole pas moins
que l'intelligence ; on ne passe pas impunément du grand air à
l'atmosphère des classes, de la vie active à la vie sédentaire ; dans la
lutte que nous avons engagée contre la nature, un grand nombre succombent.
Les intentions sont évidemment excellentes.
On veut former une génération forte au physique comme au moral (la preuve,
c'est que la gymnastique est maintenant inscrite dans tous les programmes) ;
on veut que les ouvriers des villes et les travailleurs des champs aient
l'intelligence ouverte à toute idée de progrès ; on les veut aptes à comprendre
les questions qui intéressent tout le monde dans un pays de suffrage universel.
Mais ce système ne nous paraît pas conduire au but.
Pour ne parler que de l'école primaire,
j'aimerais un programme très restreint, mais de base solide : la facilité
de s'exprimer et d'écrire, j'entends de dire simplement, naturellement et
correctement des choses justes sur les sujets de la vie ordinaire ; la
con-naissance et surtout la compréhension des principaux faits de l'histoire de
France, la curiosité intellectuelle éveillée et le goût de la lecture. Cela
acquis, tout le reste serait donné peu à peu, par surcroît. Tandis que, pour
vouloir trop embrasser, on étreint mal.
Notre inquiétude augmente dès que nous
pensons à l'école maternelle, vers laquelle convergent cependant tant de bonnes
volontés. Là aussi on fait mal, … pour vouloir trop bien faire.
Prenons les choses au commencement,
c'est-à-dire revenons à la salle d'asile-garderie.
Les enfants du peuple empêchaient leurs
mères de gagner leur vie, ou bien ils erraient dans les rues ou sur les
chemins, en butte à mille dangers.
La philanthropie s'émut, on ouvrit des
asiles à ces pauvres petits ; des femmes dévouées se chargèrent de les garder ;
ils furent désormais à l'abri des intempéries, des accidents et des mauvais
exemples. Mais le budget de ces établissements était fort restreint. Considérant
que l'on peut, au besoin, rester toujours dans une chambre, tandis qu'il est
souvent impossible de rester dehors, les fondateurs des asiles-garderies se
préoccupèrent d'avoir des salles suffisamment grandes ; quant à des cours, on
en avait quand on pouvait ; le jardin ombragé, fleuri, parfumé, riant, fut
considéré comme un luxe presque coupable.
Garder quelques enfants dans une chambre
n'est pas toujours facile, même pour les riches, qui peuvent réunir dans la «
nursery » tout ce qui peut intéresser, amuser, développer leurs bébés. Et cependant
frères et sœurs ont souvent une certaine harmonie de goûts et d'aptitudes qui
facilitent leur vie en commun. Mais si, de quelques enfants d'une même famille,
nous passons à vingt, à cinquante, à cent, à plusieurs centaines d'enfants
réunis dans un même local, – ce qui est fréquent dans les asiles-garderies – la
difficulté devient une quasi-impossibilité. En présence du petit nombre
d'enfants dont nous parlions tout à l'heure, l'éducation a cru devoir laisser à
chacun son initiative, elle a fourni à chacun le moyen de se développer librement
; en présence, au contraire, de tout un peuple de marmots, on s'est préoccupé
d'abord de la discipline, on a enrégimenté tout ce petit monde ; de là les
chaînes d'enfants soudés par les épaules, les ascensions anormales au gradin,
l'invention du claquoir, toute cette discipline, en un mot, qui englobe chaque
enfant dans le nombre et ne permet à aucun d'exercer son initiative, cette
discipline pour la discipline, cette discipline qui a dégénéré en dressage. On
n'avait oublié qu'une vérité fondamentale : c'est que l'enfant occupé se
garde tout seul, et qu'il devient possible de garder un grand nombre d'enfants quand
ils sont occupés et intéressés.
On s'en est aperçu cependant, - et c'est là
une seconde étape de nos asiles-garderies.
Les
mouvements en commun qui constituaient la discipline ou le dressage ne
prenaient pas toutes les heures de la journée. « Comment employer le temps de
ces petits, pour avoir la paix ? »
Il semble qu'à ce moment-là il aurait fallu
ouvrirles yeux, regarder ce que faisaient les enfants qui restaient auprès de
leur mère, et essayer de transporter la vie de famille à la garderie ; mais
cette idée, qui nous semble aujourd'hui si naturelle, n'est pas venue d'abord à
l'esprit, et la preuve, c'est que, lorsqu'on a vu que le dressage physique ne
suffisait pas, on a acheté des tableaux de lecture, on a essayé d'enseigner à
lire à des enfants qui ne savaient pas parler, on a chargé leur mémoire de
catéchisme et d'histoire sainte, on a étouffé sous la routine et l'ennui les
germes intellectuels et moraux qui demandaient à éclore, et l’on n'a pas donné
aux enfants la part de bonheur à laquelle ils ont droit.
Le jour où les tableaux de lecture, les
cahiers et les leçons « serinées », puis répétées par cœur ont fait apparition
dans la garderie, ce que l'on a appelé l'école
d'asile était établi. C'était l'école primaire avec tous ses inconvénients
et aucun de ses avantages, car il ne
peut y avoir aucun avantage à recevoir un enseignement prématuré.
Cette institution, déplorable
intellectuellement parlant, de l'école
d'asile existe encore dans mainte commune, et elle est d'autant plus
difficile à déraciner qu'elle a l'assentiment des parents illettrés, c'est-à-dire
de la masse. Ils ne comprennent une école, les malheureux, qu'avec tout un
attirail de livres et de cahiers. Le résultat est lamentable. Que leur importe
? pourvu que leurs enfants « fassent quelque chose ».
On a cependant essayé d'atténuer le mal.
Puisque les enfants apprenaient à lire, on a cherché des procédés moins
abstraits, pour leur rendre la chose moins rebutante. Cela n'a fait, il faut
l'avouer, qu'aggraver la situation. On a mis les enfants plus tôt encore devant
les tableaux de lecture. Puisqu'ils apprenaient le calcul, la géographie, l'histoire
naturelle, on a tâché de mettre ces sciences à leur portée dans des livres
faits exprès pour eux ; mais, comme ils ne réussissaient pas à les lire, il a
fallu faire des leçons à l'usage des maîtresses : c'est l'origine des Manuels.
Avant d'aller plus loin dans cette revue à
vol d'oiseau du chemin parcouru depuis la création des abris pour les enfants,
il faut bien jeter un coup d'oeil sur le personnel chargé de les diriger.
A ce personnel on n'avait d'abord demandé
que de la patience et du dévouement; on lui avait demandé toutes ses forces
physiques et tout son cœur; mais, comme on n'avait pensé qu'incidemment à
l'éducation des enfants, on ne lui avait demandé aucune culture. Certes,
beaucoup de directrices joignaient les qualités intellectuelles aux qualités
morales mais c'était regardé comme un luxe, cela aussi. Du jour au lendemain,
on mit les Manuels entre les mains de toutes les directrices, et toutes celles
qui jusque-là avaient fait de la routine avec les anciens procédés, firent de
la routine avec les nouveaux. Les enfants de deux ans furent mis en présence de
nouveaux tableaux de lecture, ils apprirent des règles de grammaire, des
définitions d'histoire naturelle : c'était une nouvelle manière
d'atrophier leur intelligence, d'enrayer leur libre développement, et sans
aucun profit pour leur bonheur.
Quant au dressage matériel, inventé dès le
début, il faut croire qu'il avait pris racine, puisque beaucoup des procédés
d'autrefois sont encore en honneur aujourd'hui, puisque dans un grand nombre
d'écoles les enfants montent encore au gradin avec le cérémonial d'il y a vingt
ans, puisqu'ils sont encore soudés les uns aux autres pour le bon ordre,
puisqu'ils marchent, se lèvent et s'assoient au claquoir ; et puisqu'on n'a pas
encore essayé de faire appel à leur initiative personnelle.
Certes il y a des progrès et des progrès
sensibles de l'école-garderie à la salle d'asile peu à peu transformée; mais ce
sont des progrès de détail; certains procédés surannés ont fait place à des
procédés nouveaux, mais le fond est resté le même, puisque l'intelligence de
l'enfant y est encore opprimée par un enseignement prématuré.
Aussi a-t-on cherché, creusé, fouillé
encore cette question si délicate, et les dernières études ont amené la
réorganisation de la salle d'asile sur de nouvelles bases. Un nouveau programme
a été élaboré ; il débute ainsi :
« L'école maternelle n'est pas une école.
Elle doit imiter le plus possible les procédés d'une mère intelligente et
dévouée. La méthode doit être essentiellement familière, toujours ouverte à de
nouveaux progrès, toujours susceptible de se compléter, de se réformer. »
Autant d'idées, autant de perles fines,
pour qui saura apprécier ces nouvelles bases de l'école maternelle. Enfin!
l'école maternelle va s'inspirer du seul modèle qui puisse lui être utile !
Ses auteurs ont dit : « Puisque l'école maternelle doit remplacer la
famille, demandons à la famille comment elle procède ».
Et ainsi nous touchons au but.
Oui… Nous toucherions au but si les
directrices s'inspiraient bien plus des idées générales du programme que du
programme spécial annexé à la circulaire, si elles en prenaient tout l'esprit
et en laissaient la lettre autant que possible. C'est qu'en effets, d'une part,
l'esprit veut que l'école maternelle soit
la famille agrandie, d'autre part la lettre
du programme spécial en fait une école presque scientifique, qui peut être
excellente ou déplorable suivant le degré de culture, le tact, le sens
pédagogique de la directrice.
Encore une fois,- et ce ne sera sans doute pas la dernière, – jetons
un coup d'œil sur une famille dans des conditions normales, c'est-à-dire une
famille dont le chef est ce que l'on appelle le « ministre de l'extérieur »,
occupé hors de chez lui tout le jour, tandis que la mère, « ministre de
l'intérieur », s'occupe de l'administration du ménage et de l'éducation des
enfants.
L'enfant bouge et s'occupe. Il s'occupe à
jouer. Le jeu, c'est le travail des enfants. Tous les éducateurs dignes de ce
nom l'ont affirmé. C'est le titre de gloire de Frœbel.
Pour s'occuper, il faut que l'enfant ait à
sa disposition des objets matériels. Celui qui marche à peine pousse devant lui
une chaise qui le soutient; son aîné fait de la sienne un cheval improvisé;
puis il y a les jouets, les vrais, depuis le hochet à grelots du bébé que l'on
porte sur les bras, jusqu'au jeu de dominos avec lequel le doyen de cinq ans
apprend à compter jusqu'à douze. Non seulement il y a les jouets des chambres,
mais il y a ceux des jardins. Les jouets,
les ustensiles du ménage, c'est le matériel scolaire de la mère de famille. Ils
doivent composer aussi le matériel scolaire des petits à l'école maternelle. Et
c'est en effet un matériel éducatif, puisque chacun des objets qui le composent
sert au développement physique et intellectuel de l'enfant qui l'a à sa portée.
Le petit qui s'appuie sur la chaise comprend que sans elle il roulerait par
terre ; celui qui a fait un cheval de la sienne a exercé d'abord sa faculté de comparaison,
puis sa faculté d'imitation. Les quatre pieds de la chaise lui rappellent les
quatre jambes du cheval, et, s'il se met dessus à califourchon, au lieu de
s'asseoir, c'est pour faire comme les cavaliers qu'il a remarqués dans la rue
ou sur la route. Il parle à ce cheval, comme la petite fille parle au morceau
de chiffon qui lui sert de poupée, et la mère intervient dans cette
conversation.
Au jardin, avec les billes, les quilles,
les ballons, le sable, que de facultés sont en jeu ! Quelle leçon bonne et
saine et profitable dans un mot dit à
propos ! Nous soulignons cette expression « à propos », car la leçon ne
porte que quand elle entre dans les vues du petit enfant, quand elle arrive au
bon moment, quand elle est opportune. Appeler sur un arbre l'attention d'un enfant
qui joue au cheval, c'est du temps perdu; on lui parle branches et feuilles, il
répond jambes et queue. L'enseignement, pour être fécond, ne doit pas
transporter l'élève dans un ordre d'idées qui lui est étranger, il ne doit lui
causer aucune fatigue intellectuelle. Le jeu, le jeu surveillé, le jeu guidé, est
un travail suffisant pour l'enfant de la deuxième section de l'école
maternelle.
Cependant, le programme officiel porte 1° les premiers principes d'éducation morale.
C'est vrai; mais, lorsque la directrice lavera l'enfant malpropre et qu'elle
lui suggérera par cela même l'idée de la propreté; quand elle l'amènera à
rendre un jouet arraché à un petit camarade; quand elle stimulera son activité;
quand elle lui inspirera un sentiment de tendresse ou de confiance, elle aura fait de l'éducation morale.
A l'article 2 du programme nous trouvons
les exercices de langage. Et en effet
vous faites dire à l'enfant « la bille », « le cheval », « le ballon », « le sable
». Puis, « la bille est ronde » ; «
le cheval a quatre jambes, une queue » ; « je lance le ballon » ;« la
fourmi est toute petite » ; « le sable est fin » ; « lesable est sec
» « le sable est mouillé ».
Peu à peu les propositions s'enchaînent en
phrases, les phrases se lient en périodes : l'enfant pense et parle.
A l'article 3, les leçons de choses : un des exercices les moins compris. La
leçon de choses, pour l'enfant, c'est le nom de l'objet qu'il a dans la main :
« la bille » ; c'est sa couleur « rouge, bleue ou blanche » ; c'est
sa forme : « ronde » ; c'est l'usage qu'on en fait : « on la
fait rouler ».
Mais ces leçons doivent naître
spontanément, au lieu d'être réglementées. C'est horriblement difficile ! dira-t-on.
Oui, si l'école maternelle ne fait pas absolument peau neuve, si les directrices n'oublient pas qu'elles se sont
crues des professeurs, alors qu'elles étaient des mamans.
Pourquoi avoir fait un règlement alors ?
C'est qu'il faut donner un corps aux idées;
c'est qu'on ne fonde rien avec des abstractions. Ce règlement précise; il
permet de passer de la théorie dans la pratique ; il dit aux directrices :
« Vous devez être des mamans ; l'enfant qui joue travaille; en jouant seul, il
développe son corps, son intelligence ; en jouant avec des camarades, il
développe son corps, son intelligence, son cœur. Il devient sociable. Or la sociabilité prise de haut, c'est de la morale ; la sociabilité implique la parole ; c'est l'exercice de langue maternelle. L'enfant qui trace
des lignes sur le sable ou sur l'ardoise dessine
; le dessin mène à l'écriture, l'écriture
à la lecture. En comptant les
cailloux qui servent de limite à son jardinet, les cubes qui lui servent à
construire une maison, l'enfant fait du calcul
; en faisant des hauteurs et des creux dans le sable, il fait de la géographie ; en regardant une fleur,
de la botanique ; en montrant
ses deux mains, ses deux yeux, sa bouche et ses cheveux, de la zoologie. C'est sa science à lui ; ce
sont ses études à lui ; il n'en doit pas connaître d'autre. »
Voir aussi l’article
« Maternelles (Ecoles) » de P. Kergomard dans le dictionnaire Buisson
de 1911 : http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3142
Le décret complet est
téléchargeable à http://amiens5.ia80.ac-amiens.fr/site/circo/histoire/bulldep/ec-mat.pdf
.
Écoles maternelles organisation, surveillance et
inspection - 2 août 1881 (décret)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
Vu l'article 57 de la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 27 février 1880, relative au Conseil supérieur
de l'Instruction publique ;
Vu les articles 1, 6 et 7 de la loi du 16 juin 1881, relative
à la gratuité de l'enseignement primaire ;
Vu l'article 2 de la loi du 16 juin 1881, relative aux titres
de capacité pour l'enseignement primaire ;
Décrète
TITRE PREMIER
Dispositions communes aux écoles maternelles publiques
et libres (organisation, surveillance et inspection).
Article
premier. – Les écoles maternelles (salles d'asile), publiques et libres, sont
des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes reçoivent les
soins que réclame leur développement physique, intellectuel et moral.
Les
enfants peuvent y être admis dès l'âge de deux ans accomplis et y rester
jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de sept ans.
TITRE II
Écoles maternelles publiques.
Art. 12. - Dans les écoles maternelles
publiques, les enfants seront divisés en deux sections, suivant leur âge et le développement
de leur intelligence.
ART. 13. - Les premiers principes d'éducation morale seront donnés dans les
écoles maternelles publiques, non sous forme de leçons distinctes et suivies,
mais par des entretiens familiers, des questions, des récits, des chants destinés
à inspirer aux enfants le sentiment de Jeurs devoirs envers la famille, envers
la patrie, envers Dieu. Ces premiers principes devront être indépendants de
tout enseignement confessionnel.
ART. 14. - Les connaissances sur les objets usuels comportent des explications
très élémentaires sur le vêtement, l'habitation et l'alimentation, sur les
couleurs et les formes, sur la division du temps, les saisons, etc.
ART. 15. - Les exercices de langage ont pour but d'habituer les enfants à parler
et à rendre compte de ce qu'ils ont vu et compris.
Les
morceaux de poésie qu'on leur fait apprendre seront courts et simples.
ART. 16. - L'enseignement du dessin comprend :
1°
Des combinaisons de lignes au moyen de lattes, bâtonnets, etc.;
2°
La représentation sur l'ardoise de ces combinaisons et de dessins faciles faits
par la maltresse au tableau quadrillé
3°
La reproduction sur l'ardoise des objets usuels les plus simples.
ART.
17. – La lecture et l'écriture seront, autant que possible,
enseignées simultanément.
Les
exercices doivent toujours être collectifs.
Art. 18. – L'enseignement du calcul comprend :
1°
L'étude de la formation des nombres de 1 à 10;
2°
L'étude de la formation des de 10 à 100;
3°
Les quatre opérations, sous la forme la plus élémentaire, appliquées d'abord à
la première dizaine.
4°
La représentation dès nombres par les chiffres
5°
Des applications très simples du système métrique (mètre, litre, monnaie).
Cet enseignement sera donné au moyen
d'objets mis entre les mains des enfants, tels que lattes, bâtonnets, cubes,
etc.
Les enfants seront exercés au calcul mental
sur toutes les combinaisons de nombres qu'ils auront faites.
ART. 19. - Les éléments d'histoire naturelle comprennent la
désignation des parties principales du corps humain, des notions sur les
animaux les plus connus, les végétaux et les minéraux usuels.
Cet enseignement est donné à l'aide
d'objets réels et de collections formées autant que possible par les enfants et
les maîtresses.
ART. 20. - L'enseignement de la géographie est descriptif;
il
s'appuie sur l'observation des lieux où vit l'enfant. Il comprend :
1°
L'orientation (points cardinaux)
2°
Des notions sur la terre et les eaux;
3°
Quelques indications sur les fleuves, les montagnes et les principales villes
de France.
ART. 21. Les récits porteront principalement
1°
Sur les grands faits de l'histoire nationale
2°
Sur des leçons de choses.
ART. 22. Les exercices manuels consisteront en tressage, tissage, pliage, petits
ouvrages de tricot.
Les travaux de couture et tous autres
travaux de nature à fatiguer les enfants sont interdits.
ART. 23. – L'enseignement du chant comprend :
Les
exercices d'intonation et de mesure les plus simples, les chants à l'unisson et
à deux parties qui accompagnent les jeux gymnastiques et les évolutions. Les
chants sont appropriés à l'étendue de la voix des enfants. Pour ces exercices, les
directrices se serviront du diapason.
ART. 24. Les exercices gymnastiques seront gradués de manière à favoriser te
développement physique de l'enfant. Ils se composeront de mouvements, de
marches, d'évolutions et de jeux, dirigés par la maîtresse.
ART. 25. --Les leçons ne devront jamais
durer plus d'un quart d'heure ou vingt minutes ; elles seront toujours
séparées par des chants, des exercices gymnastiques, des marches ou des
évolutions.
ART. 26. – Les conditions dans lesquelles
doivent être établies les écoles maternelles publiques, tant au point de vue
des bâtiments que de l'ameublement, seront l'objet d'un règlement spécial.
ART. 27. Le matériel d'enseignement de l'école maternelle comprend
nécessairement les objets suivants
Un
claquoir, un sifflet;
Un
ou plusieurs tableaux noirs, dont un au moins sera quadrillé;
Une
méthode de lecture en tableaux et plusieurs collections d'images
Un
nécessaire métrique;
Un
globe terrestre et une carte murale de la France;
Un
boulier;
Des
collections de bûchettes ou bâtonnets, des lattes, des cubes, etc.;
Une
collection de jouets
Des
ardoises, quadrillées d'un côté et unies de l'autre;
Un
diapason.
…………………………………………………………………………………..
PROGRAMME SPÉCIAL ANNEXÉ AU RÈGLEMENT
Premiers principes d'éducation morale. (Art. 13 du décret.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Soins
donnés aux enfants en vue de leur faire prendre de bonnes habitudes, de gagner
leur affection et de maintenir entre eux l'harmonie – Premières notions du bien
et du mal.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Causeries très simples, mêlées à tous les
exercices de la classe et de la récréation.
Petites poésies expliquées et apprises par
cœur. – Historiettes morales racontées et suivies de questions propres à en
faire ressortir le sens et à vérifler si les enfants l'ont compris. Petits
chants.
Soins particuliers de la maitresse à l'égard
des enfants chez lesquels elle a observé quelque défaut ou quelque vice
naissant.
Exercices de langage. (Art. 15 du décret.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Exercices
de prononciation.
Exercices
en vue d'augmenter le vocabulaire de l'enfant; petits exercices de mémoire
(chants, fables, récits); questions.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Exercices
combinés de langage, de lecture et d'écriture préparant à l'orthographe.
1° Exercices oraux. - Questions très familières
ayant pour objet d'apprendre aux enfants à s'exprimer nettement; corriger les
défauts de prononciation ou d'accent local.
2° Exercices de mémoire. – Récitation de
très courtes poésies.
3° Exercices écrits. – Premières dictées
d'un mot, puis de deux ou trois, puis de très petites phrases.
4° Lectures très brèves faites par la
maîtresse, écoutées et racontées par les enfants.
Leçons de choses. Connaissances sur les objets usuels.
Premières notions d'histoire naturelle.
(Art. 14 et 19 du décret.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Noms des principales parties du corps humain;
des principaux animaux de la contrée; des plantes servant à l'alimentation ou
les plus visibles pour l'enfant (arbres de la cour, de la route, fleurs familières,
etc.).
Nom et usage des objets qui sont sous les
yeux de l'enfant (objets servant au vêtement, à l'habitation, à l'alimentation,
au travail).
Etude des couleurs et des formes par des
jeux.
Notions sur le jour et la nuit.
Observations sur la durée (heure, jour,
semaine).
Le nom du jour, la veille, le lendemain.
Age de l'enfant.
L'attention des enfants est appelée sur les
différences du chaud, du froid, de la pluie, du beau temps.
Observations sur la saison, ses travaux,
ses productions.
Première éducation dès sens par de petits
exercices ; faire discerner et comparer par l'enfant des couleurs, des
nuances, des formes, des longueurs, des poids, des températures, des sons, des
odeurs, des saveurs.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Notions très élémentaires sur le corps humain
; hygiène (petits conseils) ; petite étude comparée des animaux que
l'enfant connaît, des plantes, des pierres, des métaux ; quelques plantes
alimentaires et industrielles ; pierres et métaux d'usage ordinaire.
L'air, l'eau (vapeur, nuage, neige, glace).
Petites leçons de choses, toujours avec les
objets mis sous les yeux et dans les mains des enfants. Exercices et entretiens
familiers ayant pour but de faire acquérir aux enfants les premiers éléments des
connaissances usuelles (la droite et la gauche – noms des jours et des mois; –
distinction d'animaux, de végétaux, de minéraux; - les saisons) et, surtout, de
les amener à regarder, à observer, à comparer, à questionner et à retenir.
Pour l'ordre à suivre dans ces leçons, on
essayera de combiner, toutes les fois qu’on le pourra, en les rattachant à un
même objet, la leçon de choses, le dessin, la leçon morale, les jeux et les
chants, de manière que l'unité d'impression de ces diverses formes d'enseignement
laisse une trace plus durable dans l'esprit et le cœur des enfants. On
s'efforcera de régler, autant que possible, l'ordre des leçons parl ordre des
saisons, afin que la nature fournisse les objets de ces leçons et que l'enfant
contracte ainsi l'habitude d'observer, de comparer et de juger. Les indications
ci-dessous pourront guider la maîtresse dans le choix des sujets de leçons :
(Ce programme, en majeure partie
emprunté à un travail de M. l'inspecteur général Cadet, a été adopté par le
Conseil supérieur de l'instruction publique, à titre d'indication utile aux maîtresses.)
OCTOBRE
LEÇONS
DE CHOSES
(Récits,
causeries, questions, autant que possible avec les objets montrés aux enfants.)
La vendange. - Vigne, raisin, vin. - Cuve, tonneau, bouteille,
verre, bouchons, litre. - Pommes, cidre. – Houblon, bière.
DESSIN
(Dessins
au trait faits au tableau noir par la maîtresse; on ne fera reproduire par les
élèves que ceux de ces dessins qui seraient assez simples et assez faciles pour
trouver place dans le petit cours de dessin tel que le règle le programme :
grappe de raisin, feuille de vigne, pressoir, cuve, tonneau, bouteille, verre,
entonnoir, litre.)
CHANTS
ET JEUX
(à
faire exécuter par les enfants)
L'Automne.
(Delbrück.)
Le
Tonnelier.
NOVEMBRE
LEÇONS
DE CHOSES
Le labourage. - Charrue, herse.
L’éclairage. - Chandelle, bougie, lampes, gaz. - Phare.
DESSIN
Soc
de charrue, herse.
Chandelier,
bougeoir, lampe, bec de gaz, phare.
CHANTS
ET JEUX
Le
Labour. - Les semailles.
(Mme
Pape-Carpantier.)
DÉCEMBRE
LEÇONS
DE CHOSES
Le chauffage. – Froid, neige, glace, avalanches; Suisse, Alpes;
patins, traîneaux. –Thermomètre ; poêle, cheminée. - Bois, charbon,
allumettes. - Engelures, rhume. – Le foyer, la famille.
DESSIN
Patin,
traineau, thermomètre, poêle, cheminée, soufflet, pelle, pincettes, pompe à
incendie.
CHANTS
ET JEUX
Le
Petit Ramoneur. (Mme Pape-Carpantier.)
Le
Feu (Delbrück.)
JANVIER
LEÇONS
DE CHOSES
La nouvelle année. – Mouvement de la terre autour du soleil,
Compliments,
étrennes; charité.
Oranges,
marrons.
L'habillement. – Fonrrures, couvertures, édredon, laine, coton,
drap, flanelle, tissage, filage, teinture, épingles, aiguilles.
DESSIN
Sphère,
oranges, marrons, tirelire, ciseaux, mètre à ruban.
CHANTS
ET JEUX
L'Hiver.
Souhaits de bonne année. (Delbrûck.)
Les
Petites Tricoteuses. (Delcasso.)
FÉVRIER
LEÇONS
DE CHOSES
Le corps humain. Principaux organes des sens.
L'alimentation. Mets et boissons; boulanger, boucher, fruitier, épicier
faim, appétit, indigestion.
DESSIN
Oeil,
oreille, nez, main.
Fourneau,
casserole, poêle, chaudron, marmite, bouilloire, gril.
CHANTS
ET JEUX
La
Gymnastique. (Lainé.)
Le
Pain. (Delbrück.)
MARS
LEÇONS
DE CHOSES
L'habitation. Bois, pierre, fer, briques; ardoise, plâtre, chaux; tuile,
chaume. – Diverses industries du
bâtiment.
Les abeilles. – Ruches, cellules, cire, miel.
DESSIN
Maison,
fenêtre, porte; table, lit, chaise, armoire, commode; mur, rangées de pierres
de taille, de briques; plan d'une maison, charpente ; marteau, scie,
tenailles; équerre, compas, fil à plomb, auge, truelle.
CHANTS
ET JEUX
Les
Petits Ouvriers. – La Ronde des abeilles. (Mme Pape-Carpantier.)
AVRIL
LEÇONS
DE CHOSES
La végétation. - Graines, racines, tige, fleurs, etc.
Les nids d'oiseaux. – Services que nous rendent les oiseaux, hirondelles ;
chenilles, insectes, hannetons ; vers à soie.
DESSIN
Fleurs,
feuilles, haricots, pois, pommes de terre.
CHANTS
ET JEUX
Le
Printemps. (Delbrück.)
Le
Ver à soie. (Mme Pape-Carpantier.)
MAI
LEÇONS
DE CHOSES
L'eau. - Ruisseau, rivière, fleuve, mer marée, bains froids, natation.
La pêche. – Poissons de mer et poissons d'eau douce.
Le blanchissage. – Savon, propreté.
DESSIN
Baignoire.
Bateau,
hameçon, filet, ligne, poisson.
Baquet,
pompe, fontaine, puits, battoir.
CHANTS
ET JEUX
Vivo
l'eau! (Delbrück.)
Les
Bourgeois de Provence (ronde).
JUIN
LEÇONS
DE CHOSES
La ferme. – La fenaison; cheval, âne, chien de berger, loup,
mouton, porc; dindon, poule, oie, canard, pigeon; laiterie, lait, beurre, fromage.
DESSIN
Terrine,
baratte, boîte au lait, litre.
CHANTS
ET JEUX
Le
Petit Berger. La Fenaison. (Delcasso)
JUILLET
LEÇONS
DE CHOSES
L'orage. - Éclair, tonnerre, grêle, vent, paratonnerre,
arc-en-ciel.
Les fruits. - Cerises, fraises, abricots, poires, pommes, prunes.
DESSIN
Maison,
paratonnerre, arc-en-ciel; parapluie.
Bouquet
de cerises; abricots, poires, pommes, prunes.
CHANTS
ET JEUX
L'Été.
La Marchande de frnits. (Delbrück.)
AOÛT
LEÇONS
DE CHOSES
La moisson. - Blé, orge, avoine, farine, pain, pâte, four,
boulanger, pâtissier.
Les voyages. – Routes, chemins de fer, bateaux à vapeur; cartes, points
cardinaux, boussole, aimant; Christophe Colomb; races d'hommes, la patrie, le
monde.
DESSIN
Gerbe,
épi de blé; faux, faucille; moulin à vent, paire de meules, balance, poids.
Locomotive,
rails, bateau à voile, à vapeur, rames, gouvernail, boussole.
CHANTS
ET JEUX
Le
Jeu du blé. (Mme Pape-Carpantier.)
La
Ronde du tour du monde.
SEPTEMBRE
LEÇONS
DE CHOSES
La chasse. – Chevreuil, cerf, sanglier, loup, renard, lièvre,
lapin, perdrix, alouette, caille; fusil.
La fête du village. - Foire, boutique, feu d'artifice, poudre ;
guerre, commerce, monnaie.
DESSIN
Cor
de chasse, carnassière, fusil; monnaies.
CHANTS
ET JEUX
Le
Renard. (Delcasso.)
Dessin, Écriture, Lecture. (Art. 16 et 17 du décret.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Jeux
de cubes, de balles, de lattes, etc.
Mosaïques.
Explication
d'images très simples (animaux, objets usuels).
Petites
combinaisons de lignes au moyen de bâtonnets.
Représentation
sur l'ardoise de ces combinaisons; description d'objets usuels.
Aucun
exercice de lecture proprement dite.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Combinaisons de lignes ; représentation
de ces combinaisons sur l'ardoise et le papier au crayon ordinaire ou en traits
de couleur; petits dessins d'invention sur papier quadrillé; reproduction de
dessins très simples faits par la maitresse.
Représentation d'objets usuels les plus
simples.
Premiers exercices de lecture.
Premiers éléments d'écriture.
Lettres, syllabes et mots.
Calcul. (Art. 18.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Familiariser l'enfant arec les termes: un
deux trois, quatre, cinq, moitié, demie ; l'exercer à compter jusqu'à 10.
Calcul mental sur les dix premiers nombres.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Premiers éléments de la numération orale et
écrite. Petits exercices de calcul mental. Addition et soustraction sur des
nombres concrets et ne dépassant pas la première centaine.
Étude des dix premiers nombres et des
expressions demie, moitié, tiers, quart.
Les
quatre opérations sur des nombres de deux chiffres.
Le mètre, le franc, le litre.
Géographie. (Art. 20.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Demeure
et adresse des parents, nom de la commune. Petits exercices sur la distance ;
situation relative des différentes parties de l'école.
La
terre et l'eau.
Le
soleil (le levant et le couchant).
Causeries
familières et petits exercices préparatoires servant surtout à provoquer
l'esprit d'observation chez les petits enfants, en leur faisant simplement remarquer
les phénomènes les plus ordinaires, les principaux accidents du sol.
Récits, Histoire nationale. (Art. 21.)
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Anecdotes,
récits, biographies tirée de l'histoire nationale; contes, récits de voyages.
Explication d'images.
Exercices manuels. (Art. 22.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Jeux
Petits
exercices de pliage, de tissage, tressage.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Pliage,
tissage, tressage, combinaisons en laines de couleur sur le canevas ou le
papier; petits ouvrages de tricot.
Chant. (Art. 23.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Chants
à l'unisson, très simples.
Petits
exercices.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Chante
à l'unisson et à deux parties, exclusivement appris par l'audition.
Gymnastique (Art. 24.)
SECTION
DES PETITS - ENFANTS DE 2 A
5 ANS
Jenx
libres et marches.
Évolutions,
mouvements gradués.
Soins
d'hygiène et de propreté.
SECTION
DES ENFANTS - ENFANTS DE 5 A
7 ANS
OU
CLASSE ENFANTINE
Jeux,
marches, évolutions, mouvements, exercices gradués.
Autre chose, avec le carré ou avec le carré long :
CHAPITRE IX
LE SECTIONNEMENT
Le sectionnement. - Comment on sectionne. - Les petits et la femme de
service. - Les petits sacrifiés. - Les locaux ne sont pas conformes au nouveau
règlement. - Il faut se montrer industrieuses. - Occupations des petits. –
Dessin. - Construction. - Exercices
manuels. - Pliage. - Cailloux. - Piquage, tressage, parfilage. - II faut
chanter pour les petits. - Le langage maternel. - Il faut apprendre à bien
penser pour apprendre à bien parler. - Les images. – Celles qu'il faut choisir.
- Comment se servir de l'image. – La méthode doit être vivifiée par l'esprit. -
Un des procédés qui ankylosent la pensée. - Les exercices de mémoire. – Il faut
savoir parler avant d'apprendre à lire.
« Dans les écoles maternelles publiques,
les enfants seront divisés en deux sections, suivant leur âge et le
développement de leur intelligence. »
Les directrices ont trop souffert de la
difficulté insurmontable qu'il y a à garder ensemble, à occuper, à intéresser
en même temps un nombre considérable d'enfants (la dernière statistique relève
une moyenne de 126 enfants par école ; un nombre considérable d'écoles en
ont de 200 à 350 ; beaucoup en ont 400 ; il y en a de 500, de 700 ! (Morlaix),
de 1100 (Nice) ; les directrices ont, dis-je, trop souffert pour n'avoir pas applaudi
à cet article du programme du 2 août 1881.
Chose étonnante beaucoup cependant n'en ont
pas profité, et un très petit nombre seulement l'ont fait d'une façon
judicieuse.
Il y a des cas - je le reconnais - où c'est
tout à fait impossible : c'est lorsqu'il n'y a qu'une seule maîtresse.
Mais l'État, qui a décidé le sectionnement, ne peut pas vouloir que le premier
article reste lettre morte, car cet article non exécuté annihile tous les autres.
Quant aux municipalités, elles ont tout à gagner à mettre leurs écoles en
règle. Lorsqu'elles ne le font pas, je crois que c'est plutôt par négligence que
par mauvaise volonté; elles dorment encore sur l'ancienne garderie,… ce qui
donnerait à penser qu'elles ont le sommeil dur.
Le plus souvent, il y a deux maîtresses
dans l'école, et cependant celle-ci n'est pas sectionnée dans le sens du
règlement ; quelques bébés marchant à peine, ne parlant pas, restent avec
la femme de service ; tous les enfants et les deux maîtresses sont ensemble, se
gênant mutuellement. En ce cas, les directrices objectent presque toujours leur
local mal approprié. Certes ! neuf fois sur dix, le local, plus ou moins
conforme au règlement des salles d'asile, n'est pas conforme à celui des écoles
maternelles, mais c'est le cas d'être industrieuses. Il y a des personnes qui savent
se faire honneur d'une fortune modeste ; il y a des femmes qui, avec quelques
mètres d'une étoffe de peu de valeur, savent se faire un costume qui les pare ;
il y a des directrices qui savent tirer parti d'un local défectueux.
Le préau couvert – et il y en a presque
toujours un - doit servir de seconde salle, et, dans les beaux jours, la cour
ou le jardin doit être utilisé pour le plus grand bien des enfants.
Mais il y a une autre manière de sectionner
que je trouve aussi mauvaise que celle dont j'ai parlé tout d'abord; elle est
ainsi pratiquée :
1° Les tout petits qui savent à peine
parler, à peine marcher;
2° Ceux de trois à quatre ou cinq ans dans
la salle d'exercices, meublée de gradins et de tables, et y recevant des leçons
sur toutes les parties du programme
3° Les grands,
ceux de cinq et six ans, dans la troisième salle, que nous appellerons la
classe, parce que, malheureusement, c'est une classe et pas autre chose.
Donc, avec ces trois sections, nous nous trouvons
en présence d'un établissement comprenant la crèche - très mauvaise crèche,
parce qu'elle n'est pas installée en crèche – et une école à deux classes.
Le cœur et la raison protestent contre cet
ordre de choses, contre cette éducation de l'enfant (élevage eût été un mot plus juste) en dehors des conditions normales,
et je me sens, chaque jour, plus invinciblement entraînée à le placer ou à le
laisser dans son milieu, où il se développe, au lieu d'aider à lui créer un
milieu factice où il s'étiole.
Dans les écoles maternelles non sectionnées
et dans les écoles maternelles mal sectionnées, les petits sont toujours dans de
mauvaises conditions d'éducation physique et morale, soit qu'ils soient mêlés
dans la salle d'exercices avec leurs camarades plus âgés – qui sont eux-mêmes
placés dans des conditions plus que contestables - et associés à leurs
exercices, soit qu'on les garde dans un local séparé. Dans le premier cas, en
effet, ils sont soumis à une discipline absolument contraire à leur développement;
dans le second cas ils sont privés des bénéfices qu'apporte aux plus petits la
vie passée avec de plus grands. Il est incontestable que, dans la famille, le
second enfant s'élève plus facilement que le premier, parce qu'il profite de
l'acquis de celui-ci. Quelque soit le dévouement, le génie même de la mère, il
y a, malgré tout, bien loin d'elle à son enfant; entre pairs, au contraire,
l'échange est tout naturel, et l'aîné y gagne tout autant que le plus jeune.
Tous les prétextes sont bons pour tenir les
pauvres petits dans des conditions mauvaises. S'il n'y a qu'une directrice,
elle considère comme son devoir strict de s'occuper des plus grands, de ceux «
qui peuvent apprendre » ; s'il y a une adjointe, elle aide à s'occuper des
grands, et les petits sont encore sacrifiés. Cependant la femme de service peut
avoir toutes les qualités du monde, mais il lui en manque une indispensable
pour la tâche qu'on lui impose. N'ayant pas été cultivée, elle ne peut donner ce
qu'elle n'a pas reçu. Elle garde les enfants. En les gardant, elle leur parle
un français… de sa façon, quand elle ne leur parle pas le patois de la région;
elle les laisse manger… comme on mange dans le milieu où elle a toujours vécu;
elle les nettoie… superficiellement; elle les mouche… avec leur tablier, c'est-à-dire
qu'en ce cas l'école continue les traditions des familles non cultivées, avec
cette aggravation que la pauvre femme, dans l'impossibilité d'occuper les
enfants, et se croyant obligée de les tenir
sages, – puisqu'on est à l'école -
exige que les malheureux soient assis sur les bancs, où ils s'étiolent.
Les petits sacrifiés !... mais c'est
un crime !...
Dans la famille, c'est le « petit qui est
l'objet de la sollicitude attendrie, non seulement des parents, mais de la sœur,
mais du frère aîné. Si ce « petit », au lieu d'être fort et bien venant, est
chétif et frêle, sa mère multiplie et affine ses soins; si son intelligence est
paresseuse, elle s'efforce de l'éveiller; si son cœur paraît manquer
d'expansion, elle le réchauffe par ses caresses. Une école maternelle où le «
petit » est une sorte de quantité négligeable usurpe son titre.
Qui donc s'occupera de cette séduisante
section des petits, dans l'école maternelle sectionnée d'après le règlement,
c'est-à-dire dans celle où la première section sera composée d'enfants de 2 à 4
ou 5 ans, et la seconde d'enfants de 5 à 7 ? L'adjointe, un jour sur deux. Et la directrice ? J'allais dire deux
jours sur un, mais on m'aurait objecté que j'ignore le pont aux ânes. La
directrice et l'adjointe doivent s'en occuper chacune à son tour, soit tous les
deux jours, soit l'une le matin, l'autre le soir.
Et voici pourquoi.
L'adjointe qui donnerait tout son temps aux
petits ne s'initierait qu’à la moitié de sa tâche future. Spécialisée avec les
uns, elle serait tout inexpérimentée avec les autres, le jour où elle
deviendrait directrice elle-même; d'autre part, comme il faut d'autant plus de
culture et d'expérience à l'éducatrice que l'enfant à diriger est plus petit,
la place de la directrice est auprès d'eux. Si elle ne leur donne pas, au moins, la moitié de son temps, elle
laisse de côté la partie la plus importante de son devoir; elle se prive de la
part la plus honorable de sa fonction; elle renonce à des joies de l'ordre le
plus élevé.
Cela dit, tâchons d'entrer dans la
pratique.
L'application du règlement, en ce qui
concerne les deux sections, réclamerait tout de suite une installation
nouvelle. Mais une école, c'est comme Paris, cela «ne se bâtit pas en un jour»,
et nous tâcherons – en attendant mieux – de nous contenter de ce que nous
avons.
Du préau couvert, nous allons faire la
salle des petits; la salle d'exercices actuelle deviendra celle des plus
grands, avec cette restriction, que ce qu'on appelle la « classe » pour les
enfants des deux sections est une invention barbare, qu'elle doit être considérée
comme le « pis-aller », comme l' « accident », et que le jardin et la cour
doivent être 1' « habitude ».
Occupons-nous des petits. Que leur
ferons-nous faire?
Ah ! il s'agit d'abord de les laisser
s'ébattre (la question du jeu libre a été traitée à l'article Éducation), puis de diriger leurs jeux
et leurs mouvements de manière à rendre ces jeux et ces mouvements profitables
au développement normal de leurs forces.
Ils feront « des exercices gymnastiques
gradués, des mouvements, des marches, des évolutions et des jeux, dirigés par
la maîtresse ».
Très bien mais à une condition : c'est
que, dans chacun de ces exercices, chaque enfant sera un être indépendant de
son voisin, ayant sa liberté d'allures et, par conséquent, sa responsabilité,
au lieu d'être l'un des rouages inconscients d'un mécanisme plus ou moins
compliqué, une espèce d'automate se mouvant au bruit martelant et ininterrompu
du claquoir.
Cela veut dire qu'ils ne marcheront plus
soudés les uns aux autres par les épaules, que le chef de file ira droit devant
lui, au lieu de marcher à reculons, qu'on ne saluera pas à chaque instant les
murailles, que les enfants ne se salueront pas comme des polichinelles dont on
tire la ficelle, que marcher en cadence ne sera plus synonyme de marcher
lourdement, que chaque pas devra être le résultat d'un mouvement franchement
accentué de la jambe en avant, et non le piétinement sur place, que chaque
mouvement, en un mot, concourra à donner de la force, de l'élasticité, de la
grâce aux membres.
Dans cette section des petits, les
directrices donneront les ardoises tous les jours; ceci est encore une innovation
pour beaucoup de localités. Jusqu'ici, eneffet, on pensait toujours que
l'enfant était trop petit pour qu'on lui mît entre les mains une ardoise et un crayon,
- à moins que ce ne fût pour écrire des chiffres – tandis qu'on le croyait
toujours assez grand pour subir un enseignement abstrait.
« Notre école maternelle » change tout
cela. Elle agit en mère de famille. Or que fait une mère de famille quand son
enfant oisif devient difficile à amuser, qu'il la tracasse, qu'il l'empêche de
travailler elle-même?
Elle lui donne un crayon et du papier, ou
un crayon et une ardoise, et lui dit :
« Dessine et laisse-moi tranquille »
Donnez tous les jours des ardoises aux plus
petits; dans les premiers temps ils y feront des barbouillages informes, puis
viendront des animaux monstrueux, des paysages où les moutons seront plus grands
que la ferme; mais peu à peu, si l'on fait naître et si l'on stimule en eux
l'esprit d'observation, on verra les objets prendre tournure, les petits
artistes s'extasier devant leurs œuvres, et nous-mêmes nous serons étonnés des
résultats obtenus par ces bambins.
Il est absolument logique, d'ailleurs, que
l'enfant dessine avant d'écrire. Le dessin est concret; une maison représente
vraiment une maison; l'écriture, au contraire, est abstraite; ce n'est que
conventionnellement qu'un a
représente un son plutôt qu'un autre.
Quand les enfants auront assez dessiné, -
les directrices, comme les mères, savent que les enfants ont bientôt assez de
chaque chose - ils bougeront. Quand ils auront bougé et assez bougé, quand ils
se seront détendus, ils recevront des cubes et des bâtonnets. Mais il ne
s'agira pas de leur parler d' « arêtes », de « surfaces rectangulaires », de «
lignes parallèles », d'« angles obtus », il faudra simplement les engager à
élever des colonnes, à construire des maisons, des ponts, à placer des rails de
chemins de fer, d'ailleurs ils le feront d'eux-mêmes.
Quoi encore ? Du tissage, du pliage, du
parfilage, tous ces petits exercices manuels qui ont donné jusqu'ici de si bons
résultats dans les écoles maternelles des pays étrangers, et que nous avons si
complètement négligés, après en avoir d'abord mal expérimenté quelques-uns, et
après en avoir fait servir quelques autres à une quasi-exploitation de
l'enfant.
Personne n'ignore, en effet, que dans les anciennes garderies, pendant que les garçons étaient oisifs, le tricot était la base, les assises et le couronnement de l’instruction des filles ; et que, dans certaines provinces où s'exercent des industries spéciales aux femmes, tricot, broderie, filet, dentelle, les enfants des salles d'asile étaient astreints toute la journée au trvail manuel, machinal, et devaient fournir quotidiennement une tâche rémunératrice pour leurs parents, voire même pour la directrice, dans des cas très exceptionnels, j'aime à le penser.
Personne n'ignore, en effet, que dans les anciennes garderies, pendant que les garçons étaient oisifs, le tricot était la base, les assises et le couronnement de l’instruction des filles ; et que, dans certaines provinces où s'exercent des industries spéciales aux femmes, tricot, broderie, filet, dentelle, les enfants des salles d'asile étaient astreints toute la journée au trvail manuel, machinal, et devaient fournir quotidiennement une tâche rémunératrice pour leurs parents, voire même pour la directrice, dans des cas très exceptionnels, j'aime à le penser.
En présence de cette exagération ou de
cette exploitation immorale et inhumaine de l'enfant, et de la difficulté de
constater les délits, les amis de l'enfance avaient demandé la suppression des
« travaux » manuels.
C'était se priver d'un élément précieux
d'éducation et de discipline.
L'enfant naît actif; nous devons fournir
des aliments à son activité. L'enfant naît maladroit, n'ayant ni la rectitude
de l'œil qui permet de calculer les distances, ni la sûreté de mouvement qui
dirige sans hésitation vers les objets, ni l'agilité des doigts, conquête de l'habitude.
Remarquez un bébé à qui l'on demande – cela arrive tous-les jours – un morceau
du bonbon qu'il mange. Ce n'est qu'après plusieurs essais infructueux, ce n'est
que parce qu'on l'y aide, qu'il arrive à l'approcher des lèvres de celui qui le
lui a demandé.
La rectitude de l'œil, la sûreté des
mouvements, l'agilité des doigts, l'esprit d'arrangement, le goût s'acquièrent
par l'éducation. L'école maternelle a le devoir de les éveiller, de les
développer. Pour cela, elle a des procédés : le dessin et les exercices manuels.
Nous avons déjà parlé du premier, sur lequel nous aurons certainement à
revenir; occupons-nous maintenant des seconds.
Mais, parmi les travaux manuels, encore
faut-il choisir. Les uns sont pratiques pour les tout petits, les autres ne le
sont pas (la couture et le tricot, par exemple; on les avait même proscrits de
la section des grands, où ils seront de nouveau accueillis, je l'espère…).
En inscrivant les exercices manuels au
programme, la commission a entendu qu'ils n'auraient pas un but exclusif, mais
qu'ils devaient concourir à la culture générale. De même que l'enseignement
intellectuel se propose d'aider à l'éclosion des bons germes; et non de charger
les enfants d'un bagage scientifique trop lourd pour eux, de même les exercices
manuels ont pour but, non pas de faire ourler des mouchoirs et de faire tricoter
des bas, mais de faire l'éducation de l'œil et des doigts, l'éducation du goût,
et d'amener progressivement l'enfant de la copie
à l'invention.
Les garçons ont, comme les filles, droit à
cette éducation. On doit la leur donner en commun à l'école maternelle. Les
petits doigts que l'on y exerce deviennent adroits pour attacher les bottines,
pour nouer une cravate, pour boutonner des manches; ils réussissent à recouvrir
un livre, à attacher à un tuteur la plante que son poids courbait vers la
terre, à tailler un crayon, toutes choses également utiles aux enfants des deux
sexes. Plus tard, chacun utilisera l'habileté de ses doigts pour ses
occupations spéciales.
LE PLIAGE
Le pliage est un élément éducatif trop
méconnu, regardé comme un jeu sans valeur, et par conséquent fort peu employé
dans une trop grande quantité de nos écoles maternelles. Il favorise cependant
le développement intellectuel, et il occupe et intéresse l'enfant en lui
mettant dans les doigts une chose qu'il transforme lui-même.
Tout le monde devrait connaître la manière
de procéder. L'enfant, ayant entre les mains un carré de papier, le plie en
deux. Ah! le carré n'est plus carré, c'est un rectangle ou carré long. Beaucoup de choses autour de lui ont la
forme rectangulaire, de même que beaucoup sont carrées. Il y a, par exemple, son
mouchoir de poche et son ardoise. Il comparera. Plié en deux, le rectangle
redeviendra carré; les coins abaissés de ce carré donneront des triangles :
c'est de la géométrie palpable.
Mais, je vous en prie, mes chères
lectrices, ne vous attardez pas à la géométrie ! Le morceau de papier carré
intéressera surtout l'enfant quand il représentera son mouchoir de poche; le
rectangulaire, son ardoise; le triangulaire, le pignon de la maison. Faites-lui
faire des cornets qui ne s'appelleront cônes
qu'accidentellement ; et exercez-le à faire des pochettes, des salières,
des bateaux, des cocotes qui seront des pochettes,
des salières, des bateaux, des cocotes. L'invasion de la géométrie et de la philosophie,
l'invasion de la synthèse et de l'analyse, l'invasion de la méthode qui, techniquement, part du concret pour arriver
à l'abstrait, l'invasion de l'esprit allemand, en un mot, dans nos écoles
maternelles, m'effraye et me désole. Il y a peu de jours, je montrais à un
enfant un seau, très bien dessiné par la directrice sur un tableau noir, et je
voulus lui faire nommer l'anse de ce seau. « C'est une ligne courbe », me
répondit-il, et je n'ai jamais pu lui faire nommer l'anse. J'ai fait cette expérience
deux fois dans la même journée, dans deux écoles différentes, et deux fois j'ai
obtenu le même résultat. Représentez-vous ces mêmes enfants jouant au sable, et
disant à un camarade Prends le seau par la ligne courbe. Comme cela est
ridicule !
Quoi ! l'intelligence claire et vivante de
nos petiots, leur facilité d'assimilation et d'appropriation, leur imagination
brillante, toute cette charmante poésie naturelle à l'enfance seraient
condamnées à passer sous la toise géométrique, à s'emboîter sans rémission dans
le rail horizontal! Un bambin appellerait un mât de cocagne une ligne
verticale, et un tambour un « cylindre » ! Devant une montagne neigeuse, au lieu
d'être saisi, ému par la grandeur du spectacle, charmé tout au moins par les
jeux de la lumière sur la neige, il serait surtout frappé par là forme et
s'écrirait : « Oh ! le beau cône tronqué ! » En présence de la mer
écumeuse, il verrait seulement le sens horizontal des vagues! Oh! ne commettons
pas un crime de lèse-patriotisme qui serait en même temps un crime de
lèse-humanité ! Restons Français!
La pratique de ce modeste pliage est, j'en
conviens, plus difficile qu'on ne le pense, et je ne suis pas étonnée, pour ma
part, que beaucoup de directrices se soient laissé décourager.
Ceux qui en ont fait un article du
règlement se souvenaient d'avoir confectionné dans leur enfance des bateaux et
des porte-monnaie en papier; des souvenirs plus récents leur rappelaient leurs
enfants faisant aussi des porte-monnaie et des bateaux, et ils ne doutaient pas
que ce qu'ils avaient fait eux-mêmes, ce que leurs enfants avaient fait, ne pût
être obtenu dans les écoles maternelles. Ils n'oubliaient qu'une chose, - on
oublie souvent bien des choses quand on fait de la pédagogie en chambre, et je
suis du nombre des oublieurs : - c'est que la quantité d'enfants réunis
dans les écoles maternelles centuple toutes les difficultés.
Est-ce à dire qu'il faut renoncer au pliage
? Non, certes ! mais pour le pliage il faut procéder, comme pour tous les
autres articles du règlement, avec méthode ; il faut aller du simple au
composé, du plus facile au moins facile. Essayer de prime abord de faire faire
des bateaux, des porte-monnaie, des cocotes, c'est commencer la construction
par la charpente, c'est se créer des difficultés presque insurmontables et
toujours décourageantes.
Commençons donc par le commencement.
La directrice a-t-elle le matériel approprié
? Il consiste, vous le savez, en carrés de papier un peu fort, de diverses
couleurs, dont le cent se vend 50 centimes. Mais admettons que la municipalité
ait reculé devant cette petite dépense; la directrice préparera elle-même des
carrés de papier. Rien de plus simple. Une feuille de papier quelconque
représente en général un rectangle ou carré long. En abaissant le petit côté
sur le grand côté, on obtient :
1° Un triangle rectangle;
2° Un nouveau rectangle ou carré long plus
étroit que le premier.
On détache ce petit rectangle, en suivant
bien exactement la base horizontale du triangle; on dédouble le triangle, et
l'on a un carré parfait.
Ce carré obtenu, la première leçon
consistera à en faire compter les quatre côtés, à faire constater qu'ils sont
bien tous les quatre de même grandeur - ce qui se fait en appliquant
successivement chacun des quatre côtés sur l'un d'entre eux - et à faire
comparer ce carré à tout ce qu'il y a de carré dans la classe.
Le mouchoir de poche de l'enfant - disons,
en passant, qu'il faut que l'enfant ait un mouchoir dans sa poche - sera un
excellent point de comparaison.
Ce carré de papier posé sur l'ardoise
pourra être reproduit au crayon par l'enfant, qui en suivra les contours.
C'est assez pour une fois. Je suis même
persuadée que le quart d'heure réglementaire aura été dépassé. A ce sujet, je
voudrais persuader aux directrices qu'elles doivent avoir de l'initiative et
que, sans se laisser aller à des infractions graves contre le règlement, elles
ont plutôt à l'interpréter qu'à le suivre à la minute et à la seconde. Qu'elles
écourtent la leçon qui, sensiblement, fatigue les élèves; qu'elles s'attardent
un peu à celle qui les captive. A changer trop souvent et trop brusquement
d'exercices et d'ordres d'idées, les enfants s'énervent; ils me font, parfois, l'effet
de ces pauvres écureuils enfermés dans des cages tournantes : ils
tournent, tournent sans cesse. L'essoufflement intellectuel est dangereux.
J'en reviens à mon carré de papier. La
seconde leçon consistera à le faire plier en deux parties égales. Ce n'est pas si facile qu'on pourrait le
croire, et il faudra y revenir plusieurs fois pour les mains inexpérimentées,
prendre les enfants par groupes, ne pas permettre qu'il y en ait un dans le
nombre pour lequel le temps ait été perdu.
Ce carré plié en deux parties égales est-il
resté carré ? Comptons les côtés il y en a encore quatre. Mesurons ces quatre
côtés. Ah! ils ne sont plus de même grandeur ; il y en a deux grands et deux
petits vis-à-vis l'un de l'autre. A présent le morceau de papier est plus long
que large, ou plus large que long. C'est un carré
long. Les savants l'appellent un rectangle.
Reprenez votre exercice de comparaison. Le
mouchoir de poche est-il aussi un rectangle ? Non; mais la porte, mais la
classe elle-même, mais la table, mais l'ardoise sont des carrés longs.
N'est-ce pas assez pour la seconde leçon,
peut-être même pour la troisième, car, en somme, que s'agit-il d'obtenir? C'est
que les enfants arrivent à plier leur morceau de papier en deux parties
rigoureusement égales, qu'ils le fassent sans difficulté, peu à peu, même avec
grâce. C'est charmant, les petites mains adroites!
Mais ce carré long, produit par un carré
plié en deux et qui a la même forme que l'ardoise, que la porte, que la classe,
etc., tout le temps que les deux moitiés du carré sont appliquées l'une sur
l'autre, ne pourra-t-il nous donner, en le dépliant un peu, quelques figures
intéressantes ?
Écartez les deux côtés du carré long et
dressez-le sur la table; voici la niche du chien, ou une tente de soldat, ou la
toiture de la maison.
Mais oui, la toiture : la preuve,
c'est que voici la cheminée! et la directrice, armée d'une paire de ciseaux,
fait, en partant de la ligne de faîte du toit, une entaille verticale, puis une
horizontale à angle droit, puis une troisième entaille parallèle à la première
entaille; elle relève le rectangle ainsi obtenu. C'est bien le tuyau de la
cheminée, et les enfants sont joyeux !
Ce carré, ce carré long» nous fourniront
une masse d'objets.
Pliez d'abord votre morceau de papier en
deux, comme tout à l'heure; pliez ensuite en deux chacune des moitiés ainsi
obtenues, non pas l'une sur l'autre, mais l'une opposée à l'autre, de façon que
leurs bords se rejoignent; écartez les feuillets formés par les plis, dressez
votre papier sur la table : c'est un paravent à quatre feuilles.
Autre chose, avec le carré ou avec le carré long :
1° Pli au milieu dans le sens de la
longueur ;
2° Chacun des bords rabattus sur le pli du
milieu (pas l'un sur l'autre, mais, comme tout à l'heure, de façon qu'ils
viennent se rejoindre vis-à-vis) ;
3° Redressez les deux parties abaissées de
chaque côté, effacez le plus possible le pli du milieu, et vous avez la table du réfectoire.
En attendant mieux, mettons sur la table la
serviette roulée et maintenue par son rouleau. La serviette, c'est encore un
carré ou un rectangle. Le rouleau, c'est un rectangle plus étroit, dont les
deux petits côtés ont été fixés ensemble par un pli double, comme pour un
ourlet.
Prenez un rectangle de même longueur que
celui qui a fourni la table, mais moins large de moitié, faites les mêmes plis
que ci-dessus.
Mais ce banc n'est pas réglementaire il
nous faut un banc à dossier.
Reprenons le rectangle. Il faudrait le
plier en cinq parties égales, ce qui est trop difficile pour les en-fants c'est
alors qu'il faut appeler le procédé à notre aide. Plions-le en six, supprimons
la sixième partie, et dressons ainsi notre petite machine.
1er
feuillet, pied du banc;
2ème,
siège;
3ème,
dossier;
4ème
et 5ème, appui du petit meuble.
La
même combinaison du rectangle partagé en cinq parties (par le procédé empirique
de tout à l'heure) donnera la guérite du soldat le feuillet du milieu donne le
fond; de chaque côté du fond, les deux panneaux ou murailles, puis la porte
ouverte à deux battants. Un carré de papier placé au-dessus forme toiture.
Je pourrais multiplier les exemples. Mais
je voulais seulement donner aux directrices quelques indications. Il me reste à
leur montrer maintenant le parti que l'on peut tirer du pliage.
C'était dans une école maternelle située au
sommet d'une ville pittoresque, comme il y en a tant dans notre « doux pays de
France » ; les maisons ont escaladé la colline et se cachent dans la
verdure, leurs fenêtres sont grandes ouvertes sur la vallée charmante où la
rivière déroule, entre deux rangées de saules et de peupliers, son ruban
d'argent moiré par la brise.
Il faisait chaud; les enfants manquaient
d'entrain.
« Si nous les faisions chanter pour les
réveiller un peu? »
La directrice donne le signal, et voilà
tout le petit monde chantant :
Au bivouac où
tout sommeille
Le clairon va
retentir, etc.
Le chant fini, on se rassied, et, fidèle à
mes habitudes d'investigation intellectuelle, je demande si les enfants ont
bien compris ce qu'ils ont chanté…
Hélas ! « ce bivouac où tout sommeille » ne
leur avait rien dit du tout,… oh! mais… du tout.
Que faire ? Le temps s'alourdissait de plus
en plus; une leçon abstraite risquait de transformer l'école maternelle en un «
bivouac où tout sommeille »…
« Si nous faisions du pliage ? »
Le pliage était, il faut l'avouer, peu en
honneur dans cette école, quoiqu'elle fût pourvue – luxe inusité – d'une provision de carrés de papier.
« Que ceux qui veulent jouer avec moi
s'approchent ! » dis-je ; et, sans attendre de réponse effective, bien sûre
d'ailleurs qu'on viendrait peu à peu (ce qui arriva en effet), je pliai en
trois parties égales un carré de papier, et je dressai devant moi la table ainsi
obtenue. La moitié d'un autre carré de papier, également pliée en trois parties
égales, me donna un banc, que je plaçai auprès de ma table. Tout en causant
avec mon petit monde, qui peu à peu se pressait autour de moi, je découpai avec
mes ongles un plat rond, que je plaçai sur la table, et je le remplis de
boulettes de papier, chargées de représenter les pommes de terre.
On tira au doigt mouillé qui serait le
maître et la maîtresse de maison; la bonne fut elle-même désignée par le sort,
puis la première série d'invités, et l'on procéda au partage des pommes de
terre.
« Si les autres faisaient de la musique,
pendant cetemps? »
Aussitôt les enfants entonnent
Au bivouac où
tout sommeille
Le clairon va
retentir, etc.
Instinctivement je prends un carré de
papier, je le plie en deux parties égales, puis, écartant les deux extrémités
restées libres, je campe la tente sur
la table.
« Voyez-vous ceci ? c'est une maison de
soldat; une tente. Cette tente est en
papier; les vraies sont en toile. Ces maisons-là sont faciles à transporter. Quand
les militaires vont en voyage, ils les roulent, les emportent, et, quand ils
veulent se reposer, se mettre à l'abri, ils les dressent dans la campagne.
« Faisons une deuxième tente, une
troisième, etc.
- Mais les soldats, où sont-ils ?
- En voici un.
« Mon soldat, c'est tout simplement un
rectangle de papier que je plie en deux parties égales dans le sens de la
longueur, ce qui me donne un nouveau rectangle de même longueur, mais plus
étroit.
« Faites la même opération que moi, et
mettez des lettres, A, B dans le sens de la longueur (côté du pli), C, D encore
dans le sens de la longueur du côté opposé.
« A peu près au tiers de la longueur (côté
du pli) placez une cinquième lettre, E.
« Partant de E et vous dirigeant vers C,
faites une déchirure oblique, que vous arrêtez un peu avant d'arriver au bord.
« Cela vous donne une espèce de triangle en
papier;relevez-le, vous avez le capuchon de la capote militaire. » (C'est
absolument le procédé qui donne les capucins
de cartes.)
Vous savez l'amour des enfants pour les «
semblants », vous comprenez leur joie.
« D'autres soldats d'autres soldats »
Et je faisais d'autres soldats, en effet,
lorsqu'un petit raffiné dit d'un air tant soit peu dédaigneux : « Ils
n'ont pas seulement de fusils! » »
C'est vrai pourtant, qu'ils n'avaient pas
de fusils!Mais, quand on est bien lancé, on ne s'arrête pas pour si peu. Je
coupai une petite bande de papier, je la roulai entre le pouce et l'index,
j'assujettis mon rouleau (mon allumette) par un pli à l'un de ses bouts, puis,
prenant un de mes « soldats », je fis avec mon ongle deux petites entailles,
l'une au-dessus de l'autre, près du bord de la capote, à droite; je fis entrer un
bout de mon rouleau par l'entaille supérieure et le fis ressortir par
l'entaille inférieure … le fusil se dressa tout fier…
Mon soldat était au complet.
Quand tous les soldats furent armés et
placés en ligne, on cria « En avant !... Marche !... »
Mais ils se fatiguent, les soldats. La
journée est finie, ils ont sommeil,… où dormir ? Vite, les maisons de toile,
les tentes. Elles sont dressées en un clin d'œil. C'est le campement des
soldats, leur bivouac.
Nous enlevons aux soldats leurs fusils,
leurs armes, nous les désarmons.
Après avoir vainement essayé de placer les
fusils en faisceaux, nous les mettons
en ordre le long des tentes, nous couchons nos soldats, qui tombent de sommeil,
et les enfants chantent tout doucement pour ne pas les réveiller – des paroles que
maintenant ils comprennent :
Au bivouac où
tout sommeille,
Le clairon va
retentir.
Les autres exercices manuels (piquage, tressage,
etc.) mériteraient, eux aussi, des chapitres spéciaux ; si j'ai donné la
préférence au pliage, c'est d'abord parce qu'il est dédaigné, ensuite parce
qu'il est, de tous les exercices manuels, le plus propre à faire naître et à alimenter
la causerie.
Une fois sur la piste, il n'y a qu'à
vouloir ; chaque jour amène une découverte.
Je me trouvais dans un des départements les
plus pittoresques, mais aussi les plus pauvres de France. L'école maternelle –
pas pittoresque du tout – était misérable. Une seule salle, basse, sombre,
carrelée, humide; un corridor étroit, froid et noir; une cour suspendue à la
montagne, battue par le vent du nord. Les enfants étaient assis dans la classe,
le long dumur; je touchai la main à tous ils étaient glacés.
Que pourrions-nous bien faire pour
réchauffer ces pauvres petits ? Sauf les tableaux de lecture et quelques
ardoises, il n'y avait rien.
La pauvreté rend ingénieux ; j'envoyai
la femme de service et quelques-uns des enfants chercher des cailloux sur la
route. « Apportez-en beaucoup, leur dis-je, un plein panier. »
Quand ils revinrent avec une ample
provision, je fis vider le panier au milieu de la classe; j'appelai tout mon petit
monde. « Il faut trier les cailloux ; nous mettrons les gros dans ce coin,
les tout petits dans celui-ci, et les moyens dans celui-là. En voici un que
j'appelle gros; un autre que
j'appelle petit, et un troisième que
j'appelle moyen; il est plus petit que
les gros et plus gros que les petits. » Ce n'était pas « malin », comme on dit
vulgairement, aussi le travail se fit-il vite et bien. Quelques bébés mirent
bien un peu de désordre dans le triage, mais notre exercice y gagna en frais
éclats de rire.
Le
triage achevé, je partageai mon monde en deux groupes : « Nous allons
maintenant placer nos cailloux, les gros,
les uns à côté des autres, pour faire une ligne aussi droite que possible.
Puisqu'il y a deux groupes, cela fera deux lignes droites; chacun à son tour
placera son caillou, même les bébés s'ils travaillent mal, les grands
répareront leurs fautes. » Vous voyez d'ici les deux lignes censées parallèles
qui bientôt traversèrent la salle, toujours sombre, mais où les enfants,
agissants et heureux, n'avaient plus froid.
Le même exercice fut renouvelé avec les
petits cailloux, puis avec les moyens.
Mes deux lignes, c'était le tracé du chemin
de fer. Il y en a un dans la contrée; les enfants comprenaient.
Alors nous avons placé nos cailloux trois
par trois, trois petits, trois moyens, trois gros puis plusieurs groupes de
chacun; puis chaque groupe de trois s'est composé 1° d'un petit, d'un gros et
d'un moyen; 2° d'un petit et de deux gros; 3° de deux petits et d'un gros; 4°
de deux petits et d'un moyen; 5° d'un petit et de deux moyens, etc.
Le temps passe vite quand on travaille et
qu'on s'amuse; les parents arrivaient pour chercher leurs enfants; j'ai promis
de revenir dans l'après-midi; je voulais montrer à la directrice, sinon tout le
parti qu'elle pourrait tirer de ce matériel scolaire inattendu (car les
cailloux peuvent donner lieu à une quantité considérable d'exercices), mais au
moins quelques combinaisons nouvelles.
L'après-midi, nous avons fait de jolis
festons avec nos cailloux; il fallait encore un peu compter pour cela. Par
exemple les cailloux en ligne oblique de gauche à droite en descendant (le
cinquième en bas, destiné à former la pointe du feston), et 4 cailloux en
oblique de gauche à droite encore, en remontant.
Le feston obtenu, nous avons passé au
dessin grec 5 cailloux horizontaux, 4 verticaux formant l'angle droit, 4
parallèles aux verticaux, 4 horizon-taux, etc.
Feston et dessin grec peuvent et doivent
servir à apprendre méthodiquement les nombres deux, trois, quatre, cinq, etc.,
puis à l'addition, puis à la sous-traction, puis à la multiplication, puis à la
division. Ainsi notre premier dessin nous donne 5 + 4 + 4. Si nous retranchons
une des branches du feston, nous avons 13 - 4 = 9. Si nous en retranchons une seconde,
nous avons 9 – 4 = 5.
Notre feston se compose de 3 fois 4
cailloux plus 1 = 12 + 1 = 13 cailloux.
Si nous partageons notre feston en trois
parties, il y aura 4 cailloux pour chaque part, plus 1.
Nous avons fait des ronds aussi, puis des
carrés, et puis la façade d'une maison ; nous avons terminé par un « bonhomme
».
En cherchant bien, nous finirions par nous
passer des municipalités qui nous refusent le matériel scolaire et puis, qui
sait ? elles comprendront peut-être que nos efforts nous donnent droit à un
matériel moins rudimentaire.
Les municipalités ont, il est vrai, une
circonstance atténuante : elles ne sont pas tenues d'être pédagogues.
Souvent les choses que nous leur demandons leur paraissent puériles. Il faudrait
les persuader. J'avais, il y a cinq ans, demandé des cubes au maire d'une
grande ville du Midi. Des cubes, et beaucoup d'autres choses en même temps. Et
le maire m'avait promis : c'est si difficile de refuser!
L'année suivante, en repassant dans la même
ville, je constatai avec regret que la promesse était restée à l'état de
promesse.
Je réitérai ma demande. Le maire me promit
de nouveau.
Mon arrivée est signalée une troisième
fois. – Encore moi ! – Or rien n'a été donné de ce qui m'a été promis; il
faut bien faire quelque chose cependant, ne fût-ce que pour me faire patienter…
Le maire commande des cubes, et, chose merveilleuse, il en commande beaucoup.
Ces cubes ont été reçus à l'école, juste au
moment où j'y arrivais. Le maire m'accompagnait. Il a vu d'abord les enfants se
précipiter en désordre sur les morceaux de bois, que j'avais fait déposer dans
le préau; puis il les a vus se grouper selon leurs goûts et se servir des cubes
selon leurs aptitudes ceux-ci faisant un escalier, ceux-là élevant des
colonnes, d'autres alignant des rails de chemin de fer ; et, les larmes aux
yeux, il m'a dit « Si j'avais su le parti qu'on pouvait tirer de ces morceaux
de bois, il y a longtemps qu'ils seraient ici ».
LE CHANT
Le nouveau règlement, qui parle du chant, ne dit pas que les enfants de la
première section doivent être exercés à chanter, et nous croyons qu'il a
raison. Des enfants de trois ans peuvent-ils apprendre des chants ? y en a-t-il
dans le registre de leurs voix ? y a-t-il des paroles qu'ils puissent
apprendre?
Il est vraiment difficile de l'admettre.
Cela veut-il dire que la petite section
doive être privée de chant?
Oh ! non, certes ! Qu'avons-nous dit dès le
début ? Que la directrice était la mère d'un grand nombre d'enfants. Eh bien,
elle fera pour ce grand nombre d'enfants – permettez-moi de me citer ici en
exemple – comme je faisais autrefois pour les miens quand ils étaient petits.
Le plus jeune grimpait sur mes genoux, l'aîné s'asseyait à mes pieds, et ils me
disaient « Mère, chante-nous ! » Et je leur chantais tout mon répertoire, et
ils étaient heureux !
Aujourd'hui les rôles sont renversés; quand
je suis bien fatiguée, je leur dis « Chantez-moi! » Et ils chantent pour moi!
Les enfants de la seconde section
chanteront pour la directrice, qui aura chanté pour eux quand ils étaient dans
la première, et ils chanteront aussi pour les tout petits, qui ne peuvent pas
encore chanter.
LE LANGAGE MATERNEL
Que mettrons-nous encore au programme des
tout-petits ? Eh ! mon Dieu, la chose par laquelle il aurait fallu commencer,
ou au moins ce qui est inséparable de tout ce qui précède : la langue maternelle, le français. Car il est de toute évidence
que, pour que les directrices puissent se mettre vraiment en communication avec
leur petit personnel, il faut qu'il les comprenne, il faut qu'il leur parle.
Faire parler les plus petits ! faire parler ceux qui ne savent pas parler ! C'est une œuvre si
difficile qu'il faut n'y avoir jamais réfléchi pour oser l'entreprendre sans
études préalables. On n'a cependant pas l'air de se douter de cette difficulté;
et la preuve, c'est que dans nos écoles maternelles, même dans les meilleures,
dans celles où, grâce à un nombre suffisant de maîtresses, les enfants ne sont
pas confiés à la femme de service, dans ces meilleures écoles, c'est toujours
la maîtresse la plus inexpérimentée qui est exclusivement chargée de la section
des petits. La pauvre enfant serait, sans doute, capable de faire faire aux
plus grands les exercices que nous avons indiqués plus haut; mais a-t-elle étudié les petits ? S'est-elle rendu
compte des possibilités intellectuelles de ces êtres balbutiants ? Connaît-elle
la mobilité invraisemblable de leurs impressions ? L'idée qui traverse l'esprit
de l'enfant n'y laisse pas plus de traces que la nuée qui traverse le ciel n'en
laisse sur l'eau mouvante. Qui saura jamais le chemin parcouru par
l'imagination enfantine dans le lumineux pays des mirages, pendant que nous nous
évertuons à faire reconnaître à ces pauvres petits des choses qu'ils n'ont
jamais vues ou qu'ils n'ont jamais regardées, parce qu'elles n'ont encore aucun intérêt pour eux. Nous leur
montrons les cornes recourbées d'une
vache, ses pieds fendus, tandis
qu'eux suivent du regard la mouche qui vole, la vapeur légère qui monte dans
l’éther !
La parole étant l'expression de la pensée,
pour parler il faut d'abord penser. Nous enseignerons aux enfants à bien penser, pour qu'ils arrivent à bien parler.
Peut-être croit-on que l'enfant pense
naturellement. Eh oui! il pense naturellement, comme il parle naturellement,…
pourvu qu'on le mette en état de penser, comme on le met en état de parler en
lui faisant entendre les sons et les paroles qu'il devra peu à peu prononcer.
L'ouïe le met en possession du langage.
Mais supposons une chose impossible, - impossible,
parce qu'elle serait monstrueuse : - un petit enfant que l'on tiendrait
immobile dans une chambre noire et que l'on amènerait par le procédé habituel, c'est-à-dire
en lui parlant, à reproduire des mots et des phrases. Pourrait-on dire de lui
que la parole est l'expression de sa pensée ? Son intelligence irait-elle au
delà de ce qu'il aurait entendu, puis reproduit ? Non certainement, car la
pensée est faite de ce que l'on voit comme de ce que l'on entend; elle est
faite de ce que l'on touche, de ce que l'on sent, de ce que l'on goûte; elle
est faite surtout de ce dont on jouit et de ce dont on souffre, elle est faite
de pleurs et de sourires… Pour penser, il faut vivre.
Si nous voulons apprendre à penser à
l'enfant, il faut donc le mettre dans un milieu favorable au développement de
son être tout entier; il faut le mettre en état de penser. Il ne saurait être
question ici de leçon spéciale de pensée, de même qu'il ne devrait pas être
question, non plus, de leçon spéciale de langage à un moment déterminé de la
journée ; cette leçon de pensée,
non inscrite sur le programme, doit planer au-dessus, l'entourer, l'envelopper,
s'infiltrer au dedans. On ne donnera pas plus à l'école maternelle de leçon de
pensée que de leçon de vie; mais on aidera l'enfant à penser comme on l'aide à
vivre, et cela durera… toute la journée, tous les jours.
En ce moment nous sommes donc loin du procédé; nous parlons méthode, nous
généralisons, nous élevons. Le procédé, c'est-à-dire la mise en œuvre de la méthode,
viendra en son temps. Eh bien, notre méthode consiste tout simplement à mettre
les enfants dans des conditions telles, qu'ils puissent faire leur métier
d'enfants et qu'ils soient heureux. Ceci n'est pas ce qu'on pourrait appeler de
la « phrase », de la « littérature ». C'est de la pédagogie. Voyez plutôt.
Entrons dans une de ces écoles maternelles
comme il y en a encore trop en France. Nous voici dans le grand préau, nu et
triste. Les enfants arrivent, s'assoient ; ils sont là pour être sages, pour être silencieux et
immobiles. Ils ont l'air ennuyé, somnolent; beaucoup même s'endorment.
Parmi eux, un grand nombre ne savent pas encore parler : apprennent-ils, au
moins, pendant ces longues séances d'oisiveté ? Et pourquoi ne parlent-ils pas ?
Ils ne parlent pas parce qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont dans des conditions
antipathiques à leur nature,… parce qu'ils ne vivent pas. Tant qu'ils resteront
dans ces conditions-là, il sera impossible à la directrice la mieux intentionnée
de leur donner l'éducation normale à laquelle ils ont droit.
Transportons-nous maintenant dans une école
maternelle telle que nous la rêvons. Le préau s'appelle la salle de jeux; on n'y voit pas les enfants assis les uns contre les
autres, sans mouvements possibles, oisifs, ennuyés, « sages » ; ils sont
groupés selon leurs goûts et leurs aptitudes; ils font du bruit, ils vivent.
Notre méthode de bonheur est mise en
œuvre; les enfants sont heureux. Ils vont penser et parler.
Vous donnez une balle à un bébé de deux
ans, et vous lui dites : « C'est une balle
». Il répète « Balle ! balle ! » Il s'en sert à sa manière, ne sachant pas encore
la lancer; mais il l'aime, sa balle, il la défendra contre ses camarades. C'est
sa propriété. Chaque fois qu'elle lui échappe, elle roule ; il la suit des
yeux, puis s'élance vers elle ; impossible, pour lui, de rester en place tant
qu'il jouera avec sa balle.
Or, à quelques pas de lui, d'autres enfants
jouent avec des cubes, ou des lattes, ou des dominos, et ces objets restent où
on les pose. Notre bébé s'aperçoit bientôt que certains objets roulent, et que d'autres ne roulent pas; il lui serait
impossible, d'abord, de formuler cette vérité mais cela viendra.
Maintenant, si, au lieu de lui mettre la
balle dans les mains, vous la faites rouler jusqu'à lui ; si, au lieu de lui
donner la pomme qui est dans son panier, vous employez le même procédé,
l'enfant associe tout naturellement l'action de rouler à la forme ronde, et il
dit la balle roule, la pomme roule, la bille roule, etc. Le caoutchouc de la balle fléchit sous la
pression du doigt ; la pomme cuite s'écrase ; la bille, la boule des
quilles résistent… Il doit y avoir des mots pour exprimer cela. « La balle de
caoutchouc est molle », « la pomme cuite est molle » « la bille est dure », «
la boule des quilles est dure ». Dans le jardin, les roses épanouissent leurs
corolles fières et élégantes ; les volubilis escaladent les murs qu'ils
ornent de leurs cornets de gaze délicate ; les dahlias attirent le regard
par leur grosseur et l'éclat de leurs nuances. C'est charmant, les fleurs ! L'enfant
veut les saisir. Faites-lui sentir une rose : elle a un parfum suave ; un
volubilis il est sans parfum ; un dahlia il a une odeur presque désagréable.
L'enfant qui désire une nouvelle jouissance de l'odorat revient à la rose ; il
a comparé, il a jugé et arrive facilement à dire : « La rose sent bon ; la
rose a une bonne odeur ; le dahlia ne sent pas bon, le dahlia a une mauvaise
odeur », etc.
L'éducation
des sens est donc la base du développement de l'être. L'enfant voit, il touche,
il goûte, il sent, il entend, et, comme il veut se mettre en rapport avec ceux
qui l'entourent, car c'est un être sociable, il apprend peu à peu à nommer ce
qu'il voit : la flamme ; ce qu'il touche : la balle ; ce qu'il goûte :
le fruit ; ce qu'il sent : l'odeur de la rose ; ce qu'il entend : le
bruit de la cloche. Peu à peu, aussi, il associe à chaque nom de chose
l'expression de sa qualité, de sa manière d'être, de sa fonction : « la flamme
est rouge, la flamme brûle » ; « la balle est ronde, elle roule » « le fruit
est mûr, le fruit est sucré » ; « la rose est jolie, la rose embaume » ; « la cloche
est en haut, la cloche sonne ».
Vous le voyez, chères lectrices, l'organe
du sens agit, la pensée naît, la parole est le résultat.
Mais l'enfant, de même que l'homme, n'est
pas tout sensation, il est aussi
sentiment ; le sentiment ne tarde pas à naître de l'éducation telle que je
viens de la décrire, et l'expression du sentiment devient peu à peu familière à
celui qui l'éprouve. Si l'enfant qui, s'approchant du feu en hiver, ressent du
bien-être matériel, dit : « Je me réchauffe », celui que la directrice
prend dans ses bras et dorlote avec les mots charmants que l'enfance nous
inspire, celui-là ressent du bien-être moral, et il dit : « Je suis
content : je t'aime ».
C'est bien entendu. Pour que l'enfant
parle, il faut qu'il pense ; pour qu'il pense, il faut qu'il vive ; or, quand
nous parlons de faire vivre l'enfant, nous n'avons qu'une manière de comprendre
cette expression ; nous voulons dire : le rendre heureux.
Les images sont encore ce que nous avons de
meilleur pour amener l'enfant à parler (je ne dis pas pour le faire parler). Qui n'a entendu l'accent persuasif avec
lequel le petit enfant demande à sa mère le livre d'images ? Qui n'a vu sa joie
quand il a été en possession du livre désiré ? Qui n'a entendu les explications
qu'il se donne à lui-même dans son patois adorable ? Vingt fois, cent fois, il
répète « le dada, le dada » en montrant le cheval, et le « oua-oua » en
montrant le chien ; vingt fois, cent fois, il frappe le chat qui a enlevé une
côtelette et s'écrie « vilain minet ». Vingt fois, cent fois, il passe sa douce
menotte sur la figure de la « dame » qui lui rappelle sa maman, et il fait les
gros yeux et un geste de menace au bébé qui a cassé une assiette.
Pour l'enfant plus développé, pour celui à
qui l'on raconte ou pour celui qui lit, le livre illustré a un charme
incomparable. Ce que le récit, ce que la lecture lui auraient fait seulement
pressentir, il le voit ; la scène illustrée reste gravée dans sa mémoire ;
chacun des héros du petit roman prend corps ; il a sa physionomie, sa grandeur,
ses ridicules. Dans les rues, l'enfant trouve des ressemblances. « Tiens !
untel » (c'est-à-dire quelqu'un ressemblant à un de ses personnages favoris).
En présence du parti inappréciable que la
mère de famille tire des images, il y a lieu de s'étonner que cet élément
éducatif soit si souvent dédaigné, si souvent mal utilisé, si souvent
inefficace dans les écoles maternelles.
Il est vrai que nos écoles sont bien
pauvres d'images. Que possèdent-elles pour la plupart ? La série des animaux
domestiques et des animaux sauvages, quelques scènes de la vie des champs,
quelques portraits et quelques faits historiques. Il y en a beaucoup dans le nombre
qui ne sont pas appropriées aux petits. Le bébé n'a jamais vu d'éléphant,
d'hippopotame, de girafe; il ne peut donc les reconnaître ; l'image ne lui dit
rien, et il ne dit rien de l'image. Mais il connaît et reconnaît les poules,
les chiens, les chats, les lapins ; il connaît surtout les bébés et leurs papas
et leurs mamans. Il y a le bébé qui fait dodo, celui qui mange sa soupe, celui
qui grimpe à cheval sur les genoux de son père, celui qui pleure quand on le lave;
il y a les petits camarades qui jouent à la toupie ou qui sautent à la corde,
ceux qui lancent la balle et ceux qui dansent en rond; il y a la vie en un mot, et tout ce qui représente
des scènes vivantes attire le regard de l'enfant et captive son esprit. Il nous
faut ces images vivantes. Si nous les avons, il faut apprendre à nous en
servir.
Nous posons d'abord en principe que les
images doivent servir aux deux sections. Or, sauf dans les écoles maternelles
pourvues d'un matériel complet, -écoles presque idéales encore, hélas! – les
images sont dans une des salles, et elles y restent. Il y en a qui, accrochées
au mur, sont difficiles à déplacer ; d'autres qui, attachées au compendium, semblent
y être fixées; d'autres encore « se détérioreraient si on les faisait passer
d'une salle dans l'autre », et puis, pour tout dire, on croit que le matériel
est là pour les grands exclusivement. Les petits sont dans une pénurie absolue ;
quelques tableaux de lecture, un boulier-compteur sont en général toute leur
fortune.
Certes, s'il nous était prouvé qu'il est
impossible d'établir l'équilibre, de partager ou plutôt de constituer une
espèce de roulement entre les deux sections, nous demanderions que les images,
les cubes, les lattes fussent la propriété des petits mais ce serait encore une
transaction douloureuse, à laquelle nous ne serons pas condamnées, car rien
n'empêche d'établir cet équilibre, d'effectuer ce roulement, en attendant
l'époque fortunée où chaque section aura son matériel à elle en toute
propriété.
Dans la section des petits, nous
n'élèverons plus l'image sur un porte-tableau, et nous ne nous armerons plus
d'une baguette ; nous n'essayerons plus de détailler, de disséquer la scène que
nous mettrons devant les yeux de l'enfant, parce que nous ne voudrons plus le faire regarder pour le faire parler. Notre expérience nous a
convaincus que, pour que l'enfant voie
une image, il faut qu'elle soit à sa portée ; il faut qu'il la palpe, qu'il la
tourne et la retourne ; il faut qu'elle se révèle à lui, pour ainsi dire.
Est-il d'abord frappé par l'ensemble ? est-il au contraire arrêté sur un détail
infime ? est-ce de détail infime en détail infime qu'il arrive à constituer le tout
? Je m'interroge moi-même, je tâtonne ; les philosophes affirment, je le sais
bien, que l'esprit de l'enfant va du simple au composé mais, comme pas un de
ces petits ne m'a expliqué sa manière de procéder, j'hésite, j'ai des
scrupules. Je me dis que nous tous, éducateurs, nous faisons irruption dans l'esprit
et dans le cœur des enfants comme des chiens dans des jeux de quilles,
renversant, écrasant brutalement ce qu'ils avaient travaillé à y édifier. Nous devrions
marcher sur la pointe du pied, retenir notre haleine, être pénétrés d'une sorte
d'appréhension religieuse, et nous nous établissons en sauvages dans le pays
que nous croyons avoir conquis, alors que nous ne l'avons qu'asservi. Cette
idée me fait passer un frisson. Nous immiscer dans ces âmes délicates sans les
avoir étudiées, comprises, c'est un sacrilège.
Cette étude de l'âme enfantine, entreprise
sur un groupe nombreux d'enfants, nous donnera, sans doute, une base générale
de méthode mais elle nous fera découvrir aussi tant de variétés que nous nous sentirons
forcées de varier nos procédés.
Pour le moment, le point de départ, c'est
de mettre les images entre les mains de l'enfant. Mais nous sommes arrêtés
avant de nous mettre en route. Il n'y a pas d'images dans les écoles
maternelles. Je dis qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y en a pas assez, parce
qu'elles sont trop grandes pour que le petit enfant en fasse sa chose, et enfin
parce que, pour la plupart, elles ne répondent pas besoins actuels du tout
petit. Mais ces images que nous n'avons pas aujourd'hui, nous les aurons demain.
L'image pénètre partout aujourd’hui : dans
les écoles, comme récompenses ; dans nos maisons, comme réclames des grands
magasins. Elle est distribuée dans la rue… Il n'y a pas un enfant, si pauvre
qu'il soit, qui n'en ait entre les mains. Ces images – même les bons points –
se perdent. Il faut les collectionner. Engagez vos petits élèves à vous les remettre,
découpez-en quelques-unes, faites découper les autres par les plus grands, ou
plutôt par les plus habiles, et faites-les fixer avec de la colle sur des
morceaux de calicot, ou mieux encore sur des morceaux de toile grise de la
dimension d'une page d'album. Ce petit travail, fait sous vos yeux, sera un
exercice excellent pour les doigts, pour le goût, pour l'intelligence. Chaque
feuille illustrée passera entre les mains des petits ; les albums se
constitueront peu àpeu. Les enfants, si j'en crois mon expérience, n'en comprendront
d'abord qu'un seul sujet sur un feuillet ; moins encore : un détail
d'un des sujets ; mais ils y reviendront constamment, répétant à satiété ce qui
les aura frappés; puis peu à peu le cercle s'élargira, toute l'image, puis
toutes les images seront autant deconnaissances, autant d'amies fêtées ;
d'abord l'enfant les saluait d'un geste, puis est venu le mot, bientôt ce
seront les phrases, la conversation… Il parle.
Mais en attendant ces albums, et même
parallèlement avec eux, apprenons à tirer un meilleur parti de nos grandes
images trop petites pour de grandes images
qui seront toujours nécessaires pour l’enseignement
collectif des plus grands et pour certains exercices en commun des petits ;
nous en prenons une, le cheval, si vous voulez ; nous la portons dans la section
des petits et nous la plaçons de manière que les enfants la voient. Nous leur laissons le temps de la regarder,
et je serais bien étonnée que l'un d'entre eux ne s'écriât pas : « un
cheval ! » - C'est un cheval, en effet ; il est beau; il est grand ; il a.
combien de jambes ? et combien d'yeux ? les voit-on tous les deux ? Voyons si
les petits enfants pourraient se placer, eux aussi, de telle sorte que nous ne
vissions qu'un de leurs yeux ? Moi, la maîtresse, je me mets ainsi et vous ne
voyez que mon œil droit (ou gauche). Le cheval a deux oreilles, tous les
chevaux ont deux oreilles. Les enfants aussi ont deux oreilles. A-t-il des bras,
ce cheval ? Non, il n'en a pas ; mais les enfants en ont. Il a une longue queue
et de grands cheveux au cou, - une crinière ; - il a aussi des poils courts sur
tout le corps ; sa queue, sa crinière, tous les poils de son corps sont gris.
Il a une bouche, des naseaux.
Qu'a-t-on mis sur ce cheval ? Une
couverture. Quand il galopera, il aura chaud, et on fera pour lui ce que votre
maman fait pour vous quand vous avez bien couru : elle vous couvre, pour
que vous ne preniez pas froid. Les animaux deviennent malades, ils souffrent
comme les enfants et les hommes ; il faut les soigner. Ceux qui font ou
laissent souffrir les animaux ont mauvais cœur.
Est-ce qu'il galope en ce moment, le cheval
? Non, il est au repos, sur ses quatre jambes. Celui-ci ne peut pas galoper ;
il n'est pas en vie; ce n'est que le portrait d'un cheval. Mais les enfants
peuvent galoper ; ils peuvent faire semblant d'être des chevaux. Voulez-vous
aller un peu au galop ? (dans le préau ou dans la cour) une, deux, trois… Halte !
vous vous fatigueriez trop, mes petits, si vous alliez longtemps de ce train-là.
Prenez le trot... C'est bien. Mais voici une côte (un semblant) : allons
au pas ; puis rentrons à l'écurie.
Laissez alors les enfants libres pendant
quelques minutes ; peut-être quelques-uns parleront-ils du cheval, tandis
que d'autres préféreront le regarder sans rien dire.
Une image d'histoire de France, maintenant.
Ah ! c'est difficile ; je préférerais autre chose. Mais en ce moment nous
sommes en train de nous montrer industrieuses, nous nous servons de ce que nous
avons. La première image qui me tombe sous les yeux, c'est celle qui représente
François Ier près du lit de Léonard de Vinci (non seulement elle me tombe sous
les yeux, mais j'ai souvent vu des directrices s'en servir). J'ai fait mes
réserves, "n'est-ce pas ? j'aimerais cent fois mieux une image
représentant un groupe d'enfants jouant aux quilles, ou des enfants cueillant
des fleurs ; mais, encore une fois, je me sers de ce que j'ai.
Que voyez-vous, mes petits ? Comme tout à
l'heure, nous leur laissons le temps de se rendre compte ; le travail
intellectuel est plus lent pour eux que pour nous. Ce qu'ils verront d'abord,
c'est un homme dans son lit. Il est au lit, parce qu'il est malade, comme la
maman de Charlot, ou le grand-papa de Marthe, ou encore comme le petit Jacques.
Cet homme étant malade, ses amis sont venus
le voir. Il en a beaucoup. Combien ? Il y a des hommes et des femmes. Sont-ils
bien habillés ? comment ? Cet homme a un chapeau à plumes blanches... Et vous faites
détailler les costumes, en cherchant, autant que possible, des points de
comparaison.
« Si nous jouions au malade, maintenant? »
Et vite, un enfant étendu, le médecin tâtant le pouls, les amis venant faire
une visite.
Pourvu que rien ne soit dicté ni imposé aux
enfants, pourvu qu'ils parlent et agissent d'eux-mêmes, tout ira bien.
Prenons les mêmes images et faisons-les
passer aux grands.
« Voici un cheval ; de quelle couleur
est-il ? Les chevaux d'un tel sont-ils de la même couleur ? Non. Celui-ci est
tout gris : tête, cou, jambes,
croupe, etc. Les longs cheveux (poils,
crins) de sa crinière sont gris
aussi. Voyons ses pieds. A chaque pied il y a un seul doigt, terminé par un
ongle énorme : c'est le sabot.
Si le cheval usait son sabot, il ne pourrait plus marcher sans souffrance. Pour
l'empêcher de l'user, on y cloue un fer : le fer à cheval.
« Y a-t-il des dents dans la bouche du
cheval ? Oui, des dents toutes plates, comme nos dents du fond ; elles écrasent
la nourriture du cheval, comme les meules du moulin écrasent le grain en le
réduisant en farine. La nourriture du cheval, c'est l'herbe, l'avoine.
« Pendant qu'il est en vie, le cheval nous
est bien utile : il nous porte ; il traîne les charrues, les charrettes,
les voitures. La femelle s'appelle jument,
elle donne à téter à son petit, le poulain.
Avec les crins du cheval on fait des brosses; sa peau tannée devient du cuir
très épais et très résistant; sa chair est bonne à manger. »
Il y a bien d'autres choses à dire du
cheval, et la directrice a le champ libre; on lui recommande surtout la vérité,
la précision, la simplicité.
Voyons maintenant les adieux de François Ier
à Léonard de Vinci, qui nous tirent l'œil dans un si grand nombre d'écoles.
Les enfants ayant détaillé l'image comme je
l'ai indiqué, la directrice peut dire que le mourant est un peintre qui a fait
des tableaux admirables. « Ces tableaux, on les conserve comme des trésors dans
les musées des grandes villes à Paris, à Londres, à Rome. Ce peintre était un
Italien; il s'appelait Léonard de Vinci. L'homme au chapeau à plumes blanches,
c'est un roi de France : François Ier, qui vivait il y a bien
longtemps, il y a trois cent cinquante ans. Trois cent cinquante ans, c'est
beaucoup d'années; ily a des arbres qui ont cet âge, mais les hommes ne l'atteignent
jamais. Personne dans votre village n'a connu François Ier ; les
grands-pères de vos grands-pères même ne l'ont pas connu.
François
Ier aimait les belles choses : les belles étoffes, les beaux
bijoux, les beaux palais, les statues, les tableaux, et il faisait le possible
pour faire venir en France les artistes (c'est-à-dire ceux qui faisaient ces
belles choses). Il avait attiré dans notre pays Léonard de Vinci, dont il
aimait beaucoup les tableaux, et, quand ce peintre mourut, il vint près de son
lit pour lui faire une dernière visite.»
Il semble qu'il n'y ait vraiment qu'à
vouloir pour que tout redevienne simple, pour que tout redevienne humain ! et
cependant que de routine encore ! que de mort intellectuelle ! Plus je vois
d'écoles maternelles, plus je vois surtout d'écoles relativement bien dirigées :
plus je suis convaincue que nous sommes encore bien loin de la vérité, plus je me
promets de chercher encore, plus je cherche.
Bien souvent je crois avoir trouvé. Cela
m'arrive quand je cause avec des enfants, quand je vois leur regard s'allumer,
quand leur curiosité s'éveille, quand leur rire éclate, quand je les sens vibrer,
quand je les vois vivre. Mais, dès qu'il faut écrire ce que je leur ai dit,
pour que cela serve à d'autres, les formules prennent, malgré moi, la forme
dogmatique ; il semble que la sève s'arrête. Ma pensée, exprimée par une autre
qui n'a pas pensé cela ou qui l'a
pensé d'une autre manière, est moins
mouvementée, le défaut de mouvement s'accentue de l'une à l'autre, la paralysie
gagne. Ici c'était la vie, à quelque distance c'est la mort. Pourquoi ? Parce
que j'ai pris dans mon cœur ce que d'autres prennent dans le livre.
L'enfant arrive à l'école parlant à peine,
soit parce qu'il est encore trop jeune, soit parce que, grâce aux différents
patois que l'on parle dans les trois quarts de la France, le langage qu'il a
entendu jusqu'alors et qu'il entend encore soir et matin diffère de celui de la
maîtresse. Il s'agit de lui enseigner sa langue maternelle. Dans la famille,
cela se fait tout naturellement : l'enfant écoute plus qu'on ne le croit,
il pense, et les expressions lui arrivent chaque jour plus nombreuses et plus
justes. A l'école, c'est terriblement difficile, et les résultats sont lents,
parce que la causerie est bel et bien une leçon
sur un sujet qui n'intéresse pas l'enfant, ou sur un sujet qui l'intéresserait
pour peu que l'on voulût entrer dans ses vues, tandis qu'il le laisse froid,
parce qu'on veut le forcer, lui, à entrer dans les vues d'autrui.
Pendant des années, les enfants des salles
d'asile ont répondu par monosyllabes à une question directe, ou tous ont récité
des phrases toutes faites que leur mémoire avait retenues.
« Ce n'est pas cela, avons-nous dit aux
directrices. L'enfant doit penser avant de parler, puisque la parole est
l'expression de la pensée ; ne lui dictez pas ses réponses ; la phrase
qu'il aura faite lui-même vous prouvera seule qu'il a une idée nette, une idée
à lui. Un seul mot, sujet ou complément, n'exprime pas une pensée ; ne vous
contentez pas d'un seul mot. »
Nous avons été compris et obéis…
servilement. Nos conseils, pris au pied de la lettre, tuent toute initiative intellectuelle
chez les enfants. J'en ai des preuves récentes.
J'étais dernièrement dans une école
maternelle que je dirais excellente si je ne la jugeais que sur le dévouement
absolu de la directrice, qui, jour après jour, y épuise ses forces. Livrée à
ses propres inspirations, cette brave et intelligente fille aurait sans doute
trouvé des procédés pour développer ses petits élèves; mais elle a dû obéir à
la méthode autoritaire, implacable,… puis les parents veulent des résultats immédiats,…
puis elle soutient une concurrence aussi implacable que la méthode. Bref, son
école, qui devrait être une bonne école maternelle, est une mauvaise école
primaire.
« Voulez-vous faire causer les enfants ? » demandai-je
à Mlle X… pour faire cesser une dictée au tableau noir qui me désespérait.
Elle fit lever une petite fille de cinq à
six ans (disons en passant que ce seul fait d'être obligé de se lever paralyse
presque toujours la spontanéité de l'enfant; je voudrais qu'à l'école
maternelle on renonçât à cette habitude).
« Comment s'appelle ta petite sœur?
- Julia, répondit l'enfant, en levant vers
nous de jolis yeux bleus qui souriaient aussi gracieusement que ses lèvres.
- Est-ce ainsi que l'on doit répondre ? tu
sais bien que je ne vous permets jamais de répondre par un seul mot. Fais une
phrase. »
Le front de l'enfant se rembrunit. Elle
resta muette.
« Voyons, ma chérie; dis comme moi : Ma
petite sœur s'appelle Julia.
- Ma petite sœur s'appelle Julia, récita
l'enfant.
- C'est très bien. Et quel âge a-t-elle, ta
petite sœur?
– Trois ans.
– Encore ! Tu sais très bien qu'il
faut répondre : Ma petite sœur a trois ans. »
Ce fut fini. La petite sœur de Julia ne
répondit rien ; elle s'assit ; ni ses yeux bleus ni sa bouche ne souriaient
plus.
Et c'est tout naturel. Si j'avais demandé à
la directrice comment elle se nommait, elle m'aurait dit tout simplement son
nom, au lieu de le faire précéder dela formule sacramentelle : Madame, je me
nomme X ou Y ou Z.
« Et toi, dis-je à un petit voisin de
l'enfant interloquée, comment te nommes-tu ? – François. – Aimes-tu bien les
gâteaux? – Oui. Lesquels aimes-tu? Les babas. – Les babas. Comment sont-ils ? –
Il y a du rhum. – Et encore ? – Et du raisin. – Pourquoi aimes-tu les babas ? –
Parce qu'ils sont bons. – Mais les autres gâteaux, aussi, sont bons ; pourquoi
choisis-tu de préférence les babas ?... Aidez-le tous. Que ceux qui aiment les
babas lèvent la main. » Toutes les mains se levèrent, mais personne n'osait
dire pourquoi le baba obtenait ainsi tous les suffrages ; on ne me connaissait
pas encore assez pour se permettre une telle sincérité. - « Eh bien ! dis-je,
moi, je les préfère parce qu'ils sont plus gros… »
Oh ! c'était bien cela pour tout le
monde.
Les éléments de la leçon de langue
maternelle étant désormais rassemblés, rien de plus facile que de les mettre en
œuvre, et les enfants s'y prêtent de fort bonne grâce. « J'aime les gâteaux. »
« Les babas sont les gâteaux que je préfère », ou mieux encore « J'aime les
gâteaux, surtout les babas ». « Dans les babas il y a du rhum et du raisin de
Corinthe. » « Je choisis les babas parce qu'ils sont plus gros. »
De là à composer une petite histoire comme
celle qui suit, il n'y a qu'un pas.
« La maman de François lui a donné deux
sous. Il est allé chez le pâtissier, et il a acheté un baba, un gros baba avec
du raisin de Corinthe et du rhum. Comme il allait mordre dedans, sa petite
cousine Julia est arrivée. « En veux-tu, du gâteau ? lui a dit François. – Oh !
oui », a répondu la fillette, avec des yeux brillants de joie. François a fait
deux parts de son gâteau, et, comme les babas sont gros, il a eu le plaisir de
donner une grosse part à sa cousine. »
Mais, vraiment ! peut-on faire imprimer de
telles leçons ? Prises au moment même, sur
le vif, elles sont évidemment bonnes ; mais parler aux enfants comme dans
les livres ou dans les journaux, les faire parler comme des livres ou des
journaux, exiger des réponses dans une forme déterminée, c'est tuer leur spontanéité.
Des enfants qui récitent et qui écrivent des phrases sous la dictée ressemblent
aussi peu aux enfants qui s'ébattent et babillent, que les oiseaux alignés aux
devantures des empailleurs ressemblent peu à ceux qui font leur nid dans les
buissons fleuris.
Un autre procédé est en train d'ankyloser
davantage l'enseignement de la langue maternelle. C'est celui qui consiste à
écrire sur le tableau noir (c'est la maîtresse qui s'en charge), et ensuite sur
les ardoises, chaque phrase construite par les enfants.
La leçon débute ainsi : « Qu'est-ce
que je tiens à la main ? – Une boîte » (c'est en effet souvent une boîte). La
directrice écrit au tableau noir le mot boîte
et le fait lire aux enfants. « Quelle est la forme de cette boite ? Ronde. » La
directrice écrit le mot ronde. Les
enfants le lisent. « Est-elle ouverte ou fermée ? Fermée. » Le mot fermée s'ajoute sur le tableau aux mots
déjà inscrits. La directrice ouvre la boîte. « Que contient-elle ? – Des plumes
» (ou tout autre objet),
Faisons maintenant une phrase : La boîte est ronde ; elle est fermée ; quand
on l'ouvre, on voit des plumes. Cette phrase est écrite tout entière au
tableau noir ; les enfants prennent leur ardoise et la reproduisent. Ils
sont vingt ; ils sont trente ; ils sont quarante. Ils sont quarante très
souvent. Quand la phrase a été écrite par les plus habiles, il y a une bonne
demi-heure, non, une grosse
demi-heure, que l'exercice dure. Il faut cesser.
Montre en main, j'ai assisté à beaucoup
d'exercices de ce genre. Voici un de mes souvenirs les plus récents. Les
enfants ayant lu le mot arbre, la
directrice leur demande : « Qu'est-ce qu'un arbre ? Où y a-t-il des arbres
? » On arrive, par le procédé cité plus haut, à cette phrase : Il y a des arbres dans la cour. La
phrase est écrite au tableau noir, puis sur l'ardoise ; total : vingt
minutes. Est-ce du langage maternel ? Est-ce de l'exercice d'invention ? C'est
l'un et l'autre, puisqu'il y a eu les éléments de la phrase, puis la
composition de la phrase ; mais c'est surtout un exercice d'écriture, puisque,
sur les vingt minutes qu'a duré la leçon de langage maternel, quinze minutes
ont été consacrées à la transcription sur l'ardoise. En somme, les enfants
n'ont pas parlé.
Comment donc procéder ?
Revenons
à nôtre arbre. C'est une plante.
« De quoi se compose l'arbre ? - D'une
racine. Et encore ? - D'une grosse tige qui s'appelle le tronc. Et encore ? –
De branches, de feuilles. – Et encore ? – De fleurs, de fruits. » Composons
maintenant notre phrase L'arbre a une
racine, un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits.
« Où y a-t-il des arbres? – Dans la cour,…
dans les jardins,… le long des avenues,… dans les bosquets,… dans les bois,…
dans les forêts,… dans les vergers,… le long des rivières, etc. »
La phrase se trouve toute faite : Il y a des arbres dans la cour, dans les
jardins, le long des avenues, dans les bosquets, dans les buis, dans les
forêts, dans les vergers, au bord de l'eau.
« Quels sont les arbres que vous voyez dans
la cour (ou dans le jardin, ou le long des avenues) ? – Des acacias, un
platane. – A quoi reconnaissez-vous l'acacia ? – A ses feuilles. – Comment sont-elles
disposées ? – Il y a une tige, puis une feuille au bout, puis des feuilles de
chaque côté de la tige. – Sont-elles découpées, dentelées ? – Non. – A quoi
reconnaissez-vous les platanes ? – A leurs feuilles, qui ont trois grands
festons pointus. – Et encore ? – A l'écorce. -
Qu'avez-vous remarqué à l'écorce du platane ? – Elle s'enlève par
morceaux. Il y a dans la cour des acacias
et un platane ; nous les reconnaissons à leurs feuilles et à leur écorce.
« Comment appelle-t-on les arbres qui nous
donnent des fruits bons à manger ? – Des arbres fruitiers. – Où sont, en
général, les arbres fruitiers ? – Dans le verger. – Nommez-moi des arbres
fruitiers. – Les cerisiers, les poiriers, les pruniers, les pêchers. – Quels
sont ceux qui nous donnent d'abord leurs fruits ? – Les cerisiers. – Pourquoi ?
Parce que les cerises ont besoin pour mûrir de moins de chaleur que les autres
fruits. Les arbres fruitiers sont dans le
verger. Les cerises mûrissent les premières. »
Les questions peuvent être multipliées, et
les phrases peuvent s'ajouter aux phrases. Nous ne voyons de limites à cet
exercice que le temps, ou plutôt l'élasticité d'esprit des enfants ; au
premier indice de lassitude, il faut s'arrêter. Alors la directrice écrira au tableau
noir une ou plusieurs des phrases que les enfants ont composées, et, après un
chant et des évolutions ou une course dans le jardin, cette phrase ou ces
phrases seront reproduites sur l'ardoise.
L'enfant qui sait parler – mais celui-là
seulement – doit apprendre des poésies : pour exercer sa mémoire d'abord –
la mémoire est une faculté merveilleuse qu'il ne faut pas laisser s'atrophier –
et aussi pour que la vérité morale que l'éducateur veut inculquer à son petit
élève soit, comme une perle fine, enchâssée dans une élégante et riche monture.
La poésie, c'est le « Bon » revêtu du « Beau ».
Mais c'est très délicat, de leur faire
apprendre des poésies ! non pas à cause d'eux-mêmes, mais parce qu'il n'y a,
pour ainsi dire, pas de poésies enfantines. Notre grand La Fontaine serait bien
étonné d'apprendre qu'il a composé ses fables pour les enfants des écoles
maternelles.
On puise- beaucoup dans les fables, et l'on
a raison ; une fable bien appropriée est un des meilleurs morceaux qu'on puisse
choisir. Le drame est pris sur le vif, dans la nature même ; il est question
d'hommes, mais surtout d'animaux et de plantes qui parlent, comme dans les
contes de fées. Le vers fait tableau, et puis il chante aussi, pour peu qu'on
le fasse chanter. Mais on choisit mal ! Les plus belles fables, le Chêne et le Roseau, les Animaux malades de la peste, etc., échappent
aux enfants, non seulement à cause de la moralité, mais aussi à cause de la
majesté avec laquelle elles sont écrites. La conclusion de la fable le Corbeau et le Renard
Apprenez que tout
flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute,
est
absolument inintelligible pour eux. Il y a, à ce sujet, une étude très
intéressante à faire et qui doit tenter les directrices des écoles maternelles.
Dans La Fontaine, je choisirais le Loup
et l'Agneau, en supprimant les deux premiers vers, le Rat de ville et le Rat des champs, le Loup et la Cigogne, le
Coche et la Mouche, la Cigale et la
Fourmi (pourvu qu'on fasse sentir à l'enfant le révoltant égoïsme de la cigale).
Dans Florian, plus accessible aux jeunes
intelligences, je prendrais l'Aveugle et
le Paralytique, l'Enfant et le Miroir,
la Carpe et les Carpillons, la Guenon, le Singe et la Noix et un
certain nombre d'autres. Et après ? Après il y a quelques fables de
Lachambaudie, et puis les Enfantines
de Ratisbonne, dont un très petit nombre
sont accessibles aux enfants du peuple (sauf à Paris), peut-être, et puis, il
faut chercher, ouvrir vingt recueils.
En tout cas, ce qui est indispensable,
c'est que l'enfant comprenne. Un travail préparatoire très soigné doit précéder
l'exercice de mémoire. Le morceau sera raconté en prose, raconté et même joué
si c'est possible.
Je prends pour exemple la Guenon, le Singe et la Noix. Les enfants feront d'abord
connaissance avec les héros de la fable ; ils verront leur portrait et
puis recevront les notions d'histoire naturelle qui les concernent. Ensuite,
quoi de plus simple que de leur faire faire un jeu, le jeu de la guenon, du
singe et de la noix ? Après le jeu, la directrice lira la fable ; elle fera remarquer
à son petit auditoire que l'idée est toujours la même, en vers et en prose, que
l'expression seule diffère, que c'est plus joli ainsi, plus facile à retenir.
Toutes les poésies ne peuvent pas être
ainsi « mise sà la scène », mais la leçon doit toujours précéder ; en voici
une, un peu longue peut-être, mais que j'ai choisie parce qu'elle me paraît
être bien dans le ton. Elle peut, d'ailleurs, être partagée en trois parties indépendantes
les unes des autres : première partie, les quatre premières strophes,
auxquelles on ajoutera les deux dernières, qui renferment la leçon de morale ;
deuxième partie, les quatre strophes à partir de la cinquième, en ajoutant
encore les deux dernières ; troisième partie, les six dernières strophes. Le
ton en est simple ; il y a peu d'inversions, peu de figures difficiles à
saisir ; presque toutes les expressions font partie du vocabulaire des enfants;
il faudra d'ailleurs s'en assurer. Rien de plus facile : il s'agira de
leur faire rendre compte des idées contenues dans chaque strophe.
TRAVAILLONS
Mes
enfants, il faut qu'on travaille ;
II
faut tous, dans le droit chemin,
Faire
un métier vaille que vaille
Ou
de l'esprit ou de la main.
La
fleur travaille sur la branche ;
Le
lis, dans toute sa splendeur,
Travaille
à sa tunique blanche ;
L'oranger,
à sa douce odeur.
Voyez
cet oiseau qui voltige
Vers
ces brebis, sur ces buissons,
N'a-t-il
rien qu'un joyeux vertige ?
Ne
songe-t-il qu'à ses chansons ?
Il
songe aux petits qui vont naître
Et
leur prépare un nid bien doux ;
Il
travaille, il souffre peut-être,
Comme
un père l'a fait pour vous.
Ce
bon cheval qui vous ramène
Sur
les sentiers grimpants des bois,
Croyez-vous
qu'il n'ait point de peine
A
vous porter quatre à la fois ?
Et
pourtant c'est comme une fête
Lorsqu'il
vous sent tous sur son dos ;
Les
autres jours, la pauvre bête
Traîne
de bien plus lourds fardeaux.
Entendez
crier la charrue
Tout
près de vous, là dans ce champ ;
Voici
l'attelage qui sue
Et
qui fume ausoleil couchant.
Ils
y vont de toutes leurs forces,
Et
de la tête et du poitrail,
Ces
deux grands bœufs aux jambes torses.
Certes
c'est là du bon travail !
Là-bas
le chien court, il aboie
Et
poursuit brebis et béliers…
Croyez-vous
que c'est de la joie,
Qu'il
folâtre sous les halliers ?
Il
va, gronde, battu peut-être,
De
l'un à l'autre en s'essoufflant ;
Il
va, sur un signe du maître,
Rassembler
le troupeau bêlant.
Mais
qui bourdonne à nos oreilles ?
Regardez
bien : vous pouvez voir
Nos
chères petites abeilles
Qui
butinent dans le blé noir.
C'est
pour vous que ces ouvrières
Travaillent
de tous les côtés
Sur
les jasmins, sur les bruyères.
Elles
vont cueillir vos goûters.
Il
n'est point de peine perdue
Et
point d'inutile devoir ;
La
récompense nous est due,
Et
nous savons bien la vouloir.
Le
moindre effort l'accroît sans cesse,
Surtout
s'il a fallu souffrir.
Travaillez
donc, et sans faiblesse :
Ne
plus travailler, c'est mourir.
V. DE LAPRADE.
L'exercice de mémoire sera précédé d'une
petite leçon dans ce genre.
Il pleut au dehors ; le vent souffle et
courbe les arbres ; à l'abri dans l'école, nous plaignons ceux qui luttent
contre la tempête.
A qui devons-nous cet abri ?
Nous le devons au travail des ouvriers carriers, qui ont creusé le sol et en ont
extrait la pierre; au travail des
maçons, qui l'ont taillée ; au travail
des bûcherons, qui ont coupé les arbres dans la forêt; au travail des menuisiers, qui ont scié, raboté le bois ; au travail des mineurs, qui ont extrait le
fer de la terre ; au travail des
fondeurs, des forgerons ; au travail
des charpentiers, des couvreurs, des vitriers, des peintres.
Quand vous rentrerez chez vous à midi, la
soupe fumante sera sur la table. A qui la devrez-vous, cette soupe
réconfortante ?
Au travail
du cultivateur, qui à préparé la terre, semé, soigné et récolté le blé et les
légumes ; au travail du
boulanger, qui a fait le pain ; au travail
du bûcheron, du charbonnier ; au travail
du saunier, qui a recueilli le sel dans les marais salants ; au travail des marins, qui ont traversé
l'Océan pour aller chercher le fruit du poivrier ; au travail de votre mère, qui a épluché, lavé les légumes, surveillé
la cuisson.
Ce matin, des musiciens ont traversé la
ville. Arrivés sur la place, ils ont joué du violon, de la harpe ; les sons de
ces instruments vous ont mis en joie ; vous vous êtes groupés, vous avez dansé.
Ce plaisir, vous le devez au travail du luthier, qui a fait les
violons et les harpes; au travail du
compositeur de musique, qui a inventé les airs ; au travail des musiciens, qui
les ont appris, comme on apprend une
leçon dans les livres, et qui ont rendu leurs doigts souples à force de leur
faire faire la gymnastique.
Vous aimez à recevoir votre petit journal
chaque mois. Les grands le lisent pour eux-mêmes et puis pour les petits; ils
racontent ensuite les histoires à leurs parents.
Ce journal, à qui le devez-vous ? Vous le
devez au travail encore, au travail
toujours : au travail du papetier
et de l'imprimeur ; au travail des
écrivains, qui inventent, puis écrivent les histoires ; au travail des dessinateurs ; au travail
de l'éditeur, qui a réuni dessinateurs, écrivains et imprimeurs et les a aidés
de ses conseils et de son argent, comme le chef d'une administration dirige et
paye ceux qu'il emploie. Vous le devez enfin au travail des employés de la
poste, du facteur.
Les produits de la terre, votre nourriture,
votre logement, votre vêtement, presque toutes vos jouissances, vous les devez
au travail.
Il y a des hommes qui ne travaillent pas.
Ils s'ennuient, ils ne savent que faire d'eux-mêmes ? ils sont mécontents de
tout et finissent par faire des choses coupables. Quand vous entendez parler
d'un querelleur, d'un ivrogne, d'un voleur, vous pouvez presque toujours dire
que cet homme est un paresseux.
Pour qu'un homme aime le travail, il faut
qu'il l'ait aimé étant enfant, que, tout jeune, il ait compris que le paresseux
est inutile à lui-même et aux autres, et qu'il est malheureux.
L'enfant doit travailler dans la maison
pour rendre service à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs plus jeunes. A
l'école il doit travailler pour apprendre les belles et bonnes choses qui
embellissent la vie.
L'enfant laborieux deviendra un bon ouvrier
et un honnête homme.
Les animaux travaillent, eux aussi.
L'oiseau fait son nid avec les brins de paille, la mousse et les feuilles qu'il
a recueillis lui-même quand ses petits sont trop jeunes pour manger tout seuls,
il leur donne la becquée.
La fourmi fait pendant l'été ses provisions
d'hiver. Le ver à soie tisse le cocon dans lequel il s'endort et se transforme…
Il y a des animaux que nous faisons
travailler pour nous.
Le cheval nous porte, ou il porte nos
fardeaux, ou il traîne nos voitures.
Les bœufs tirent la charrue.
Le chien garde la maison ; va à la chasse ;
veille sur le troupeau.
L'abeille dépose, dans les ruches que nous
avons préparées, la cire et le miel qu'elle fait avec le pollen et le suc des
fleurs.
Tout travaille ! les arbres grandissent, se
parent de bourgeons et de feuilles au printemps, de fleurs et de fruits en été
et en automne ; les vapeurs de la terre montent vers le ciel et retombent en
pluie ; la terre tourne…
Mes petits enfants, aimons le travail.
Je crois avoir passé en revue tous les
éléments éducatifs dont nous disposons à l'école maternelle pour les enfants de
la première section. Dans cette section de l'école maternelle, il faut
seulement de l'hygiène, de l'éducation, du bonheur.
Mais, dira-t-on, la lecture ?
Pour les petits il ne saurait être question
de lec-ture, parce qu'il n'est pas admissible qu'on enseigneà lire à, un enfant
qui ne sait pas parler. Ce fait invraisemblable existe cependant, il existe partout.
Je sais que les directrices des écoles
maternelles ont fort affaire pour contenter à la fois les personnes ayant
qualité pour leur donner une direction pédagogique, et les parents de leurs
petits élèves, qui, manquant de notions justes sur l'hygiène intellectuelle, se
figurent que leurs enfants n'apprennent rien et perdent leur temps s'ils
n'apprennent pas à lire. Mais il est évident que l'appréciation de ces derniers
ne peut entrer ici en ligne de compte. Les programmes d'enseignement, élaborés
par des personnes compétentes et autorisées, approuvés, après discussion, par
le Conseil supérieur de l'instruction publique, ne doivent, en aucun cas, être
modifiés au gré des parents, pas plus à l'école maternelle qu'à l'école primaire,
pas plus à l'école primaire que dans les lycées.
Le résultat est, d'ailleurs, tout opposé à
l'impatience des parents quant à la lecture. Quelque peu experts qu'ils soient,
je ne puis croire que ce soit au point de vue strict de l'emploi des heures
qu'ils y tiennent. C'est pour que leur enfant sache lire de bonne heure. C'est
pour qu'il entre lisant couramment à l'école primaire, et ils ont raison en ce
point. Mais leur désir est loin d'être réalisé.
Depuis six ans je note avec soin le nombre
d'enfants de six à sept ans sachant lire dans les écoles maternelles, et je
puis affirmer que je n'en ai pas encore rencontré cinq sur cent lisant
couramment et avec intelligence, c'est-à-dire assez familiarisés avec les
combinaisons de lettres pour pouvoir penser à ce qu'ils lisent, au lieu de
penser à déchiffrer les mots, et que je n'en ai pas noté dix sur cent – toujours de
six à sept ans – sachant lire matériellement.
D'où je conclus que les enfants des écoles
maternelles perdent une moyenne de trois ans sur leurs tableaux et leurs livres ;
et malheureusement ce temps perdu pour la lecture n'est gagné ni au point de
vue physique, ni au point de vue intellectuel, ni au point de vue moral.
On ne pèche pas impunément contre la
logique ; or il est absolument contraire à la logique de forcer l'intelligence
à accepter une nourriture qu'elle ne peut s'assimiler ; il est absolument
contraire à la logique d'enseigner à lire à des enfants qui ne savent pas parler.
L'école maternelle n'est pas une école : c'est un établissement
d'éducation et non d'instruction. Qu'est-ce qui élèvera à la dignité d'éducatrices,
de mamans, les directrices qui s'obstinent à rester maîtresses d'école ? Je ne
vois qu'une force capable d'opérer cette transformation. Cette force, c'est l'amour.
L'amour pour l'enfant, l'amour intelligent, actif, expansif, dévoué, l'amour
enthousiaste, mêlé de respect pour cet être à la fois si frêle et si exquis :
c'est là le fondement de la pédagogie à l'école maternelle, le fondement, le
corps de l'édifice et la charpente.
TROISIÈME PARTIE –
SECTION DES GRANDS
ENFANTS DE CINQ A SEPT ANS
------------------------------------
CHAPITRE X
ENCORE ET TOUJOURS L’ÉCOLEMATERNELLE ÉDUCATRICE
Ce qu’il faut dans la section des grands. – Ce que c’est qu’un enfant
de cinq.ans. – Ce qu’on faisait naguère dans la section des grands. – II faut
étudier non seulement l’enfance, mais
chaque enfant. – Le programme
officiel, c’est la partie de la
directrice. – Il faut élaguer. – Une excellente circulaire ministérielle. –
Les préjugés des parents ont une excuse. – Les devoirs du soir. – Les
directrices flattent l’ignorance des parents. – Les distributions de prix et
les expositions scolaires. – Le courage moral est nécessaire aux directrices. –
Les plus grands ne vont pas à l’école maternelle pour s’instruire.
Dans la section des petits, ai-je dit plus haut, il s’agit
de faire exclusivement de l’hygiène, de l’éducation, du bonheur.
Dans la section des grands il s’agit encore de faire de
l’hygiène, de l’éducation, du bonheur.
Mais alors pourquoi sectionner ? C’est que la culture
intellectuelle prendra un peu plus de place dans la section des grands, comme
élément éducatif.
Ces grands, ils ont cinq ans (dans la plupart de nos
écoles ils en ont à peine quatre), ils ont six ans, c’est-à-dire l’âge où ils
ont encore presque tout à faire pour leur développement physique et où leur intelligence
ne saurait être traitée avec trop de précaution.
Un enfant de quatre à cinq ans, mais on peut dire encore
qu’il sautille et qu’il ne marche pas, qu’il babille et qu’il ne parle pas, qu’il
entend et qu’il n’écoute pas. Il a des impressions et pas de sentiments, des
intuitions et des divinations et pas – à prendre le mot dans son sens rigoureux
– de véritable intelligence.
Tout ce que nous avons dit de la nécessité absolue du
développement physique chez les plus petits est donc de nécessité tout aussi
absolue chez les plus grands. En même temps, la question d’éducation et d’instruction
entre, pour ainsi dire, dans une phase nouvelle.
Quand l’enfant arrive dans la section des grands, le
champ de ses idées est encore restreint à ce qui l’entoure ; il s’agit d’en
élargir graduellement, méthodiquement le cercle, en prenant garde de rien froisser.
Je ne puis m’empêcher de vous faire part d’une comparaison qui naît sous ma
plume.
Jetez un objet dans l’eau : il se produit un
cercle qui se multiplie en s’élargissant toujours. Venons au cerveau : de
l’enfant l’idée première est lancée par la mère, par la directrice de l’école
maternelle, par le premier venu; elle est le résultat d’un des mille incidents
fortuits de la vie quotidienne,… puis le travail intellectuel ne s’arrête plus.
Livrée à ses propres forces, l’intelligence irait lentement,
payant sans doute très cher chacune de ses conquêtes, mais elle irait sûrement.
Le rôle de l’éducation est seulement un rôle d’aide. Elle doit d’abord étudier les manifestations spontanées de
cette intelligence naissante, pour la suivre dans la voie où elle vient d’entrer,
puis, une fois que l’intelligence est en route, la soutenir, la redresser
délicatement, respectant toujours la personnalité latente, qui a le droit de se
produire et de se développer.
Encore une comparaison.
Voici un rosier, à la fois parfumé et
charmant. Interrogez l’horticulteur qui lui a donné ses soins. Lui a-t-il distribué
la même quantité d’eau en toute saison et par toute température ? a-t-il forcé
toutes les branches à prendre absolument la même direction, tous les boutons à
éclore le même jour, toutes les corolles à s’épanouir de la même manière ? Non !
il a proportionné la nourriture aux besoins de chaque heure : si une
branche prenait une direction contraire à son développement normal ou à l’harmonie
de la forme de l’arbuste, il plaçait auprès de lui un tuteur, et puis il
laissait la nature faire son œuvre, œuvre aujourd’hui d’autant plus parfaite
que l’harmonie est née de la variété.
Combien plus délicate encore est la plante qui est confiée
à la directrice de l’école maternelle ! Parfois, hélas ! les familles ne s’en
doutent pas ; c’est aux directrices de ne jamais l’oublier.
Nous allons donc procéder par le respect de la personnalité
intellectuelle et de l’enfant. Nous nous demanderons d’abord quelles sont les
facultés auxquelles s’adressait, naguère, la salle d’asile, et ensuite s’il n’est
pas urgent d’adopter à l’école maternelle un ordre plus logique.
Entrons dans la salle
d’asile en même temps que les enfants. Nous assisterons d’abord à un exercice de lecture. Chaque caractère de
l’alphabet étant un signe conventionnel, une abstraction qui n’a pour l’enfant
aucun rapport avec une idée quelconque, à quoi s’adresse ce premier exercice,
sinon à la mémoire ?
Montons au gradin. Nous y entendrons une leçon sur la division du temps en siècle, année,
mois, jour, heure, etc. Quelle opération intellectuelle fait le petit élève
pour retenir cette énumération ? C’est une opération de la mémoire, de la mémoire encore !
Choisirons-nous le moment où l’on récitera les
divisions de la terre, celles de l’Europe, celles de la France ? ou bien celui
où la leçon de choses sera faite, souvent sans préparation sérieuse, sans musée
méthodiquement rassemblé, sans expériences pratiques destinées à frapper les
sens?
N’est-ce pas de la mémoire
encore, de la mémoire toujours?
Mais, la mémoire, elle reçoit justement, pour les conserver,
les idées toutes faites ; placée au
début, elle exclut par conséquent toutes les autres opérations de l’esprit, les
plus élevées, les plus nobles : l’observation, la comparaison, la
réflexion, le jugement ; elle exclut aussi l’imagination.
La mémoire, c’est, j’oserais presque le dire, la
partie matérielle de l’intelligence ; c’est un outil, un outil merveilleux, qu’il
faut exercer, de crainte qu’il ne se rouille; mais c’est par elle qu’il faut
finir, parce qu’elle n’est que la trésorière
de l’intelligence ; les facultés intellectuelles dont nous parlions tout à l’heure
amassent, la mémoire garde.
Or ce que la mémoire de l’enfant doit garder, ce sont
les notions qu’il aura acquises et non celles quẽ nous lui aurons imposées. L’enfant
est un être pensant ; c’est une lourde faute de penser pour lui, car penser
pour lui équivaut à l’empêcher de penser.
Mais l’instruction, entrant dans l’école maternelle
comme élément éducatif, est extrêmement difficile à donner, et ce qu’il y a de
triste, c’est qu’on n’a pas l’air de s’en douter. Comment procéder pour ne pas dépasser
la mesure, pour ne rien gêner, froisser, étioler, étouffer ; pour ne rien
surexciter non plus dans ce petit monde de germes d’une si exquise délicatesse
? Tout est dans la mesure ; mais,
pour mesurer l’enseignement à l’aptitude, il faut connaître, et, pour connaître,
il faut étudier. Il faut étudier l’enfant.
L’étude générale de l’enfance ne suffit pas, car les règles
sont faites d’exceptions. Les enfants, tout en se ressemblant tous au fond,
sont si différents les uns des autres, et parfois si différents d’eux-mêmes, qu’il
faut sans cesse, dans la pratique, modifier la règle qui avait d’abord paru s’adapter
à la plupart des cas.
C’est ce qui rend si délicate la tâche
de ceux qui réglementent et de ceux qui conseillent. C’est ce qui fait que
telle décision, excellente en elle-même, est parfois contestable dans l’application
; c’est ce qui rend absolument nécessaire l’intelligente initiative des
personnes chargées d’exécuter les règlements, de suivre les conseils.
Ces idées me sont suggérées non seulement par le programme
du 2 août 1881, mais aussi par les journaux qui le commentent et qui insèrent
des leçons à la mesure de son cadre.
Plus j’étudie ces programmes, plus je lis les
journaux, plus je me tiens au courant de leurs leçons, plus j’en fais moi-même,
plus je suis convaincue qu’il faut agir avec la plus grande circonspection. Programme
officiel, commentaires, leçons – quelque élémentaires qu’elles soient – doivent
toujours être considérés comme la partie
des directrices, partie dont elles ne doivent donner aux enfants que ce qu’ils
en peuvent prendre. Ce sont autant de sujets sur lesquels ils questionneront
très probablement un jour ou l’autre, et il faut que les directrices soient armées
pour répondre ; mais de là à faire des leçons spéciales sur des sujets
notoirement difficiles, la distance est grande.
Un
jour de tempête, un jour d’orage, un enfant curieux de savoir demandera : «
Pourquoi y a-t-il du vent ? Qu’est-ce que le tonnerre ? » Il est indispensable
que la directrice soit assez cultivée pour faire une réponse très simple. Mais
il faut qu’elle se garde de dire : « Aujourd’hui nous allons faire une
leçon sur le vent, une leçon sur le tonnerre ». Il n’y a pas à l’école
maternelle de leçons dans le sens
strict du mot. Les enfants s’occupent, et de leurs occupations naissent les
prétextes à la culture intellectuelle. En choisissant et en surveillant les
occupations, la directrice trouvera toujours un sujet d’enseignement.
Un de mes amis, qu’en toute sincérité je considère comme
l’un des premiers instituteurs de notre pays, et dont l’école est fréquentée
par des enfants qui sont tous fils de lettrés et d’artistes, ce qui implique
une culture native, de plus tous Parisiens, ce qui est une présomption de
développement précoce ; cet ami me disait : « Voilà dix ans que,
chaque année, je simplifie mon programme, et que je prends pour devise «
élaguer ». Et, à l’appui de sa thèse, il me montra son programme de leçons de
choses pour l’avenir. Ce programme
est absolument simple : quelques animaux et quelques fleurs, les vêtements
de l’enfant et puis son habitation. Le petit élève n’est appelé à s’occuper que
des choses qui lui sont à peu près familières ; aussi en parle-t-il avec
facilité ; peu à peu, sans secousse, sans fatigue d’esprit surtout, il agrandit
le cercle de ses connaissances, et ce n’est que beaucoup plus tard qu’il fait
ce qu’on peut appeler de la science.
Si, dans une école exceptionnelle de Paris, un éducateur
sérieux procède avec cette prudence et cette délicatesse, combien doit-on être
plus circonspects, plus délicats encore dans des écoles où les conditions sont
loin d’être les mêmes, et quel précieux exemple donne aux directrices écoles
leur collègue de Paris !
A cet enseignement prématuré, où la mémoire seule est
en jeu, les facultés les plus nobles et les plus charmantes de l’enfant s’émoussent.
Habitué à ne pas comprendre, il ne cherche pas à se rendre compte de ce qu’on
lui dit ; engagé sur une route monotone, lassé dès les premiers pas, il ne se
sent pas porté à plonger son regard en avant ; en proie à un enseignement ardu,
desséchant, il végète sans ressentir ces émotions douces qui sont le plus sûr
levier de la vie morale… Intelligence, imagination, sentiment, tout s’étiole…
Oh ! mes chères lectrices, ne vous rendez pas
complices de ce meurtre !
L’enfant apprend-il à connaître un animal ? c’est bien
qu’il sache son nom et qu’il puisse le décrire ; c’est bien qu’il sache quels
services, mort ou vivant, cet animal rend aux hommes ; mais ce qu’il importe bien
plus qu’il sache, c’est que, puisque cet animal vit, il jouit et souffre ; ce
qui est de toute nécessité, c’est que cet enfant aime à le faire jouir et
déteste de le faire souffrir.
Etudie-t-il une plante ? il apprend son nom, le genre de
culture qui lui convient, l’usage qu’on en fait ; c’est bien encore ; mais
qu’il admire aussi la sveltesse de sa forme, la délicatesse de son tissu, la
richesse de ses couleurs ! qu’il savoure la suavité de son parfum !
Que l’étincelle qui jaillit du feu lui rappelle, grâce
à la direction que l’on donnera à ses idées, l’étoile qui scintille le soir
dans le ciel !
Qu’il en vienne à se figurer des pays couverts de fleurs
plus belles et plus parfumées que les nôtres, des cieux aux constellations plus
brillantes ; qu’il rêve d’animaux bienfaisants, d’enfants sans défaut, de
divinités toujours propices.
Les contes dont on a bercé notre enfance avaient du
bon, et je les regrette.
L’enfant est à l’école maternelle pour développer ses
facultés et non pour apprendre. Il faut
que les directrices en soient convaincues ; il faut que les parents en prennent leur parti.
Malheureusement, les directrices ne sont pas encore convaincues
; elles ne sont pas encore imprégnées de l’esprit de la remarquable circulaire
ministérielle qui accompagne le décret de réorganisation de l’école maternelle.
La voici, cette circulaire :
« L’école maternelle a pour but de donner aux enfants
au-dessous de l’âge scolaire « les soins que réclame leur développement
physique, intellectuel et moral » (décret du 2 août 1881), et de les préparer ainsi
à recevoir avec fruit l’instruction primaire.
« L’école maternelle n’est pas une école au sens ordinaire
du mot : elle forme le passage de la famille à l’école ; elle garde la
douceur affectueuse et indulgente de la famille, en même temps qu’elle initie
au travail et à la régularité de l’école.
« Le succès de la directrice d’école maternelle ne se juge
donc pas essentiellement par la somme des connaissances communiquées, par le
niveau qu’atteint l’enseignement, par le nombre et la durée des leçons, mais
plutôt par l’ensemble des bonnes influences auxquelles l’enfant est soumis, par
le plaisir qu’on lui fait prendre à l’école, par les habitudes d’ordre, de propreté,
de politesse, d’attention, d’obéissance, d’activité intellectuelle qu’il y doit
contracter pour ainsi dire en jouant.
« Eh conséquence, les directrices devront se
préoccuper beaucoup moins de livrer à l’école primaire des enfants déjà fort
avancés dans leur instruction, que des enfants bien préparés à s’instruire.
Tous les exercices de l’école seront réglés d’après ce principe général :
ils doivent aider au développement des diverses facultés de l’enfant sans
fatigue, sans contrainte, sans excès d’application ; ils sont destinés à
lui faire aimer l’école et à lui donner de bonne heure le goût du travail, en
ne lui imposant jamais un genre de travail incompatible avec la faiblesse et la
mobilité du premier âge.
« Le but à atteindre, en tenant compte des diversités du
tempérament, de la précocité des uns, de la lenteur des autres, ce n’est pas de
les faire tous parvenir à tel ou tel degré de savoir en lecture, en écriture, en
calcul c’est qu’ils sachent bien le peu qu’ils sauront, c’est qu’ils aiment
leurs tâches, leurs jeux, leurs leçons de toute sorte c’est surtout qu’ils n’aient
pas pris en dégoût ces premiers exercices scolaires qui seraient si vite
rebutants, si la patience, l’enjouement, l’affection ingénieuse de la maîtresse
ne trouvaient le moyen de les varier, de les égayer, d’en tirer ou d’y attacher
quelque plaisir pour l’enfant.
« Une bonne santé ; l’ouïe, la vue, le toucher déjà exercés
par une suite graduée de ces petits jeux et de ces petites expériences propres
à faire l’éducation des sens ; des idées enfantines, mais nettes et claires sur
les premiers éléments de ce qui sera plus tard l’instruction primaire ; un
commencement d’habitudes et de dispositions sur lesquelles l’école puisse s’appuyer
pour donner plus tard un enseignement régulier ; le goût de la gymnastique, du
chant, du dessin, des images, des récits ; l’empressement à écouter, à voir, à
observer, à imiter, à questionner, à répondre ; une certaine faculté d’attention
entretenue par la docilité, la confiance et la bonne humeur ; l’intelligence
éveillée enfin et l’âme ouverte à toutes les bonnes impressions morales : tels
doivent être les effets et les résultats de ces premières années passées à l’école
maternelle, et, si l’enfant qui en sort arrive à l’école primaire avec une
telle préparation, il importe peu qu’il y joigne quelques pages de plus ou de
moins du syllabaire. »
Quand les directrices auront compris, elles prendront
à cœur, malgré les parents, l’intérêt des parents eux-mêmes ; n’est-ce pas, en
effet, travailler pour les parents que développer les enfants d’une façon
rationnelle ? Pour complaire aux parents, on soumet les pauvres petits à un
travail prématuré qui paralyse l’essor de leurs facultés, arrête leur développement,
tue leur curiosité intellectuelle et les condamne fatalement à une espèce de
rachitisme moral.
Les parents, eux, ont une excuse. Ignorants presque
tous, – les mères surtout, – ayant souffert, souffrant encore de ne savoir ni
lire ni écrire, ayant vu ceux qui lisaient et écrivaient arriver presque
toujours – s’ils avaient de la conduite – à une somme de bien-être qu’eux-mêmes
étaient impuissants à atteindre, ils se sont promis – les meilleurs, ceux qui
ont conscience de leurs devoirs – de ne pas laisser leurs enfants dans cette
ignorance funeste.
D’autre part, comme, naguère encore, lire,– matériellement,
sans intelligence et par conséquent sans attrait, – écrire – c’est-à-dire
copier – et quelque peu calculer étaient regardés comme un bagage d’instruction
suffisant pour les enfants du peuple, et que, dès qu’ils avaient chargé ce bagage, ils sortaient de l’école
et étaient utilisés par leurs parents, ceux-ci avaient hâte de les voir lire,
écrire et compter tant bien que mal ; disons plutôt tant mal que bien ; ils assiégeaient
les instituteurs de leurs demandes pressantes, de leurs plaintes ; l’instituteur
qui mettait le plus tôt ses élèves en possession du mécanisme était réputé le
meilleur ; les autres restaient en butte à mille tracasseries.
Ces mêmes parents ont-ils pu se convaincre que l’instruction
primaire réduite à ses limites les plus étroites n’a été une aide que pour ceux
qui avaient pu se l’assimiler ? Se sont-ils interrogés plus tard avec inquiétude,
en voyant leurs enfants se désintéresser complètement de ce qu’ils avaient appris
sans goût et péniblement à l’école ? Ont-ils constaté que, malgré le sacrifice
de temps qu’ils s’étaient imposé, leurs enfants n’étaient cependant ni plus
habiles, ni plus zélés au travail, ni plus intelligents, ni plus moraux que ceux
qui n’étaient jamais allés à l’école ? Oui, ils l’ont souvent constaté ; et
ils ont fait le procès à l’enfant et à l’école, au lieu d’accuser leur
ignorante précipitation.
Comment s’en étonner ? Peut-on demander la
clairvoyance à ceux qui ont vécu dans les ténèbres ? Un peuple sans écoles, ou
laissé libre de dédaigner un trésor qu’il ignore, peut-il être un peuple lettré
? Les parents d’autrefois, ceux de naguère, la plupart, hélas ! de ceux d’aujourd’hui
ne peuvent être rendus responsables de leurs préjugés, et, si les difficultés
que ces préjugés nous créent sont affligeantes, elles ne sont pas
désespérantes, puisque le remède est là : l’instruction obligatoire et
gratuite. Dans vingt ans les parents trouveront excellentes les choses qu’ils
contestent aujourd’hui, à la condition pourtant que dès aujourd’hui nous
préparions une génération non surchauffée, vraiment intelligente, ayant des
idées et non des notions indécises, une génération ayant appris à réfléchir, à
apprécier la supériorité des jouissances intellectuelles sur les plaisirs
grossiers, une génération curieuse de savoir et jalouse de faire usage aux champs,
à l’atelier, au régiment, dans la famille, des plus nobles facultés humaines.
Pour cela il faut avoir le courage de rompre avec les
préjugés des parents ; à plus forte raison faut-il lutter contre leur vanité
coupable et se faire un devoir de ne pas chercher à les éblouir par des
résultats de mauvais aloi.
Ce ne sont pas des mots que j’aligne ici ; je n’invente
pas des arguments pour une thèse imaginaire : le mal existe, je le
rencontre tous les jours, j’en ai le cœur serré, et il faut que je le
dise !
Ce que j’appelais tout à l’heure une « tendance à abonder
dans les préjugés des parents » est, malheureusement, plus qu’une tendance :
c’est un principe. Pour contenter les parents, non
seulement on surchauffe les enfants pendant les heures de classe, mais, de plus,
ils emportent un devoir à faire chez eux
le soir. Oui ! un devoir du soir à des enfants de six et sept ans, qui
devraient être au lit à la nuit tombante ! un devoir du soir ! et
dans quelles conditions aggravantes ! Tout le monde connaît les
installations des ménages d’ouvriers : la place est exiguë, la table et les
chaises sont à hauteur d’homme et non à hauteur d’enfant, l’éclairage est
défectueux… L’enfant, non surveillé ou mal surveillé, prend des attitudes funestes,
il se gâte la vue, il dort sur son cahier. De sorte que cette chose insensée :
faire travailler un petit enfant le soir, devient une chose coupable.
« Les parents le veulent. »
Le devoir de la directrice est de protester contre cette
volonté et, en tout cas, de repousser toute complicité : « Puisque vous le
voulez et que vous êtes les maîtres, faites travailler votre enfant le soir ;
mais je ne verrai jamais son travail, et en aucun cas il ne lui constituera un
privilège à l’école. »
Parmi les parents qui insistent pour que leurs enfants
travaillent à la maison, quelques-uns sont mus par le désir insensé de « les
faire arriver plus vite». Ce désir est le résultat de leur ignorance, nous l’avons
déjà dit. Mais la plupart veulent surtout être tranquilles, avoir la paix. Ils n’aiment pas le bruit
; la mobilité du petit être les agace, ses questions incessantes les
embarrassent… Ils n’ont pas compris, les malheureux, qu’il y a, dans cette vitalité
enfantine, des trésors de délassement pour celui qui est harassé par le combat
pour l’existence…
« Les parents le veulent », m’a-t-on dit. Et l’on m’a dit
pis encore « Il y a une petite fille à laquelle le désespoir d’être considérée
comme trop jeune ou trop frêle pour avoir des devoirs à faire chez elle a donné
des attaques de nerfs!»
Érigez ceci en principe, et, pour lui épargner des attaques
de nerfs ou simplement des larmes, on mettra sur les épaules de l’enfant de six
ans le poids que peut à peine porter celui de quinze ans ; ce même enfant de
six ans mangera et boira autant que son père ; pour peu qu’il le demande, il le
suivra en voyage, au café, au théâtre,… cela ne souffre pas la discussion ; je
suis désolée d’être forcée de dire ces choses. Oh ! que je voudrais faire
passer dans l’esprit de ceux qui me lisent la conviction qui m’anime que je
voudrais éveiller sur ce point la conscience des éducatrices, des mères
La même faiblesse coupable excite la vanité des parents
par des travaux intellectuels et matériels, offerts au nom de l’enfant et dans
lesquels celui-ci n’entre que pour une faible part. Ces travaux ont le tort
grave de tromper les parents, de fatiguer l’enfant et de concentrer l’activité
de la directrice auprès de quelques privilégiés, au détriment du plus grand nombre.
J’ai encore mes preuves en main, une entre autres qui
m’a affligée autant qu’elle m’a doucement émue. Elle m’a émue, parce qu’elle
émane d’un sentiment élevé ; affligée, parce qu’elle présente les inconvénients
que je signalais plus haut.
Voici la chose :
Une directrice que je voudrais nommer, parce qu’elle
est soucieuse de son devoir, désireuse de le connaître chaque jour davantage
pour le mieux remplir, enfin parce qu’elle a du cœur ; mais une directrice que
je ne puis nommer, parce qu’elle n’a pas encore compris que certains succès
sont la condamnation du système suivi
dans une école maternelle ; cette directrice a joint, le 1er
janvier, à une lettre charmante qu’elle m’a écrite, la lettre suivante, que je
reproduis textuellement. L’original est écrit en demi-fin.
« Madame l’Inspectrice,
« Il me tardait beaucoup de voir arriver le jour de l’an,
parce que mademoiselle nous avait dit que ce serait celui qui s’appliquerait le
mieux qui ferait la lettre pour vous souhaiter la bonne année. J’ai fait tous
mes efforts, et c’est moi qui viens vous dire combien nous vous aimons et nous
vous remercions d’être venue nous voir. Quand viendrez-vous encore ? Nous prions
le bon Dieu pour qu’il vous donne une bonne santé et tout ce que vous pouvez
désirer. Adieu, madame l’Inspectrice ! n’oubliez pas les enfants de l’école
maternelle de X*** qui vous aiment de tout leur cœur et vous présentent, avec
leurs vœux, leur amour et leur respect.
Signé « X…, âgé de six ans.
»
Certes la bonne pensée de la directrice, l’effort du pauvre
petit qui a copié cela très proprement, très lisiblement, sans faute, sans
défaillance de bonne volonté d’un bout à l’autre, cette bonne pensée et cet effort
méritent autre chose que mes critiques ; aussi j’envoie de tout mon cœur l’expression
de mon affectueuse estime à la directrice et mes tendresses à l’enfant. Mais
cette lettre m’a fait beaucoup de peine : d’abord elle exprime des
sentiments factices ; mon petit correspondant m’a vue une fois ; j’ai
sans doute excité sa curiosité pendant quelques minutes ; si je lui ai fait
quelques caresses, ce dont je suis bien capable, il a eu un instant de plaisir,
un peu gâté sans doute par la timidité, inhérente aux enfants qui sont rarement
en relation avec des étrangers ; je parierais qu’il m’a complètement
oubliée ; en tout cas, il ne m’aime
pas. Donc il n’a pas pensé sa lettre. L’eût-il pensée, il ne se serait pas
exprimé avec cette simplicité, cette limpidité (car la lettre est
remarquablement faite) ; enfin le résultat matériel implique des heures et
des heures employées à la calligraphie, des leçons spéciales, individuelles ;
si bien que la lettre de mon petit ami me trompe sur ses sentiments et sur son
développement intellectuel, et me prouve, en outre, que l’esprit de la
circulaire ministérielle que j’ai citée plus haut est absolument faussé à l’école
maternelle de X***.
Si j’avais eu besoin d’être convaincue de l’impossibilité
qui existe pour un enfant de six ans – élevé avec une centaine d’autres – d’écrire
cette lettre irréprochable, je l’aurais été sur l’heure par la réception d’une
seconde lettre d’un enfant du même âge, élevé
dans sa famille, fils de parents très lettrés, de plus un enfant
intelligent.
« Ma chère tante,
« Je te remercie bien des jolis livres ques tu ma envouyés. Je les li tous
les jours et ils m’amusent beaucoup.
Je te prie Danbrasser mon oncle et mes cousin, et je suis bien pressés
de les voir. Ton neveu qui tambrasse…
«
SAMUEL. »
« Je n’ai pas besoin de vous dire, ajoute la mère, que
Samuel a écrit cela tout seul. Il est plus fort, jusqu’ici, en gymnastique qu’en
littérature, et use plus de souliers que de plumes et d’encre. »
Comme résultat intellectuel, que reste-t-il de ces travaux
à grand effet, de ces lettres, de ces compliments ? Dans les écoles primaires,
dans les écoles normales, aux diverses sessions d’examens, les devoirs de style
sont, en général, d’une faiblesse désespérante. Plusieurs directeurs d’écoles
supérieures nous ont raconté les difficultés qu’ils ont à vaincre pour obtenir
de leurs élèves des pages écrites avec correction et surtout avec simplicité.
Le mal part du début : on a voulu faire exprimer par les enfants des
sentiments factices dans un langage d’hommes faits ; ils n’ont pas appris à
regarder en eux-mêmes et à dire simplement ce qu’ils y voyaient ; ils sont à la
fois paresseux d’esprit et emphatiques.
Au point de vue moral, les résultats des concessions
faites aux parents, des satisfactions de vanité qu’on leur procure sont
déplorables. D’une part, l’enfant, complice d’une fraude, reçoit des leçons tacites
de déloyauté de ceux-là même qui ont pour mission de développer sa moralité ; d’autre
part, les parents exigent d’autant plus qu’on leur donne davantage (c’est
logique, il faut bien faire des progrès!), si bien que les enfants sont de plus
en plus entraînés, puis maintenus dans un milieu détestable pour leur corps,
leur esprit et leur conscience.
Pour faire plaisir aux parents ! on a méconnu et
l’on méconnaît tous les jours davantage l’esprit de l’institution. Le règlement
des salles d’asile prévoyait les distributions
de vêtements aux enfants nécessiteux, et, par des raisons de haute convenance,
de délicatesse, il recommandait de ne pas donner à ces distributions le
caractère d’une cérémonie. Ces vêtements, en somme, c’était une aumône, et le
règlement n’entendait pas que l’on humiliât les parents et que l’on habituât
les enfants à recevoir la charité.
Cependant, presque partout, la
cérémonie avait lieu à grand renfort de récitations, de comédies et de chants.
Aujourd’hui il y a un progrès moral. Quand l’aumône
est indispensable, elle se cache ; le sentiment de dignité des parents et des
enfants est respecté ; malheureusement, l’école maternelle est entrée dans la
voie des distributions de prix, des vraies distributions de prix, avec discours
enguirlandés de fleurs de rhétorique, avec listes copiées sur beau papier, – le
« palmarès » des lycées. N’a-t-on pas
lieu de se croire au lycée, en effet, lorsqu’on entend annoncer des prix d’honneur, de lecture, d’écriture, de calcul, de géographie, d’histoire
naturelle et de style ?
Si l’on veut donner des prix, qu’on
récompense au moins toutes les bonnes dispositions dont parle la circulaire
ministérielle ! que l’on donne des prix de bonnes
influences, d’activité intellectuelle
(par exemple le prix de « pourquoi » ? le seul qui eût sa raison d’être),
le prix de bonne santé, le prix d’oreilles, d’yeux, de mains… Vous
voyez que nous sommes loin de la liste de tout à l’heure.
Il est impossible, de méconnaître d’une manière plus
déplorable les idées qui ont amené la réorganisation de nos écoles qu’on ne les
méconnaît le jour de la distribution des prix.
Admettons un instant que les enfants aient mérité les
prix qu’on leur décerne. En ce cas, ils ont été surmenés, ils ont subi, au préjudice de leur intelligence et
de leur santé, un enseignement prématuré, disproportionné. C’est de la
détestable hygiène. Mais, pour charger ce bagage, quelques enfants ont accaparé
le temps des maîtresses au détriment de la masse ; ils constituent alors une
espèce d’aristocratie, un groupe privilégié. C’est une injustice, car les maîtresses
se doivent également à tous, et, si les parts devaient être inégales, il
faudrait que ce fût à l’avantage des petits.
Donc, mauvaise hygiène intellectuelle et matérielle, injustice :
tel est le bilan des prix, en admettant
qu’ils soient mérités.
Mais ils ne le sont pas (la preuve, c’est que chacun en
a au moins un). Tous pourraient se réduire à un seul : le prix de mémoire, car, dans toutes les
écoles maternelles qui, oublieuses de leur but, sont devenues des écoles
primaires, les enfants répètent des mots vides d’idées. On récompense donc des
mérites illusoires, et l’objet donné en récompense, le livre, est, pour la
plupart de ceux qui le reçoivent, du papier blanc plus ou moins maculé de noir,
recouvert de carton plus ou moins doré, car on donne des livres aux enfants de
deux ans, et quelquefois ces livres ne sont pas même illustrés !
Un enfant de deux ans, de quatre ans, en possession de
sa couronne et de son livre, s’occupe de sa couronne d’abord ; il la met sur sa
tête, l’enlève, la remet ; puis, comme l’ennui naît bientôt de l’uniformité, il
arrache feuille après feuille, porte chacune à sa bouche, et bientôt ses
lèvres, son visage, ses mains sont teints en vert. Quant au livre, il l’ouvre,
le ferme, le tourne, le retourne, lui fait faire « dodo », le met sur le bout
de ses bottines et tâche de le faire sauter en l’air, en fait, en un mot, un
jouet, puis en arrache les pages, et, lorsqu’il y a entente entre voisins, on
se fait des libéralités de fragments de livres. Avant que la séance soit levée,
il n’y a plus ni volumes, ni couronnes.
Cela ne souffre pas la discussion. On doit inculquer à
l’enfant le respect du livre ; il ne le respecte que quand il en a compris le
charme et l’utilité.
Traitons les questions à un autre point de vue. Les
distributions de prix ont lieu, en général, dans la première quinzaine d’août,
c’est-à-dire à l’époque la plus chaude de l’année.
Les enfants, frisés, pomponnés, gênés par une toilette
inusitée, – quelques-uns ont des gants, les malheureux ! – sont assis au
gradin. La salle est comble ; on étouffe. Les pauvres tout petits, que la
cérémonie n’intéresse pas du tout, se roulent, se battent ; beaucoup tombent
endormis ; quelques-uns, apercevant leurs mères, veulent aller à elles, tendent
leurs bras et crient (j’en ai vu une fendant péniblement la foule et venant
administrer le fouet à son bébé dont la tenue ne faisait pas honneur au costume
qu’elle lui avait confectionné) ; d’autres veulent
les couronnes dorées des prix d’honneur et « font des scènes ». Quant aux qui savent
ce qu’ils doivent à la solennité, ils ruissellent de sueur.
Ce supplice dure, au moins, deux heures.
J’ai vu beaucoup de distributions de prix. Ma raison et
mon cœur en ont été également révoltés.
« Mais les parents y tiennent ! » répète-t-on en chœur.
Il faut les amener à des idées sensées ; les instituteurs ont autre chose à
faire que d’entretenir les préjugés des ignorants.
D’ailleurs on peut tout concilier.
J’en reviens à mes jouets. A la fin de l’année, la municipalité
ayant 100 fr. à dépenser pour les prix (je dis 100 fr. comme je dirais 500 fr.
ou 30 fr.), la municipalité achètera des jouets solides, jusqu’à concurrence de
75 francs par exemple. A un jour déterminé, les enfants seront réunis à l’école,
en toilette, si les parents y tiennent ; avec leurs parents, si ceux-ci le
désirent, et l’on fera la fête des jouets
neufs. Il y aura des chariots, des seaux, des pelles, des poupées, des
boîtes de constructions, des boîtes à couleurs, etc. Les deux heures employées
naguère à souffrir au gradin, on les emploiera à jouer.
Le moment de cesser les jeux arrivé, on distribuera aux
enfants les gâteaux achetés avec les 25 francs mis en réserve. Tout le monde
sera content, et la raison sera sauve.
Les petits succès de famille ne suffisent déjà plus aux
directrices d’écoles maternelles, elles recherchent maintenant les
applaudissements du grand public et font travailler les enfants pour les
expositions scolaires.
Certes, l’exposition scolaire a du bon (j’allais dire qu’elle pourrait en avoir). Que les
exposants soient agriculteurs, industriels, artistes, instituteurs, toute exposition
est incontestablement une cause d’émulation. Or l’émulation est féconde, dans
les écoles surtout. Quels que soient les objets exposés, ils forment une
collection où les intéressés viennent étudier, comparer, puiser, avec l’intuition
du mieux, des idées nouvelles. Une collection de livres, de cahiers, de dessins,
d’ouvrages manuels est, à ce point de vue, aussi utile qu’une collection d’instruments
aratoires, de produits manufacturés.
Emulation et progrès, tels sont les précieux résultats
des expositions scolaires; nous pourrions donc nous féliciter de les voir
fréquentes et nombreuses. Mais ces résultats ne seront obtenus que si l’on
prépare ces expositions de la manière la plus scrupuleuse ; et quand je dis «
on », je parle des exposants eux-mêmes, c’est-à-dire des instituteurs, des
institutrices, des directrices d’école maternelle.
La première condition pour qu’une exposition scolaire
donne les résultats que l’on est en droit d’en attendre, c’est que tous les
élèves d’une même classe y prennent part et que les travaux exposés soient faits
par eux, aussi strictement que les travaux quotidiens. Ce sont les travaux
quotidiens eux-mêmes qui devraient être exposés. Il ne nous convient pas du tout,
en effet, de voir ce que pourrait être une école composée d’enfants triés parmi
les plus intelligents et ayant travaillé avec l’aide du maître, dans des
conditions toutes particulières et impossibles à généraliser. Il ne nous
intéresse pas d’étudier les prétendus résultats d’une école factice. Ce qu’il
nous importe de savoir, c’est ce que peut donner, dans les conditions normales
et au moment actuel, une école dirigée par des maîtres intelligents et dévoués.
Nous voulons savoir que non seulement l’élève X... dont nous avons le travail –
sous les yeux, a réellement fait ce travail, mais que tous ses camarades de
classe peuvent en faire à peu près autant. Nous voulons, en un mot, pouvoir
porter un jugement général sur le développement de tous les écoliers d’un âge
déterminé. Tous nous intéressent, parce que ce sont eux tous qui vont former la
génération dont le pays a besoin, que le pays attend. Pierre et Marguerite,
élèves privilégiés, ne nous sont pas indifférents ; mais nous ne les
suivons qu’à titre d’exception, de curiosité. Au point de vue du développement
de la masse, c’est donc la moyenne de chaque école qui nous intéresse ; c’est
le travail de cette moyenne qui doit être exposé.
Ce doit être, mais cela n’est pas. Dans toutes les expositions
que j’ai visitées, je me suis trouvée en présence de travaux spéciaux, dans
lesquels, trop souvent, la part de l’instituteur était évidente, – pour moi du
moins, – ce qui enlevait à mon étude tout son intérêt.
Ces travaux spéciaux sont, en général, d’un niveau plus
élevé que celui des travaux ordinaires ; ils ne sont pas assimilés par l’enfant,
qui s’est déchargé sur le maître de toute la partie difficile. Ce n’est pas
leur seul tort. Ils encouragent, comme je l’ai déjà dit, les parents, si portés
à trop exiger de leurs enfants et des maîtres, à en exiger plus encore, ce qui
est détestable comme hygiène, ce qui est détestable aussi comme pédagogie. Ils
ont des torts encore plus graves : ils trompent le public sur la valeur
intellectuelle et sur la valeur morale de l’instituteur ; ils habituent l’enfant
à accepter des éloges immérités et le rendent ainsi complice d’un mensonge. Ces
travaux spéciaux faussent, en un mot, l’esprit
de l’exposition ; ils en paralysent l’action bienfaisante, car il ne saurait y
avoir émulation et progrès que s’il y a sincérité.
« Si nous n’exposions que le travail de l’enfant, nous
disait une directrice, nous n’exposerions rien du tout. » Cette directrice se
trompait ; on trouverait dans les écoles maternelles des éléments pour des expositions
de travaux enfantins, et ces expositions seraient extrêmement intéressantes.
Les seuls travaux d’école maternelle susceptibles d’être
exposés, les travaux manuels ayant à peine droit de cité dans nos écoles, parce
que le matériel manque et aussi parce que les directrices ne sont pas préparées,
les travaux manuels figurent en petit nombre aux expositions, et encore ont-ils
presque tous été faits par les maîtresses ; quant aux cahiers, très nombreux,
ils sont tout à fait désolants, parce qu’ils nous prouvent à quel point est
méconnue dans nos écoles la méthode maternelle. L’école primaire envahit chaque
jour davantage, la mauvaise école primaire ! Au moment où tous les bons esprits
combattent chez cette dernière l’abus des devoirs écrits, le devoir écrit s’implante
chez nous. Non seulement l’ardoise ne suffit plus, mais le cahier est plein d’exercices
dont nous ne voulons même pas pour des enfants de sept à treize ans !
La page d’écriture, la désespérante page se fait journellement ; l’alphabet
à satiété : ce que l’on appelait autrefois « la croix » (sans doute parce
que c’était un supplice), puis les syllabes détachées, puis les mots détachés,
abstraits, inintelligibles, – la plupart de ceux qui composent les tableaux de
lecture ; – puis des pages entières de
chiffres. Après la page, la copie ; après
la copie, la dictée ; après la
dictée, l’analyse grammaticale ;
après l’analyse grammaticale, l’exercice
d’invention, exercice écrit par des enfants qui ne savent encore ni penser
ni parler ; exercice sur des sujets trop difficiles, résumés de leçons de choses ou descriptions d’images, ou biographie
placée sous un portrait. C’est ainsi que j’ai vu tout un album avec des choses
de ce genre : Palisie è mor de fin
dans saprison; il a invanté l’émail de fleur et de poison ; et ceci encore,
au-dessous du portrait de Pestalozzi : J’éme
Pestalozzi parce ci a fé du bien aux enfan de la suise ; il a fé une école
maternèle. Aimer Pestalozzi à cinq ans! A quel âge permettra-t-on désormais
aux enfants d’aimer leur tambour, leur cheval de bois, leur poupée ?
Un enfant pense aux choses qui l’intéressent, et il en
parle en termes naïfs qui nous prouvent qu’il comprend. Un petiot de cinq ans
peut-il penser à Pestalozzi ? à Charlemagne, à Roland, « qui a coupé les Pyrénées » ? Est-il bon qu’il
y pense ? Hélas ! naguère encore l’enfant récitait des choses abstraites ;
aujourd’hui, par aggravation, il les écrit ! A ce métier, sa curiosité s’émousse,
son imagination s’étouffe, son intelligence s’endort. Il ne parlait pas assez,
tantôt il ne parlera plus du tout ; c’est le langage écrit qui tient la corde.
Avec le langage écrit fleurissent les leçons spéciales
à un petit nombre d’enfants dont on croit faire des privilégiés, en s’occupant d’eux
pendant que les autres sommeillent d’esprit et de corps; on contente ainsi quelques
parents qui n’ont pas conscience du véritable intérêt de leurs enfants ; on
méconnaît absolument, et de plus en plus, le but éducatif de l’école maternelle.
Le plus douloureux, c’est que la plupart des
directrices croient ainsi rehausser l’institution et s’élever elles-mêmes !
Nous ne cesserons de jeter le cri d’alarme ! Il faut absolument sauver nos
petits de la pédagogie du livre. A force d’y penser, avec notre cœur surtout,
nous finirons bien par trouver la méthode,
c’est-à-dire la marche à suivre pour que l’enfant, qui n’est d’abord que germes, arrive enfin à l’épanouissement
complet de ses facultés. Cette méthode sera maternelle et non scolaire, et, croyez-le,
elle y gagnera en intelligence, en élévation ; elle sera une méthode en vie.
Ah ! si les directrices voulaient faire leur examen de
conscience. « Les procédés matériels, se demanderaient-elles, ont-ils toujours
répondu à la méthode rationnelle ? Ont-ils été sans cesse modifiés en raison de
l’intelligence des enfants auxquels ils s’adressaient ? Les enfants n’ont-ils
pas été dressés en bloc, sans égard pour les nombreuses différences de leur
tempérament physique et moral ? Ne pourrions-nous pas, en assouplissant le
système, individualiser davantage l’éducation ? L’éducation elle-même a-t-elle
tenu la place à laquelle elle a droit ? N’a-t-elle pas été trop souvent traitée
en accessoire ? L’enfant a-t-il été assez aimé, assez respecté ? a-t-on
constamment vu en lui une personnalité à développer, au lieu d’une machine à
faire fonctionner ? S’est-on bien pénétré de cette idée, que, pour avoir des hommes à l’âge d’homme, il faut avoir
des enfants à l’école maternelle ? S’est-on
bien convaincu de cette maxime, que, si les vérités scientifiques ne pénètrent
dans l’esprit qu’à l’aide de certains procédés, qui varient d’après la nature
de l’enfant, les vérités morales s’inculquent seulement par la persuasion, par
la persévérance, par la douceur et la tendresse, et enfin par l’exemple? »
L’examen de conscience doit être minutieux, car le sujet
en vaut la peine.
Mais l’examen de conscience n’est pas tout.
Lorsque
chaque question aura eu sa réponse, lorsque les directrices se seront fait une
conviction, il faudra qu’elles s’arment d’une force nouvelle, peu en honneur,
il faut l’avouer : je veux parler du courage
moral, que l’on appelle plus généralement le courage de son opinion.
L’éducateur doit avoir sa conviction ; et, pour qu’elle produise les résultats qu’il en
attend, il faut qu’il ait en même temps le courage de sa conviction.
Or la conviction fait trop souvent défaut. Elle est le
prix de recherches consciencieuses, d’études personnelles, d’observations, de
comparaisons d’essais renouvelés avec persévérance. Il faut étudier l’enfant,
il faut étudier les méthodes, il faut s’étudier soi-même.
On m’objectera que le temps manque pour cela. Mais le
temps n’a, pour ainsi dire, rien à faire avec cette enquête morale ; il n’est pas
besoin de s’assigner une heure pour l’entreprendre ; les études qu’elle
comporte ne figurent pas sur les règlements mais elles embrassent la journée
entière. En descendant en soi-même, on s’aperçoit que l’on s’y livre ; en
regardant autour de soi, il semble qu’on la respire. Elle est le prix des
habitudes intellectuelles et morales.
Or rien n’est long à prendre comme les habitudes de l’esprit
!
Si le personnel enseignant ne s’est pas fait, autant qu’on
aurait pu le désirer, la conviction qui décuple les forces, c’est qu’il ne s’est
peut-être pas persuadé qu’il avait non seulement le droit, mais le devoir du contrôle.
Il nous parait avoir accepté tout d’une pièce les méthodes et les procédés, et,
au lieu de les étudier avec l’esprit critique qui leur en eût révélé les qualités
et les défauts, un trop grand nombre les ont pratiqués de prime saut dans leurs
écoles, sans signaler à qui de droit leurs observations à mesure qu’elles se
produisaient.
Les exemples se pressent sous ma plume. Il m’a été dit
cent fois « J’ai toujours été opposée à la lecture aux cercles, qui ne me donne
aucun résultat ».
« J’ai toujours critiqué, à part moi, la séparation
des sexes au gradin, et surtout à la récréation ; le moindre désagrément
que j’aie trouvé à cette séparation, c’est d’enlever à nos écoles leur
caractère d’écoles maternelles. » Et cependant ces mêmes directrices
pratiquaient la lecture dans les conditions mêmes qu’elles désapprouvaient, et
aussi la séparation des sexes, sans avoir jamais fait part de leurs scrupules aux
inspecteurs de tout ordre qui avaient visité leur école. On dirait qu’elles se
croient enserrées dans le règlement comme dans un cercle de feu.
Elles avaient tout à gagner cependant à transmettre
leurs doutes à l’inspection. L’inspecteur, l’inspectrice à qui elles se
seraient adressées, les auraient certainement exhortées à modifier peu à peu d’elles-mêmes
ce qui leur paraissait défectueux, et à les tenir au courant des résultats
ainsi obtenus. Ils auraient rassuré leurs craintes en leur disant que les programmes
et les procédés ne sont pas immuables, et que leurs auteurs, eux-mêmes,
attendent des instituteurs qui les mettent en œuvre autre chose qu’une obéissance
servile. Les instituteurs sont les meilleurs juges,… pourvu que leur jugement
soit fondé sur l’étude, sur la comparaison, pourvu qu’il soit, enfin, intelligent
et consciencieux.
Je ne croirai jamais, pour ma part, qu’aucun cœur de
directrice n’ait protesté contre le dressage mécanique auquel les enfants ont
été si longtemps soumis dans nos écoles (j’emploie, je l’avoue, le passé avec quelques
scrupules). Ce dressage, elles l’ont certainement jugé et condamné dans leur
for intérieur ; mais elles ont eu le tort de ne pas croire à leur liberté morale.
Nous leur aurions pourtant été bien reconnaissants de leur initiative.
Donc étudier, observer, comparer, arriver à la
conviction, la discuter, s’il y a lieu, avec leurs guides, est un devoir pour
les directrices d’écoles maternelles, comme pour tous les éducateurs ; un
devoir« d’au-dessus », pensera-t-on peut-être ; mais ne devons-nous pas aspirer
à l’ « au-dessus » ?
Il y a cependant des directrices qui, ayant étudié et compris,
ont manqué de ce courage moral que j’appelais tout à l’heure le courage de son
opinion.
Celles-là, malgré les protestations de leur
conscience, laissent l’école primaire envahir l’école maternelle, alors que c’est
l’école maternelle bien comprise qui doit forcer les portes de l’école primaire ;
elles donnent des leçons disproportionnées ; elles trient dans l’école
maternelle quelques sujets distingués, comme on en trie trop souvent dans les écoles
primaires pour le certificat d’études, et cela non seulement au détriment de l’école
entière, qui a été fatalement négligée, mais au détriment même des quelques
privilégiés, qui ont été surmenés. Les petits enfants de cinq ans et demi à
sept ans font, comme je le disais tout à l’heure, des pages d’écriture, pis que
cela : des copies ; pis encore, des analyses grammaticales ; ils font
enfin des résumés d’histoire ! Et, quand on représente à leurs maîtresses, qui
devraient remplacer leurs mères, ce qu’il y a de dangereux dans cette manière d’agir,
quand on leur dit à quel point elles sont coupables envers ce groupe d’enfants
et envers tous les enfants qui leur sont confiés, quand on leur répète une fois
encore que l’école maternelle type sera l’école où les enfants s’épanouiront en
liberté et apprendront bien plus les uns des autres et d’eux-mêmes que de la
maîtresse et des livres, celles-ci répondent : « C’est bien vrai ! je
comprends parfaitement la justesse des observations qui me sont faites ; j’y
pense souvent. Mais les parents y tiennent, et puis,… dans la région, toutes
les écoles en font autant; je ne veux pas être la première… la seule peut-être
à faire du nouveau ; j’attends… Quand toutes mes collègues s’y mettront, je m’y
mettrai aussi. »
Attendre ! mais attendre, c’est d’abord priver une école
des progrès qui auraient pu être réalisés ; c’est refuser ensuite un
exemple qui eût pu être salutaire à d’autres écoles. L’état stationnaire est
toujours causé par ceux qui attendent ; ce sont ceux qui vont en avant qui font
le progrès.
Attendre, quand on a sa conviction faite !...
Si Jeanne d’Arc avait attendu que le courage vînt au
roi Charles VII, qui peut dire pendant combien d’années encore le roi d’Angleterre
aurait ajouté à son titre le titre glorieux de roi de France ? Si Gutenberg avait
attendu, au lieu de travailler sans relâche, qui sait à quelle époque le monde
aurait appris à lire et à penser ? Si Christophe Colomb avait attendu, l’existence
du Nouveau Monde aurait été considérée, pendant des siècles, comme le rêve d’un
insensé. Et je pourrais multiplier par milliers tous ces grands exemples.
Pour ne parler que de ce qui nous concerne spécialement,
si Oberlin avait attendu pour réunir les enfants qui ne pouvaient être élevés
chez eux, les salles d’asile n’auraient pas été créées ; si Mme Mallet et ses
amies avaient attendu, l’œuvre d’Oberlin ne se serait pas étendue, généralisée.
Une fois convaincu, on n’a plus le droit d’attendre ; il
faut faire preuve de courage moral.
Le courage moral est nécessaire non seulement à ceux
qui se trouvent en présence d’actes héroïques à accomplir, d’institutions à
fonder, d’idées nouvelles à faire accepter, mais il est nécessaire aussi à tous
dans la vie de tous les jours pour obéir aux instigations de la conscience. Il
est nécessaire spécialement aux éducateurs pour suivre l’impulsion qui leur a
été donnée, pour continuer la marche en avant imprimée par les novateurs. C’est,
pour les directrices d’école maternelle le seul moyen d’honorer la mémoire des
grands cœurs qui se sont dévoués à l’œuvre de l’éducation de l’enfance.
Je ne cesserai de le dire : les enfants, même les
plus grands, ne vont pas à l’école maternelle pour s’instruire. Si en s’amusant,
si en se faisant de la santé, si en développant leurs facultés morales, ils happent un peu d’instruction, ce sera
une heureuse circonstance mais nous ne pouvons continuer d’accepter que l’accessoire
tienne la place du principal.
Il faut y réfléchir ; le cas est beaucoup plus grave qu’on
ne le croit ; c’est presque une question de vie ou de mort pour l’institution
elle-même ; les plus dévoués champions de l’école maternelle ont fini par s’interroger
avec anxiété et par se demander s’ils pourraient engager plus longtemps l’État
à favoriser, par une instruction prématurée, l’atrophie des facultés de l’enfant
; tandis qu’ils se sentent des enthousiasmes d’apôtres pour ces établissements
où il vivrait heureux pendant que sa mère travaille au dehors, et pour un
personnel d’éducatrices assez distinguées pour ne pas amoindrir leur rôle sous
le prétexte de l’étendre et de l’élever.
Quand j’ai parlé tout à l’heure de « happer » un peu d’instruction,
j’avais surtout en vue les enfants qui composent la section des petits, section
qui, en général, devrait garder les enfants jusqu’à cinq ans révolus.
A cinq ans, s’il se porte bien, s’il est suffisamment développé,
l’enfant peut apprendre quelque chose pour
l’apprendre, à la condition cependant que la leçon soit donnée avec la plus
grande délicatesse et à l’aide des procédés les mieux appropriés à sa nature mobile.
Un enfant de cinq ans peut commencer à apprendre à lire ; il doit savoir
le nom des choses qu’il voit, apprendre en quoi elles sont faites et à quel
usage elles servent. Il peut aussi apprendre à compter ces choses, à les
grouper de différentes manières ; il peut faire la différence entre la
forme d’une boîte et celle d’une orange, entre la couleur des feuilles des
arbres et celle de leurs fleurs. Il est en âge de distinguer la plaine de la
colline, la montagne de la mer. C’est intéressant pour lui de savoir que le
pain qu’il mange est fait avec de la farine, le vin qu’il boit avec du raisin,
les souliers qu’il porte avec de la peau de mouton, et sa blouse avec la laine du
même animal. Il lui est aussi agréable qu’utile de devenir adroit de ses mains.
Le programme des écoles maternelles répond à ces besoins
de l’enfant, et, grâce à ce programme, on arriverait à développer toutes ses
aptitudes. Malheureusement, il a quelque chose de trop précis, il affecte une
espèce de rigueur mathématique, à laquelle les directrices se sont trompées.
Tout son tort consiste à être un programme, alors que, avec des enfants aussi jeunes
que ceux qui fréquentent les écoles maternelles, tout le côté instructif
devrait être laissé à l’initiative des directrices.
La première année, elles ont pu s’y tromper, et, en lisant
par exemple ceci : « Quelques notions sur la terre et les eaux », ou
encore « Leçons de choses », elles ont pu se croire forcées d’enseigner à, ces
pauvres petits que, la terre est un corps formé de molécules (sic) et que l’eau est un liquide
incolore ; elles ont pu se tromper au point de raconter et de faire reproduire
aux enfants les guerres d’Italie, et enfin, à propos d’éponges, de décrire les
zoophytes. Mais il a été si souvent expliqué et commenté depuis quelques
années, ce programme, qu’il doit être enfin compris, et que les directrices
savent maintenant dans quel esprit il doit être appliqué. Elles se sont bien convaincues
que l’enfant ne peut apprendre fructueusement à lire que s’il sait parler et
que s’il comprend ce qu’il lit, et elles se sont promis d’éloigner des tableaux
de lecture tous les mots abstraits et tous les noms de choses qu’ils n’ont
jamais vues et ne pourront jamais voir ; elles se sont promis, en outre, de ne
pas faire lire des mots tout seuls, tout secs, et de composer toujours des
groupes capables d’éveiller des idées ou de rappeler des souvenirs. Elles
auront pris la résolution de restreindre leur enseignement technique aux choses
les plus usuelles et d’attendre que l’enfant demande l’instruction, au lieu de
la lui distribuer d’autorité ; elles ont surtout substitué à la leçon… leçon, à la causerie convenue,
artificielle, la causerie intéressante, mouvementée, vivante ; elles se
rappelleront enfin, pour le commenter et en tirer un enseignement précieux, le
mot récent d’un de nos plus éminents pédagogues, M. Félix Pécaut : « L’enfant,
avant six ans, n’est pas matière scolaire ». « Matière scolaire », non, en
effet ; c’est pourquoi nous ne voulons pas l’astreindre aux leçons proprement dites.
Matière développable, oui, et c’est pour les aider à la développer que nous
nous associons à l’œuvre des directrices.
CHAPITRE XII
L’ENSEIGNEMENT DU CHANT
Le chant en Belgique, en Suisse, en Angleterre, en Allemagne. – Si nous
voulons que les enfants aiment le chant, faisons-les chanter. – Les directrices
ne sont pas musiciennes. – Une lacune de l’examen du certificat d’aptitude à la
direction des écoles maternelles. – Il faudrait un instrument dans l’école. – Pourquoi
les enfants doivent chanter. – Comment
leur enseigner à chanter. – Les paroles.
– L’article du règlement. – Pour que les mères chantent, faisons chanter les
enfants.
Un élément de vie pour l’école, c’est le chant. En Suisse,
les enfants des écoles maternelles chantent à deux parties d’une manière
charmante, une des directrices conduisant le groupe des soprani, l’autre celui
des contralti. En Angleterre, – et je ne crois pas que nos voisins d’outre-Manche
aient jamais passé pour avoir le génie de la musique, – le chant, à deux parties
aussi, est très bien nuancé ; on s’en occupe avec la sollicitude que
mérite une des parties les plus essentielles, du programme. En Belgique… Mais
voici une lettre qui me parle justement de ce qu’on fait en Belgique.
« J’ai vu en Belgique, m’écrit une de mes amies, des
usines admirables au point de vue industriel, mais qui m’ont surtout intéressée
par l’élévation morale des ouvriers. La musique a sa bonne part dans ce
résultat. Toutes les usines ont des Sociétés philharmoniques, qui comptent
jusqu’à 70 membres, et ceux des ouvriers qui ne jouent d’aucun instrument
apprennent au moins la musique vocale.
« En Allemagne, j’ai eu la chance d’entendre de la
musique populaire, et j’en ai été frappée et émue.
« Certes, je ne crois pas que les Français arrivent de
longtemps à une telle perfection musicale, mais entre tout et rien il y aurait
sans doute place pour quelque chose. Nos pauvres paysans, les ouvriers de nos
usines seraient moins grossiers s’ils avaient, pour combattre le cabaret, la
ressource de former dans chaque hameau des réunions musicales, qui seraient toujours
faciles à organiser, si les enfants recevaient à l’école primaire les premières
notions de la musique. Pourquoi le gouvernement, qui fait tant pour l’instruction
du peuple, n’a-t-il pas encore rendu l’enseignement de la musique obligatoire
comme celui de la lecture ? »
Ma correspondante vit parmi les ouvriers d’une usine
considérable, elle s’occupe d’eux et de leurs enfants, elle a organisé des
classes du soir et a essayé à plusieurs reprises de fonder un orphéon ; mais l’ignorance
musicale absolue de ceux qu’elle réunissait l’a obligée de s’arrêter, à bout de
forces.
Cette ignorance explique l’erreur dans laquelle elle
est tombée au sujet du programme ; car je n’ai pas à dire ici que l’enseignement du chant est obligatoire dans
les écoles primaires, obligatoire aussi dans les écoles maternelles.
En effet, en France on ne chante pas, ou l’on chante
mal, ce qui est pire ; les écoles primaires cependant sont en progrès. Mais les
écoles maternelles !
Les enfants ne chantent pas, ils crient. Ils crient – juste
ou faux, d’après leurs dispositions, mais faux le plus souvent – en frappant
des pieds de toute leur force ; la directrice donne du claquoir, de toute sa
force aussi. C’est une bataille où la mélodie et l’harmonie sont complètement
vaincues.
Est-ce parce que le Français n’a pas l’instinct
musical, comme on le dit parfois à la légère ? Est-ce parce qu’il n’est pas né
musicien ? L’enfant se façonne avec une facilité merveilleuse, d’après le
milieu dans lequel il vit. Voulez-vous qu’un enfant soit musicien, faites-lui
un milieu musical.
Après nos désastres de 1870, on a
prétendu que nous avions été vaincus par la géographie. Nos ennemis
connaissaient, en effet, notre pays mieux que nous ne le connaissions
nous-mêmes, et l’on a dit : « Les Français ne sont pas nés géographes ».
Nous avons tous répété cette assertion, mais nous ne nous sommes pas contentés
de la répéter, nous avons travaillé. Aujourd’hui, nos enfants de sept ans en
savent plus sur la géographie que leurs pères bacheliers. C’est la branche de l’enseignement
qui, dans les écoles primaires, a fait le plus de progrès. Tous les jours, nous
entendons dire d’un enfant « Il est né géographe ». Dans vingt ans, tous les
Français seront nés géographes, eux aussi, et il aura suffi, pour produire ce
résultat, d’avoir de bons maitres de géographie.
Les fillettes de la Haute-Loire qui, à six ans, font de
la dentelle, ne sont pas nées dentellières ; mais, dès qu’elles ont pu tenir
une bobine, on leur en a mis une dans les mains, puis deux, puis trois ; si, au
lieu de bobines, on leur avait donné un violon et un archet, si on leur avait
enseigné à jouer du violon comme on leur a enseigné à faire passer une bobine sur
l’autre et à fixer la maille avec une épingle sur leur carreau, elles seraient aujourd’hui violonistes comme elles sont
dentellières.
Si nous voulons que les enfants aiment le chant, faisons-les chanter. Le tout petit
enfant a des facultés d’assimilation merveilleuses, une ouïe d’une sensibilité
extrême, et la preuve, c’est la facilité avec laquelle il apprend à parler. Un
enfant de trois ans arrive à comprendre deux personnes dont l’une lui parle
toujours dans une langue, et l’autre dans une autre. Un de mes petits amis, âgé
de quatre ans, parle le français, l’anglais et l’allemand, parce qu’on lui a
parlé ces trois langues depuis qu’il est au monde. Or qu’est-ce que le langage,
sinon une musique ?
Si nous voulons que l’enfant chante, j’y reviens, il faut
le faire chanter ; mais, avant de le faire chanter, il faut lui faire entendre
de la musique ; c’est donc par les directrices des écoles maternelles qu’il
faut commencer l’éducation musicale.
Les directrices des salles d’asile n’avaient aucune éducation musicale, et le milieu
dont elles sortaient ne leur avait pas inculqué le goût du beau. Aux examens du
certificat d’aptitude, on n’avait exigé comme maximum, jusqu’à ces dernières années, que l’exécution de mémoire d’un chant spécial. Aussi ne trouvons-nous
pas en ce moment dix directrices sur cent capables de déchiffrer en chantant
une phrase musicale. Les chants se transmettent de l’une à l’autre, comme
autrefois les légendes ; chacun y apporte sans le vouloir quelque modification ;
bientôt ils deviennent méconnaissables. Tant que la nullité en musique ne sera
pas un cas d’élimination aux examens, comme la nullité dans toute autre
branche, il nous sera impossible d’améliorer l’enseignement du chant.
C’est donc aux écoles normales à aviser. En Suisse et
en Angleterre, on fait beaucoup de musique dans les écoles normales, et il y a
au moins une pianiste dans chaque école maternelle. En Allemagne, un jeune
homme sortant de l’école normale doit
jouer sur le violon un nombre déterminé d’hymnes religieuses, un nombre égal d’hymnes
patriotiques, un nombre égal d’airs populaires. Le violon est l’instrument par
excellence pour les classes, parce qu’il n’immobilise pas le maître sur un
point quelconque, qu’il lui permet de s’approcher de tel élève dont la voix n’est
pas sûre, de tel autre qui a moins de mémoire musicale malheureusement, le
violon a été jusqu’ici, et je ne sais vraiment pas pourquoi, un instrument
exclusivement réservé aux hommes. S’il est impossible dé vaincre le préjugé, je
voudrais que l’on enseignât l’accordéon aux futures directrices.
Restent pour les institutrices le piano et l’harmonium,
et, malheureusement encore, c’est l’harmonium qui a, jusqu’ici, grâce à la
modicité relative du prix, obtenu la préférence. Je dis malheureusement, parce
que l’harmonium est plus difficile à jouer que le piano; il exige un double
exercice, celui du pied et celui de la main. Trois ans d’étude de piano à l’école
normale donneraient, j’en suis sûre, des résultats plus satisfaisants que le
même temps d’étude sur l’harmonium. Ce n’est pas tout encore, car il faut bien
que je fasse le procès complet de cet instrument, que j’aime cependant beaucoup :
lorsque l’enfant émet un son faux, le seul moyen de le lui faire rectifier, c’est
de lui faire entendre le son juste et de le lui répéter sur l’instrument jusqu’à
ce qu’il ait enfin pu le reproduire ; l’harmonium ne se prête pas à cet
exercice ; à peine la touche est-elle abaissée, ce n’est plus un son tout
simple qu’on entend (je ne me sers pas ici d’expressions techniques, j’essaye
seulement de me faire comprendre de celles de mes lectrices qui sont le moins
musiciennes), et le petit auditeur est troublé. Sur le piano, au contraire, on
peut répéter la note jusqu’à l’infini sans que ce fait se produise.
Donc, étude du chant à l’école normale, étude tout
aussi obligatoire d’un instrument, et, simultanément, éducation du goût par de
fréquentes auditions de bonne musique. L’instituteur doit être un artiste, et ici j’entends par artiste
non pas un individu pour lequel la théorie et la pratique de l’art n’auraient
plus de secrets, mais un individu que l’art émeut, que l’art élève moralement.
En écrivant ce dernier paragraphe, il m’a semblé entendre
une objection qu’on m’a déjà faite cent fois « Si vous demandez tant de choses
aux directrices d’écoles maternelles, le recrutement, déjà difficile, deviendra
impossible.
Je suis absolument convaincue du contraire. Plus le
niveau intellectuel et moral exigé pour la fonction sera élevé, plus nous
trouverons de fonctionnaires jalouses de se montrer à la hauteur. Quand on
choisit la carrière de l’enseignement, ce n’est pas pour faire fortune, puisque
le budget de l’Instruction publique ne permet de donner aux instituteurs qu’une
position modeste ; on la choisit pour être utile, pour exercer une
influence morale sur ses concitoyens. Or il n’y a que la supériorité qui donne
l’influence morale.
Au point de vue purement pratique, d’ailleurs, un instrument
est l’auxiliaire indispensable de la directrice de l’école maternelle, pour
conserver sa voix si elle l’a encore, pour y suppléer si sa rude tâche la lui
fait perdre.
Arrivons aux enfants qui doivent chanter.
Pourquoi doivent-ils chanter?
Comment leur enseigner à chanter?
Les enfants doivent chanter, parce que le chant est un
exercice hygiénique qui régularise le jeu des poumons et la respiration, par
conséquent.
Ils doivent chanter, parce que, dans nos écoles maternelles
si encombrées d’élèves, le chant est un des meilleurs auxiliaires de la
discipline.
Ils doivent chanter, parce que le chant grave dans leur
souvenir, d’une manière ineffaçable, la plupart des leçons qu’on leur a faites.
Ils doivent chanter, parce que le chant est un excellent
exercice de prononciation.
Mais ils doivent chanter, surtout, parce que le chant
est une des expressions les plus naturelles et certainement les plus charmantes
des meilleurs sentiments intimes ; parce que la musique prête aux sentiments de
tendresse, de bonté, de reconnaissance, de joie, de patriotisme, des accents
plus élevés, plus enthousiastes.
Ils doivent chanter, parce que la musique donne du
courage aux faibles et exalte celui des forts ; parce que c’est une langue
idéale, qui rend plus beau ce qui est beau, et meilleur ce qui est bon.
Comment, demandais-je plus haut, leur enseigner à
chanter ?
Oh ! vous m’avez déjà devinée ! vous savez, j’en suis
sûre, à fond toute ma méthode. A l’école
maternelle, l’enfant doit chanter comme l’oiseau chante ; il ne saurait être question
pour lui de théorie.
Il faudra d’abord qu’il aime le chant que vous voudrez
lui enseigner. Mais, pour l’aimer, il faut qu’il le connaisse : chantez-le-lui
une fois, puis une autre, puis une autre encore, pas coup sur coup au moins,
mais de temps en temps, comme récompense.
Les paroles jouent un grand rôle dans l’étude d’un chant.
L’enfant devra en comprendre non seulement le sens général, mais le sens de
chacun des mots en particulier. Ces paroles seront l’expression de sentiments à lui et non de sentiments factices;
elles amèneront une larme dans ses yeux Ou le sourire sur ses lèvres. L’expression
juste, les nuances, viendront, dès lors, presque d’elles-mêmes. Un petit enfant
qui m’est très cher et auquel je reproche souvent de se tenir voûté me disait
un jour : « Quand je chante quelque chose de la France, je me tiens fier
».
Cette assimilation de l’idée, et par conséquent des paroles,
une fois obtenue, reste celle de la musique.
Les directrices tentent l’impossible quand elles cherchent
à enseigner un chant à tout leur petit monde à la fois ; le résultat plus que
négatif que nous constatons dans la plupart de nos écoles maternelles provient
de cette faute du début.
Il faudrait choisir parmi les grands un groupe de cinq
ou six enfants les mieux doués, ceux qui ont la voix la plus juste, – on s’en rendrait compte en les faisant chanter
individuellement, – et leur enseigner le nouveau chant. Quand ils le sauraient absolument,
sans défaillance, quand ils le comprendraient, le sentiraient, le nuanceraient,
on ajouterait à leur groupe quelques chanteurs de plus, choisis encore parmi
les mieux doués; par adjonctions successives, on arriverait à faire chanter le
morceau à tous les enfants, à l’exception de ceux qui ont la voix notoirement
fausse. Ceux-ci doivent écouter, écouter encore, et espérer des jours
meilleurs.
Quand j’aurai ajouté que l’enfant doit chanter debout, la tête droite, les épaules effacées,
et que par conséquent certains (pas
tous), certains exercices de
gymnastique
faits pendant le chant me paraissent absolument contraires à l’émission
naturelle du son et en même temps à l’hygiène, j’aurai dit, je crois, tout ce
que je m’étais promis de dire au sujet de l’enseignement du chant à l’école
maternelle:
Eh non ! car j’ai laissé de côté l’article du
règlement qui a droit à sa place.
« L’enseignement du chant comprend : les
exercices d’intonation et de mesure les plus simples ; les chants à l’unisson
et à deux parties qui accompagnent les exercices gymnastiques et les
évolutions. Les chants sont appropriés à l’étendue de la voix des enfants. Pour
ces exercices, les directrices se serviront du diapason. »
Le règlement exprime d’une façon technique ce que j’ai
raconté en langage familier. L’intonation et la mesure ont eu leur place dans ce qui précède, sans que je les aie
nommées pourtant. Quand on fait émettre un son à un enfant, quand on l’amène à l’émettre
juste, s’il ne l’a pas d’abord fait de lui-même, on lui fait faire un exercice d’intonation. Quand on lui fait
donner à chaque note sa valeur, c’est un exercice
de mesure.
Cependant il y a autre chose sous cette formule. Ces
exercices sont gradués ; ce sont des secondes, des tierces, des quartes. Les
secondes, les tierces, les quartes, etc., sont les éléments de tous les chants, et il est bon que les enfants s’y
exercent. Mais cette étude demande une exactitude absolue. Je tremble quand je la vois entreprendre par des
directrices qui n’ont pas d’instrument pour les guider, dont la voix est
fatiguée, qui n’ont même pas de diapason.
L’enfant qui chante à l’école apporte ses chants d’oiseau
à la maison et il ne les oublie jamais ; après avoir égayé les intervalles
des classes, après avoir rasséréné le front soucieux de la mère de famille, ils
sèchent les pleurs du nouveau-né.
Pour que les mères françaises chantent auprès du berceau
de leurs enfants, faisons de la musique, de la bonne musique à l’école. Certes,
la musique est un art d’agrément mais
cet art d’agrément a une si haute portée éducatrice qu’il est aussi et d’abord
un art de première nécessité.
CHAPITRE XIII
L’ENSEIGNEMENT DU DESSIN
L’enfant doit apprendre à regarder et à rendre compte de ce qu’il a vu.
– Les ardoises. – Les lattes. – Les modèles dits Fröbel. – Les modèles
représentant des objets usuels. – Les dessins d’imagination. – Comment la
directrice fera faire l’exercice du dessin. – Le dessin sur les cahiers.
Le dessin a été considéré pendant longtemps, lui aussi,
comme un art de luxe.
Certes, il est agréable de savoir dessiner ; toute personne
comprenant la nature serait heureuse de fixer sur un album le souvenir des
paysages qu’elle a admirés ; dans les soirées d’hiver, dans les longues
journées de convalescence, le dessin est un compagnon, presque un bienfaiteur.
Mais, si nous l’étudions au point de vue pédagogique, il est plus, il est mieux
que cela, car il fait naître et développe la faculté d’observation. Aussi lui
donnons-nous une place d’honneur dans nos écoles maternelles.
Prenons deux enfants, dont l’un passe auprès des objets
sans les voir, qui laisse errer son, regard et son esprit dans le vague, un de
ces enfants qui répond : « Je ne pense à rien », toutes les fois qu’on lui
demande : « A quoi penses-tu? » – et un autre qui s’intéresse aux choses,
qui veut tout voir avec les yeux et avec les doigts. Il est évident que les
progrès intellectuels du second seront plus rapides que ceux du premier ; il
est évident aussi que l’éducation a des devoirs à remplir envers ces deux
enfants : elle devra habituer l’un à regarder autour de lui, puis à
examiner ; elle devra empêcher l’autre de tout regarder à la fois, de se
contenter d’un coup d’œil superficiel.
Mais quel procédé employer pour l’un et pour l’autre ?
leur donnera-t-elle simplement des conseils ?
Non ! la directrice exercera l’enfant à décrire ce qu’il
a vu.
Pour décrire, il faut avoir des mots à sa disposition,
et, quelque simple que soit l’objet, le vocabulaire d’un enfant de trois ou
quatre ans est trop pauvre pour que celui-ci puisse ébaucher même une
description.
C’est alors que l’ardoise et le crayon entrent
utilement en scène ; l’enfant essaye de reproduire sur l’ardoise ce qu’il a
devant les yeux. Je sais qu’au début c’est presque toujours informe, horrible.
Qu’est-ce que cela me fait ? Que l’enfant regarde, qu’il voie, le reste viendra ensuite.
L’ardoise et le crayon sont en scène, ils doivent y rester,
de même que le tableau noir. La directrice vient de raconter une histoire, ses
petits auditeurs ont été intéressés, plusieurs lui en ont rendu compte, tel
détail passé inaperçu de l’un a justement frappé l’esprit de l’autre,… qu’elle
fasse dessiner par chacun des enfants la scène dont il s’est le mieux rendu compte,
et l’histoire tout entière finira par vivre
véritablement devant eux. Je vous le répète, au point de vue du dessin, ce sera
horrible ; mais, je vous le répète aussi, cela ne me fait rien, parce que je
suis sûre que le mieux viendra. Ce qui me préoccupe avant tout, c’est le but à
poursuivre et à atteindre. Si aujourd’hui les éditeurs nous donnent des livres
illustrés d’images, – même les livres d’arithmétique, – est-ce pour qu’ils
soient plus jolis, pour qu’ils frappent davantage l’œil ? Peut-être ! Mais c’est
surtout pour que l’image vienne au secours de la phrase imprimée, c’est parce
que nous faisons véritablement de l’enseignement par les yeux, persuadés que nous
sommes que, lorsque l’enfant a vu, il a presque toujours compris. J’en conclus
que le tableau noir et la craie doivent être inséparables d’un bon enseignement ;
un seul trait en dit souvent plus qu’une longue phrase.
Crayonner est un des bonheurs des enfants. Je crois
que c’est, après le sable, ce qu’ils aiment le mieux ; les ardoises
devront être posées à leur portée, de manière qu’ils puissent les atteindre
toutes les fois qu’ils le désirent. Les bonnes tables ardoisées réalisent sur
ce point notre idéal. J’ai vu des enfants de quatre ans racontant une histoire
et reproduisant la scène sur l’ardoise, grâce à une série de points : « Ce
gros-là, c’est le papa, puis voilà la maman, plus petite, et tous les enfants
qui vont à la promenade. »
Mais ce sont là des idées générales, des « aperçus ».
C’est que je voudrais établir d’abord l’utilité
pédagogique du dessin tant pour les instituteurs que pour les enfants. Je
voudrais que les directrices fussent bien convaincues qu’il excite et développe
l’esprit d’observation, qu’il donne de la rectitude à l’œil, qu’il est, en même
temps qu’un plaisir, un des meilleurs moyens de faire l’éducation des doigts,
qu’il est enfin un des plus utiles auxiliaires de l’instituteur.
Bien des raisons, vous le voyez, militent en faveur du
dessin à l’école maternelle, et toute directrice digne de ce titre ou qui
aspire à s’en rendre digne doit dessiner elle-même et faire dessiner ses petits
élèves. Le dessin doit entrer comme exercice régulier dans l’emploi du temps de
l’école maternelle ; tous les enfants des deux sections devront dessiner tous les
jours.
Le dessin, dit le règlement du 2 août, sera d’abord la
reproduction sur l’ardoise des figures faites sur la table, à l’aide de lattes
ou de bâtonnets.
Rien de plus simple : une latte placée en long, en large,
en diagonale donnera les trois différentes espèces de lignes droites, dont les
noms sont inaccessibles et inutiles aux enfants, à ceux, surtout de la première
section.
Que de combinaisons déjà avec deux lattes ! En écrivant
la phrase qui précède, j’en ai ébauché dix ! A plus forte raison si nous
augmentons le nombre des lattes.
Ces combinaisons peuvent être faites par des enfants de
trois ans, si cela les amuse.
Revenons à notre premier exercice. L’enfant a placé
une latte sur sa table dans le sens vertical. La directrice reproduit la ligne
au tableau noir ; tous les enfants la tracent sur l’ardoise. Cette ligne
est effacée, tant sur l’ardoise que sur le tableau ; les petits élèves la
tracent de nouveau sur leur ardoise. De même pour l’horizontale, de même pour l’oblique,
de même pour les combinaisons de lattes qui seront faites dans les exercices
suivants.
Nous le répétons : dans les premiers jours, les petites
mains malhabiles ne traceront que des choses informes, mais les directrices ne
devront pas s’en effrayer, se dire que c’est impossible ; nous leur assurons au
contraire que « cela viendra ». Cela est déjà venu dans beaucoup d’écoles
maternelles : les directrices ont trouvé dans le dessin un élément
éducatif très sérieux et les enfants un passe-temps agréable.
La reproduction sur l’ardoise des figures faites au
moyen de lattes est beaucoup plus facile pour l’enfant que celle d’un modèle
tracé préalablement au tableau noir. C’est lui-même qui a fait cette figure, il
sait de combien de lattes elle se compose, il se rappelle dans quel ordre il
les a posées, par quel point elles touchent l’une à l’autre. Bientôt il
comprendra le modèle fait au tableau ; c’est vraiment là ce que nous appelons
aller du connu à l’inconnu.
Autant que possible, il faut que ces figures composées
à l’aide de lattes représentent des choses que l’enfant connaît, dont il sait
parler. Deux lignes parallèles, verticales, en tant que parallèles et verticales,
n’ont pour lui aucun intérêt ; mais, si elles deviennent les deux montants de
la porte ou les deux cordes pendantes du gymnase, ce sont pour eux de vieilles
connaissances qu’ils prennent plaisir à reproduire. Si ces parallèles sont
horizontales, ce seront les rails du chemin de fer. Deux lignes droites formant
des angles aigus, obtus, représentent différents écartements du bras et de l’avant-bras.
C’est très important ! les enfants feront de la géométrie, et de la bonne, sans
s’en apercevoir, en s’amusant ; le tout est de savoir s’y prendre. Avec trois
lattes ils feront une chaise, quelle joie ! Il y a là une mine pour une directrice
intelligente et de bonne volonté.
L’enfant de la seconde section peut comprendre le modèle
fait sur le tableau.
Quelle collection choisira la directrice ? Les modèles
dits Frœbel, c’est-à-dire surtout du dessin d’ornement ? Je ne crois pas devoir
l’y engager, si ce choix devait être exclusif. Certes, il est bon de savoir
faire un carré, puis dans ce carré une étoile, et d’enserrer carré et étoile
dans une ligne courbe ; l’enfant réussit même très bien ce genre-là ; mais il
préfère de beaucoup – c’est un fait acquis – les objets qu’il voit, dont il se
sert, qui sont ses choses ; ensuite l’habitude
de ces dessins devient une routine ; l’observation n’a plus rien à faire, le
travail est tout machinal ; enfin ce genre de modèle laisse de côté ce qu’il
y a de plus utile dans l’enseignement du dessin, je veux parler du sens des
proportions relatives des objets.
J’engage donc les directrices à varier : qu’elles
ajoutent à quelques dessins d’ornement un plus grand nombre de modèles
reproduisant des objets usuels, et qu’une fois par semaine elles fassent faire
un dessin d’imagination, c’est-à-dire ce que chaque enfant « voudra »
faire. Il serait même bon, ce jour là, de retourner l’ardoise du côté non
quadrillé, pour que l’enfant fût tout à fait livré à lui-même.
Mais les modèles ! il faut qu’ils soient faits aux tableaux noirs ; j’emploie le
pluriel avec intention, parce qu’un seul tableau est tout à fait insuffisant, surtout
dans les écoles où les élèves travaillent encore aux bancs latéraux. Ces
modèles doivent être faits en présence des enfants, et bien en vue, – cette
recommandation est moins puérile qu’elle ne le semble, – bien en vue de tous
les petits dessinateurs.
On ne se rend pas toujours compte qu’un modèle, bien
éclairé pour un groupe d’enfants, est dans l’ombre pour un autre groupe. La
directrice doit donc s’assurer que tout le monde voit ; pour cela, il faut qu’elle
s’assoie aux bancs, à plusieurs places successives, qu’elle se fasse aussi
petite que ses petits élèves.
Et puis, pour le dessin comme pour toute chose, l’enfant
doit être guidé ; il faut surveiller la tenue, rectifier les lignes mal faites.
Naguère encore – c’est-à-dire avant le sectionnement – les uns dessinaient pendant
que les autres lisaient, et, comme, avec la meilleure volonté du monde, une
directrice ne peut être partout, ni la lecture ni le dessin n’étaient vraiment
surveillés.
Voici comment il faut procéder : Les enfants
munis de leurs ardoises et de leurs crayons – de la façon la plus expéditive, –
la maîtresse se met devant le tableau noir, tout
noir ; elle dessine un trait, en indiquant bien la manière de s’y
prendre. « Dessinez ce trait », dit-elle aux enfants. « Montrez vos
ardoises, sans sortir de vos places... » D’un coup d’œil ou d’un mot elle
encourage ceux qui ont bien fait ; elle va vers l’enfant qui n’a pas réussi, le
fait recommencer sous sa direction, amène l’enfant paresseux à travailler
aussi, puis elle dessine le second trait.
« C’est bien long ! » pense-t-on peut-être. Pas autant
qu’on pourrait le croire. C’est une question de discipline, d’habitude à
prendre, d’éducation en un mot. Ce qui m’a le plus frappée dans les écoles
maternelles de Londres, c’est que tous
les enfants exécutaient l’exercice indiqué. A l’heure du pliage, tous pliaient ; à l’heure du dessin, tous dessinaient.
Le dessin se fait à l’ardoise, mais nous ne réprouvons
pas – comme luxe ou comme récompense, une fois par semaine – l’usage des
cahiers. Nous verrons avec plaisir les directrices mettre dans les mains des enfants
des crayons de différentes couleurs. Un cahier bien fait – par l’élève –fait plaisir aux parents un jour de fête ou le premier
janvier; or, tout jeune encore, il est bon que l’enfant comprenne que l’on n’a
de vrai bonheur que celui que l’on fait aux autres.
CHAPITRE XIV
LES RÉCITS HISTORIQUES
L’enseignement de l’histoire est peut-être celui qui donne le moins de
résultats dans les écoles primaires. – Pourquoi ? – Les facultés que l’histoire
met en jeu. – L’histoire est-elle à la portée des enfants de l’école maternelle
? – Quelles qualités doit avoir la directrice pour enseigner l’histoire ? –
Bayard. – Etienne Marcel et du Guesclin. – Turgot et La Tour d’Auvergne. –
Palissy et Michel de L’Hôpital. – La féodalité. – Jeanne d’Arc. – La Patrie. –
Conclusion.
Le règlement du 2 août a fait une part à l’enseignement
de l’histoire. « Les premiers principes d’éducation morale devront inspirer aux
enfants le sentiment de leur devoir envers leur patrie. » « Les récits porteront
sur les grands faits de l’histoire nationale. »
L’enseignement de l’histoire est, sans doute, celui qui
présente le plus de difficultés, car c’est la partie du programme qui a jusqu’ici
donné le moins de résultats dans les écoles primaires. L’histoire serait-elle
donc moins intéressante que la grammaire ou que l’arithmétique ? Non,
certainement ! Mais prenez un livre d’arithmétique, quel qu’en soit l’auteur,
vous y apprendrez les diverses combinaisons d’unités, la théorie des opérations
fondamentales. Les vérités scientifiques que contiendra le livre pouvant être
présentées d’une façon plus ou moins claire, il sera plus ou moins agréable à
consulter ; mais il n’y a jamais qu’une manière de former les nombres, on ne
les compose que par l’addition et la multiplication, on ne les décompose que
par la soustraction et la division. L’arithmétique, en un mot, est une science
précise qu’il est facile de débiter par tranches, – permettez-moi cette
expression vulgaire. – De tel à tel âge on en apprend ceci, de tel autre à tel
autre on en apprend cela, et un instituteur qui ne saurait que ce qu’il doit
enseigner à ses élèves, mais qui le saurait bien,
pourrait le leur bien enseigner. On peut donner, par exemple, une excellente
leçon sur les fractions décimales sans savoir extraire la racine carrée d’un
nombre ; comme aussi, dans un tout autre ordre d’idées, on peut dire tout
ce qu’il y a à dire sur le chêne sans
avoir jamais entendu parler du palmier.
On ne me fera pas, je l’espère, l’injure de penser que
j’engage les instituteurs à se contenter, pour tout bagage scientifique, de ce
qu’ils doivent enseigner à leurs élèves ; non ! Je veux seulement
établir ceci : c’est qu’il y a des études qui demandent plus ou moins des
facultés de l’individu, tandis que l’histoire les exige toutes :
intelligence, raisonnement, comparaison, esprit critique, mémoire et
conscience, mais conscience surtout, et que c’est parce qu’on ne lui a pas
donné tout cela qu’elle s’est montrée avare et que les résultats sont presque
nuls.
L’histoire, trop souvent regardée comme un tableau chronologique
ou comme un simple récit, est autre chose qu’un récit, autre chose qu’un
tableau chronologique. Les faits qu’elle raconte, les hommes qu’elle met en
scène, il faut pouvoir les comprendre, les discuter, les juger. Des faits dont
on ignore et les causes et les résultats ne sauraient intéresser ; des hommes dont
le caractère, les mœurs, les habitudes, la civilisation sont inconnus sont
comme des espèces d’énigmes dont le mot est indéchiffrable. Malheureusement, les
débuts ont paru si arides que presque personne n’a cherché à deviner ces
énigmes, et que l’enseignement de l’histoire a été frappé de stérilité. Avec
une peine infinie, les enfants ont appris qu’à Hugues Capet a succédé Robert le
Pieux, à Robert le Pieux Henri Ier ; que la première Croisade a été
prêchée en 1095 ; quelques-uns ont été jusqu’à mettre dans une case de leur
mémoire que la Révolution française a pour date 1789, et que Napoléon Ier
s’est fait proclamer empereur en 1804, et ils sont restés froids.
Ils sont restés froids, surtout, parce qu’il leur
était impossible de placer les faits et les hommes dans un cadre approprié.
Comment comprendre, par exemple, la vraie grandeur de
Charlemagne, celle qui consiste dans son rôle de civilisateur, s’ils ignorent
que personne en France à cette époque – sauf quelques moines – ne savait lire ?
Pourraient-ils se figurer, ces petits enfants du XIXème siècle, que
personne ne sût lire, si on ne leur dit pas qu’il n’y avait pas de livres à
cette époque, et que quelques manuscrits copiés à grand’peine coûtaient des
sommes considérables.
Comprendront-ils mieux que l’on ait honoré Louis VI du
titre de Père des communes s’ils n’ont
pas une idée de la féodalité ?
Et puis on a eu le grand tort, dans les écoles, de s’attarder
au passé, de raconter toujours aux enfants les batailles du moyen âge, de les
mettre en rapport exclusivement avec des hommes qui diffèrent trop sensiblement
de ceux qu’ils connaissent aujourd’hui ; on a eu le tort, surtout, de ne leur
parler que des héros de la guerre, au lieu de leur parler des héros de la paix,
des hardis navigateurs qui ont découvert des terres inconnues, des travailleurs
obstinés, des chercheurs qui ont changé par leurs inventions successives les
conditions de la vie matérielle, des penseurs et des écrivains qui ont agrandi
jusqu’à l’infini le champ de la vie intellectuelle, des artistes qui nous ont
appris à aimer le beau, des enthousiastes qui nous ont donné l’exemple du
dévouement.
Tout le mal est venu des précis ; tout le mal est venu
de ce qu’on a fait travailler la mémoire seulement, alors que les facultés les
plus nobles de l’intelligence devaient être mises enjeu.
Pour apprendre l’histoire, c’est-à-dire pour la
comprendre, pour l’aimer, je dirai presque pour s’y passionner, je ne connais
qu’une méthode : lire. Lire, en prenant des notes s’entend. Mais il ne s’agit
pas de lire un seul auteur, de le lire jusqu’à mémoire complète des termes qu’il
a employés, de le lire jusqu’à satiété. Non ! il faut lire plusieurs
auteurs, lire et comparer. Celui-ci a insisté sur tel détail, celui-là sur tel
autre. L’un se complaît à la description des batailles, l’autre préfère la
peinture des mœurs, un troisième étudie surtout les caractères. Tel historien juge
les faits par leurs résultats politiques, c’est-à-dire par l’influence qu’ils
ont eue sur les rapports des gouvernements avec le peuple, ou sur les rapports de
la France avec les peuples étrangers ; tel autre les envisage surtout par
leurs résultats sociaux, c’est-à-dire par l’influence qu’ils ont sur les lois
et les mœurs de la nation ; tel autre encore, au point de vue philosophique, c’est-à-dire
par leur influence sur les idées. Mais cette influence politique, sociale,
philosophique fait partie intégrante de l’histoire ; on ne peut connaître l’histoire
si l’on ne s’en est pas rendu compte ; on ne peut enfin l’enseigner si l’on ne
s’est fait une conviction, et la
conviction est la récompense acquise aux seules études sincères et
approfondies.
Mais alors… l’histoire n’est pas à la portée des enfants
de l’école maternelle ? En principe, non.
Faut-il la supprimer ? En principe, oui.
Mais dans la pratique ? Tout dépend de la directrice. Possède-t-elle
bien son sujet ? a-t-elle un tact assez sûr pour bien choisir ses leçons ?
a-t-elle le don d’émouvoir ?
J’appelle « posséder » son sujet, savoir non seulement
le fait en lui-même, mais les circonstances qui l’ont produit et ce qui en est
résulté. S’il s’agit d’un homme, le placer dans son milieu, le seul où il puisse paraître vivant, le seul aussi qui
permette d’expliquer ses sentiments et ses actes.
Je me trouvais, un jour, dans une école soigneusement
sectionnée ; plusieurs personnes s’intéressant à l’éducation des petits enfants
m’accompagnaient. Dans la division des grands, – ils avaient six ans pour la
plupart – le nom de Bayard revenait à chaque instant. Les enfants, très
vivants, très développés, racontaient ses hauts faits, son dévouement à son
roi, ses fières paroles au traître Bourbon, sa mort. Leur mémoire fonctionnait
merveilleusement.
« Vous voyez comme ils savent bien ! me dit la directrice,
à qui j’avais contesté le sujet choisi. En effet. Mais croyez-vous que ce
petiot qu’on élève maintenant-en républicain, et qui a pu entendre parler des
rois avec quelque sévérité, pensez-vous que ce petiot s’explique l’enthousiasme
de Bayard pour François Ier ? Comprend-il, cet enfant, qui ne peut, quoiqu’on en pense, s’élever à l’idée de
la Patrie, comprend-il qu’en ce temps-là le roi la personnifiait ? Peut-il se
rendre compte des guerres auxquelles le héros a été mêlé ? »
Ma conviction pénétrait difficilement dans l’esprit de
la directrice ; elle s’était habituée à croire que son monde comprenait. Je m’adressai
alors au plus éveillé de la classe « Connais-tu Bayard ? l’as-tu vu ? lui as-tu
parlé ? – Non. – Et ton papa, l’a-t-il vu ? – Il ne me l’a pas dit. – Cela ne m’étonne
pas, car il y a plus de cent ans, vois-tu, que Bayard est mort, et plus de deux
cents ans, et plus de trois cents ans. – Alors ! c’était avant la création du
monde », s’écria l’enfant, qui savait si
bien l’histoire du Chevalier sans peur et sans reproche.
Le choix n’était pas mauvais cependant. Mais le portrait
n’était pas dans le cadre.
Savoir choisir !...
Voici, par exemple, deux hommes qui ont vécu à la même
époque, Etienne Marcel et du Guesclin. Du Guesclin est un guerrier dont la vie
est une série d’actes et dont l’enfance
mouvementée intéresse un auditoire de six ans. Cet homme de guerre est non seulement
loyal, mais généreux. Tout cela est à la portée des enfants, si l’on sait s’y
prendre.
Que leur dire d’Étienne Marcel ? Qu’il a mis son chaperon
sur la tête du dauphin Charles ? Eh oui ! On ne manque jamais de raconter cet
incident. Mais pourquoi l’a-t-il mis ? Quelles circonstances ont fait pendant
un instant d’Étienne Marcel le protecteur du régent ? Ce sont là des questions
de politique absolument incompréhensibles pour les enfants de l’école maternelle,
et dont on ne parle même que sobrement à ceux de l’école primaire.
Je choisirais du Guesclin, et je laisserais de côté Étienne
Marcel.
Un autre exemple, voulez-vous ? Turgot et La Tour d’Auvergne,
contemporains aussi.
Une directrice de bonne volonté, comprenant jusqu’à un
certain point la difficulté d’intéresser les enfants aux idées économiques de
Turgot, a essayé devant moi, un jour, de leur expliquer le budget de l’État en
prenant pour point de départ celui de la famille. Mais le budget de la famille
dépasse absolument le niveau intellectuel d’un enfant de cinq ans ! A cet âge,
un de mes fils était persuadé que le boucher, le boulanger, l’épicier et le
marchand de nouveautés me fournissaient l’argent en même temps que la viande,
le pain, le sucre et les étoffes. Ne me rendaient-ils pas en monnaie beaucoup
plus que je ne leur donnais en pièces d’or ou d’argent ?
La Tour d’Auvergne criant : « Qui veut dîner me suive!
» traversant une rivière à la nage, culbutant les Espagnols et régalant ses
troupes d’un festin préparé par l’ennemi, est à la portée de l’intelligence enfantine.
La Tour d’Auvergne, reprenant l’uniforme à l’âge de cinquante ans pour exempter
le fils de son ami, fait tressaillir le cœur de l’élite de l’école maternelle.
Je choisirais La Tour d’Auvergne, je laisserais de côté
Turgot.
Bernard Palissy, luttant pour la découverte de l’émail,
intéresse les enfants ; le chancelier de L’Hôpital, luttant pour la tolérance,
les laisse froids : ils sont à la hauteur du fait et non à la hauteur de l’idée.
Quand le choix est fait, – choix qui ne peut être que relativement bon dans la plupart des cas,
– la manière de présenter le récit prend une importance capitale. Peut-on
risquer par exemple à l’école maternelle une leçon sur la Féodalité ? Non, sous
forme de leçon ; mais une directrice qui comprend bien cette époque de notre
histoire peut montrer à ses petits élèves une de ces charmantes maisons de
campagne qui s’élèvent un peu partout dans notre riche pays de France, et
mettre en regard de cette construction hospitalière une image représentant un
château fort ; elle leur décrira alors cette habitation sombre et lugubre,
entourée de fossés profonds, située sur une hauteur presque inaccessible. On se
cachait là dedans, parce qu’on avait peur, et l’on avait peur parce qu’on était
méchant ; de là les horribles guerres perpétuelles. En ce temps-là, le peuple
était serf, attaché à la terre, quasi esclave. « Les ouvriers ne travaillaient
pas librement comme vos papas, leur dira-t-elle ; ils travaillaient pour les
nobles, qui étaient leurs maîtres. »
Si les enfants ne doivent pas avoir le cœur étreint en
accompagnant Jeanne d’Arc sur la route hérissée de dangers qui la conduisit de
sa chaumière à la cour de Charles VII ; s’ils ne sont pas haletants d’émotion quand
elle fait son entrée à Orléans, bannière déployée ; s’ils ne ferment pas
les yeux pour ne pas voir les flammes de son bûcher s’enrouler autour d’elle, je
demande qu’on ne leur parle pas de Jeanne d’Arc.
Si, grâce aux descriptions de la directrice, cet être abstrait,
la Patrie, ne peut prendre corps ; si l’imagination des enfants ne s’élance
pas, comme l’oiseau bleu des contes de fées, à la découverte du doux et splendide
pays ; s’ils doivent rester froids, s’ils doivent réciter, en chœur : «
Oui, nous aimons notre Patrie ! » comme ils récitent en chœur la table de
multiplication, je demande qu’on ne leur parle pas de la Patrie.
La Patrie,
pour ces petits enfants, ce n’est pas, ce ne peut pas être le pays de
Charlemagne et de du Guesclin, celui de la Féodalité et, de la Renaissance, celui
des guerres de Religion et de la Révolution française. La Patrie, pour eux, c’est
le pays des cerisiers aux fruits rouges et de la vigne aux grappes vermeilles.
C’est le pays où le brillant soleil ne. Brûle pas, où le froid ne raidit pas
les membres et permet de faire des boules de neige. C’est le pays où les papas
travaillent de bon cœur et où les mamans ont des trésors de tendresse.
Dans les autres pays, il y a aussi de bonnes et de belles
choses, car le soleil luit pour tout le monde. Partout les papas travaillent
pour leurs enfants ; partout les mamans ont des trésors de tendresse, mais notre
doux pays de France est, de tous les bons pays, le … « plus bon » pays.
Nous concluons, expérience faite, que l’on doit être très sobre de récits d’histoire de
France à l’école maternelle.
CHAPITRE XV
LA LEÇON DE CHOSES
La leçon de choses est la leçon par excellence, parce qu’elle est
intimement liée à l’acquisition de la langue maternelle et à la culture de tous
les sens. – La mère ne donne pas de leçon
à son petit enfant. – Une règle absolue pour la leçon de choses. – La leçon de
choses doit être graduée ; ce qui convient aux grands ne convient pas aux
petits. – En quoi consiste le talent de l’instituteur. – Ce que l’enfant doit
savoir. – La vie de l’école est une leçon de choses ininterrompue, si la
directrice sait s’y prendre. – Comment elle doit préparer sa leçon quand elle en fait une. – Résumé.
Ce qui est, dans l’école maternelle comme dans la famille,
la leçon par excellence, c’est la leçon
de choses. C’est la leçon par excellence, parce qu’elle est intimement liée
à l’acquisition de la langue maternelle et à la culture de tous les sens. L’enfant
prend des leçons de choses dès le berceau. Grâce à la curiosité de ses yeux
avides de voir, de ses doigts avides de toucher, de ses narines avides de
sentir, de ses oreilles avides d’entendre, de son palais avide de goûter, les
leçons se succèdent, se multiplient, se lient entre elles et se confondent. Si
la mère peut, grâce à sa culture
intellectuelle, revêtir du mot propre
chaque sensation, chaque idée de l’enfant, si elle peut lui nommer ce qu’il
voit et ce qu’il touche, il se développe dans des conditions excellentes.
Ces notions, elle ne les donne pas à brûle-pourpoint,
sans y être sollicitée ; a-t-on jamais vu une mère intelligente essayant de
faire prononcer à son bébé le nom d’un objet qui n’est pas à la portée de son
regard ? Et, quand il a grandi, qu’il sait parler, l’a-t-on jamais vue l’asseoir
sur une chaise et lui dire : « Bébé, sois bien sage ; mets les mains
au dos ; écoute ce que je vais te dire : voici un objet qui s’appelle un
soufflet, il sert à activer le feu ; on le fait aller comme cela. » Non !
l’enfant s’est emparé du soufflet qui était à sa portée, il l’a tourné,
retourné, il est arrivé à en écarter, à en rapprocher les deux moitiés, il a
recommencé et recommencé encore. La mère intervient alors : C’est le soufflet. « Souffle avec la
bouche, comme le soufflet. » La leçon est donnée, il n’a pas fallu de gradin ni
de table, il n’a pas fallu surtout commencer par faire disparaître toute la
spontanéité de l’enfant, en lui disant : « Sois bien sage, écoute », et c’est
l’enfant lui-même qui a fourni les éléments de sa propre instruction.
Règle absolue : l’enfant doit voir la chose sous toutes ses faces, sous tous
ses aspects, le dessus et le dessous, l’intérieur et l’extérieur ; il doit
la voir dans la lumière et dans l’ombre, avec les yeux, mais aussi avec les
doigts, – car il ne voit bien que ce qu’il touche ; – il doit la sentir si
elle a de l’odeur, l’écouter si elle a du son, la goûter si elle a de la saveur.
La leçon que l’enfant a provoquée est, pour lui, la meilleure
; essayons de la lui faire provoquer. En tout cas, amenons-le à la désirer.
Rien de plus facile à l’école. Si, en effet, l’école maternelle est ce que nous
la rêvons, si l’enfant a été autorisé à y apporter le matin l’objet qui l’intéresse,
s’il est libre de ses mouvements au lieu d’être assis, s’il est dans le jardin
au lieu d’être dans le préau, et, par conséquent, dans des conditions
favorables aux découvertes, la directrice doit s’attendre à une infinité de
questions.
Pour les traiter à
fond, il lui faudrait une instruction scientifique que peu de personnes
possèdent, mais on ne lui demande pas de les traiter à fond ; on la prie, au contraire, de ne pas l’essayer, car cette prétention,
– absolument injustifiée d’ailleurs, puisqu’un spécialiste seul est en état de
le faire, – cette prétention est une des erreurs les plus graves de nos écoles
maternelles. La leçon de choses y est pour l’enfant de trois ans la même que
celle de la section des grands ; celle de la section des grands est la même que
celle de l’école primaire ; celle de l’école primaire est, bien souvent aussi,
disproportionnée, si bien qu’il faudrait presque monter jusqu’à la Faculté des
sciences pour y trouver le type de la leçon unique que subissent les étudiants de tout âge, à commencer par
ceux qui ne savent pas parler.
Voici un exemple le mouton (un sujet dont on use et
dont on abuse dans les écoles). Le mouton est un ruminant pour la section des petits, comme il est un ruminant pour la section des grands,
comme il sera un ruminant pour les
enfants de l’école primaire, capables seuls de comprendre – si elle leur est
bien expliquée – cette leçon de physiologie. Ce mouton ! l’enfant le prend dans
le pré, –, c’est tout juste s’il comprend – il le conduit à l’abattoir, de l’abattoir
à la boucherie, de la boucherie – ce qu’il en reste du moins – à la tannerie, à
la filature, au tissage, au magasin de nouveautés, à la fabrique de chandelles,
à l’usine de noir animal, etc. Quel voyage! un voyage à toute vapeur, où les
cahots ne sont pas épargnés et où les tunnels sont nombreux. Ce ne sont presque
que des tunnels ! les pauvres petiots sont ahuris et n’y voient goutte. – Cependant,
me dira-t-on, si un petit curieux – un brave enfant, celui-là – demande : «
pourquoi l’animal, quand il ne broute plus, fait-il encore et sans cesse aller
sa bouche ? » II faut lui répondre, mais pas en lui parlant des trois estomacs :
en lui disant qu’au lieu de mâcher peu à peu leur nourriture, comme nous, et comme
la plupart des autres animaux, les moutons coupent d’abord toute l’herbe de
leur repas et l’avalent ; puis que, en prenant leur temps, ils la font
revenir peu à peu dans leur bouche, pour la mâcher. Je suis sûre que l’enfant
sera satisfait.
Le talent de l’instituteur consiste, d’ailleurs, à
penser non pour lui-même, mais pour ses élèves. Il ne doit pas se croire obligé
de dire tout ce qu’il sait du sujet
qu’il traite : il doit au contraire se demander ce qui, de ce sujet, peut
convenir aux enfants ; il doit savoir trier et présenter à chacun la nourriture
qui convient à son âge, et avec une préparation telle qu’il se la puisse bien
assimiler.
Or l’enfant doit savoir le nom de l’objet, en quoi il est
fait, et ce qu’on en fait. S’il s’agit d’un animal : son nom, sa
nourriture et alors, autant que possible, son caractère, ses mœurs. « Un chien
qui avait naguère accompagné à l’hôpital son maitre blessé, ayant été lui-même
victime d’un accident, est allé se présenter au concierge du même hôpital ! »
Voilà ce qui intéresse les enfants de l’école maternelle. La sollicitude de la
poule pour ses poussins, celle de la chatte qui nourrit ses petits, les frappe
autrement que le nombre de pattes de la première et les ongles rétractiles de la
seconde. Il faut mettre la leçon au point.
Il importe que les enfants sachent le nom de l’arbre à
l’ombre duquel ils jouent et les caractères auxquels ils reconnaîtront les
arbres de la même espèce ; il importe qu’ils sachent le nom du réséda qui
embaume la plate-bande, du volubilis qui s’enroule autour de la claire-voie, du
chèvrefeuille et de la clématite qui forment au fond du jardin un berceau
odorant ; le nom aussi des marguerites qui étoilent les prés, des bluets et des
coquelicots qui égayent les champs de blé, du muguet dont les clochettes
délicates donnent chaque année le signal du printemps ; de la rose, reine des
jardins. Il importe que l’enfant sache que le pain qu’il mange est fait avec du
blé réduit en farine ; que le linge qui couvre son corps vient d’une plante
à la fleur délicate ; que sa veste ou sa robe est faite avec la laine du mouton
; que le corps de la chaise sur laquelle il s’assoit a été découpé dans le tronc
d’un arbre, et que le siège de paille est fait avec la tige du blé. Le bouchon
de sa bouteille vient de l’écorce d’un arbre : le chêne-liège ; l’eau
qu’il boit a été puisée à la source qui épanche son eau claire sur les cailloux ;
c’est la vache qui lui donne son breuvage de prédilection ! le lait, etc., etc.
Toutes ces choses, dites au moment spécial où la curiosité de l’enfant était
excitée, se gravent dans sa mémoire, et il est rare qu’il les oublie. La vie
active de l’école est une leçon de choses ininterrompue, si la directrice sait
s’y prendre.
Une fois ou deux par semaine, la directrice peut aborder avec les plus grands une
vraie leçon de choses. Cette leçon, elle la préparera d’avance avec soin ; elle
fera d’abord son plan, pour qu’il n’y
ait pas de confusion dans les notions données ; elle en étudier a toutes
les parties, car il faut d’abord connaître son sujet, non pas pour tout dire,
mais pour savoir faire le triage et pour pouvoir répondre aux questions inattendues.
Mais le savoir n’est pas tout, il
faut encore la clarté, la vie, le charme du langage ; il faut que la leçon
s’adresse à l’intelligence et non à la mémoire, et, quand le sujet le comporte, mais seulement alors, elle doit s’adresser
aussi au cœur.
On ne peut donc inventer
ex abrupto une leçon pareille ; il faut la préparer assez sérieusement pour que
tout ce qui est vérité scientifique soit devenu conviction dans l’esprit de la
maîtresse ; pour que, débarrassée du malaise que fait éprouver le doute, elle
puisse se mettre à la portée de son petit auditoire, le captiver par l’originalité
de l’exposition, par la variété des exemples, par l’intérêt des anecdotes.
Cette préparation intellectuelle doit être suivie de la
préparation écrite. Il faut que chaque mot soit pesé, chaque terme abstrait
remplacé par un terme à la portée des enfants, que la directrice soit enfin absolument
maîtresse d’elle-même quand elle arrive devant son petit auditoire.
Un tel travail suppose non seulement ce désir de bien
faire que j’appellerai la « conscience de l’étude », mais encore un amour
patient et persévérant de la vérité, et un sentiment profond de la nécessité qu’il
y a d’écarter toute erreur de l’esprit encore neuf des enfants. Et cela demande
de longues recherches ; car ce n’est pas seulement un livre qu’il faut
consulter, c’est souvent deux, c’est cinq, c’est dix, suivant le besoin.
S’agit-il d’un animal, la directrice étudiera le
chapitre de zoologie qui le concerne ; s’agit-il d’une plante, elle consultera
des ouvrages de botanique ; veut-elle faire connaître à ses petits élèves
un objet manufacturé, elle en étudiera d’abord la matière première, puis elle
fouillera dans les livres qui traitent spécialement des questions industrielles
sur lesquelles il importe qu’elle se renseigne.
Mais les livres ne suffisent pas : il faut voir,
expérimenter, étudier sur le vif. La leçon de choses, pour tout professeur
consciencieux, c’est presque l’infini.
On m’objectera peut-être qu’avec le matériel
insuffisant et le peu de temps dont disposent les directrices d’écoles
maternelles, ce que je demande est impossible. Oui, si l’on tient surtout à
parler aux enfants de crocodiles, de serpents à sonnettes, d’ananas et de
bananes ; non, si l’on choisit pour sujets de ses leçons les choses qui sont à
la portée de tous : chiens, poules, cerises, pommes de terre, etc.
Mais entendons-nous bien : c’est l’objet lui-même
qu’il faut montrer, et non des imitations informes propres à donner des idées
fausses aux petits élèves.
Qu’on se garde donc des monstres en carton ciré, des
fleurs artificielles, des fruits en plâtre, des oiseaux en verre soufflé. Qu’on
ne choisisse pas l’été pour faire une leçon sur la neige ; l’hiver, pour en faire
une sur les cerises.
La maison d’école, celle de la
directrice, celle des enfants, l’atelier où travaillent leurs pères, leurs
jardins, la grande route, la campagne environnante fourniront le meilleur
musée, je dirais presque le seul que doive posséder l’école maternelle.
La leçon faite, restent les interrogations, par
lesquelles la maîtresse s’assure qu’elle a été comprise. J’engage les
directrices à poser les questions de telle façon que les enfants n’y puissent
pas répondre par oui ou par non, et même, comme cela arrive trop souvent,
par un signe de tête. S’ils ont compris, les réponses doivent être justes et
claires. Les questions doivent s’adresser à
un seul enfant, qui réfléchira avant de répondre. S’il n’arrive pas, à lui
tout seul, à formuler sa pensée d’une manière satisfaisante, il sera aidé par
un camarade, puis par un autre ; la directrice s’en mêlera si c’est
nécessaire, et la réponse enfin obtenue sera répétée par tous les enfants. Puis
on cherchera des exemples, des comparaisons ; les enfants feront leurs
objections, raconteront leurs souvenirs personnels.
En résumé, la leçon de choses doit être d’abord appropriée
aux enfants qui la reçoivent.
Elle doit être faite, sans exception, avec l’objet
lui-même ou avec une bonne image.
Elle doit être absolument
vraie ; elle doit être claire ; le langage de la maîtresse doit être sobre, ce
qui n’exclut pas le mouvement et l’élégance.
L’enfant doit rendre compte de ce qu’il a vu et compris.
CHAPITRE XVII
LA GÉOGRAPHIE
L'enseignement de la géographie est absolument détourné de son but
descriptif. – La géographie, ce sont les
climats, la flore, la faune. – La géographie est intimement liée aux leçons de
choses. – Le sable dans la cour. – Le sable dans la classe. – La géographie par
les constructions. – Nécessité de l'orientation au début.
J'ai gardé la géographie pour la fin. Est-ce le cas de
dire : « aux derniers, les bons » ? Presque… si l'on s'inspirait, pour
l'enseigner aux enfants, de la simple définition placée au commencement de tous
les livres de géographie dont on se sert dans les écoles.
« La géographie est la description de la terre. »
Ce principe établi, voyons un peu ce que l'on en fait.
« La terre est ronde ; elle a la forme d'une boule immense ;
l'eau couvre les trois quarts de sa surface. »
C'est encore de la description. Je continue. « La terre
est divisée en cinq parties : l'Europe, l'Asie, l'Afrique » etc. «
L'Europe se divise en 16 contrées principales, dont 4 au nord qui sont la Suède...
», etc.
« La France se divise en 86 départements… »Il y a
longtemps que ce n'est plus de la description. « L'école maternelle est dans le
département de la Creuse (je choisis la Creuse parce que c'est le point central),
dont le chef-lieu est Guéret ; les sous-préfectures sont Aubusson, Bourganeuf,
Boussac... »Arrêtons-nous ici. Les enfants s'y arrêtent longtemps ; ils y
restent ; ils s'y ankylosent. Mais la «description » ? Sur cette terre qui est
ronde il y a des pays qui sont brûlés par le soleil et où la végétation est
prodigieuse ! les arbres y sont énormes, les fleurs y ont des couleurs
éclatantes et un parfum pénétrant. Il y a d'autres pays où le soleil ne parvient
pas à fondre la glace amoncelée en montagnes, il n'y a pas de fleurs, pas de
fruits. Dans les premiers pays, toujours l'été, un été brûlant ; dans les
seconds, l'hiver, un hiver glacial. Il y a des pays où l'on n'a jamais trop
chaud et jamais trop froid, où l'on passe, presque sans s'en apercevoir, d'une
saison à l'autre ; où l'on a de beaux arbres, de belles fleurs, de bons
fruits presque aussi beaux et aussi bons que dans les pays brûlés, où l'on
peut, comme dans les pays froids, patiner et faire des boules de neige.
Notre France est un de ces heureux pays. Elle est belle
et elle est bonne.
Ici (et la directrice a devant elle un tas de sables
c'est dans la cour, ou, si c'est dans la salle, une table creuse pleine de
sable : un de mes rêves non encore réalisés), ici c'est la montagne,
riante au pied, couverte de forêts, où vivent les lapins, les chevreuils, les
sangliers et quelques loups aussi ; tout en haut, c'est la gorge, où ne
croissent que les noirs sapins ; de cette montagne, les eaux s'écoulent en cascades,
qui sautent de rocher en rocher, s'éparpillent en ruisseaux dans la plaine, et
se réunissent en larges rivières, qui arrosent le pays et font tourner les
roues des usines où travaillent vos papas. Là c'est la rivière ; puis c'est la
plaine, où les troupeaux de vaches paissent l'herbe verte ; la plaine où
croissent le blé qui vous nourrit, les cerises succulentes que vous aimez tant,
le lin et le chanvre dont vos chemises sont faites.
Là encore, c'est la mer aux flots salés, sans cesse soulevés
en vagues qui se poursuivent sans relâche, et sans relâche aussi viennent se briser
sur la côte. Ici la côte est toute plate, couverte de sable fin ou de galets :
c'est la plage, la grève ; là elle est toute creusée et hérissée de grands
rochers qui forment des caps ; plus loin elle s'élève droite, presque comme une
muraille, c'est la falaise (et la directrice continue sa construction).
Ensuite, il y a des villes, où beaucoup d'hommes vivent
et travaillent ensemble. Voici la plus grande, Paris (quelques pierres ou des
cubes simulent les maisons mieux encore, elle place des maisons de papier
confectionnées par les enfants eux-mêmes à l'heure du pliage), Paris, au bord
de la Seine, qui part de ces hauteurs et descend de plus en plus jusqu'à
l'Océan ; voici Marseille, au bord de la Méditerranée, bleue comme le ciel dans
les plus beaux jours ; puis Lyon, Bordeaux… il y en a d'autres encore, moins
grandes, mais bien situées aussi, entourées de belles campagnes.
Et puis... ce beau pays de France que nous aimons tant,
parce que nous y sommes nés, parce que nos pères l'ont cultivé, parce que c'est
un généreux pays que le monde entier admire, la France n'est pas le seul pays
que l'on aime à connaître. Si nous traversions ces hautes montagnes qu'on
appelle les Alpes, nous arriverions en Italie ; si nous marchions de ce côté-ci
(vers le nord), nous arriverions au bord d'un petit bras de mer, que l'on
traverse en une heure et demie pour se rendre en Angleterre ; et elle leur
parle de l'Italie et de ses hivers plus doux que les nôtres, des Italiennes au
costume pittoresque ; de l'Angleterre et de son industrie qui rivalise
avec celle de la France.
La géographie, c'est la flore et la faune : les
fleurs, les fruits, les animaux ; elle est intimement liée aux leçons de
choses. C'est de la mer qu'on extrait le sel qui ajoute sa saveur à celle de
tous nos aliments ; pour avoir du café, il faut aller en Arabie, dans les îles
de la côte orientale de l'Afrique, puis dans nos îles de là mer des Antilles
(la Guadeloupe, la Martinique) ; le thé nous vient de la Chine ; nous n'en
avons pas chez nous ? pourquoi ? C'est que le soleil, qui mûrit nos olives sur
les bords de la Méditerranée, n'est pas assez chaud pour le caféier, pour
l'arbre à thé. Le cheval vit dans tous les pays, mais le lion ne vit que dans
les déserts brûlants ; le rossignol se plaît sur nos arbres, mais
l'oiseau-mouche aux superbes couleurs est un des bijoux des contrées les plus chaudes
de l'Amérique ; et l'autruche, dont les belles plumes ornent les chapeaux
des femmes, l'autruche dont les œufs pèsent 1 kilogramme, naît en
Afrique et dans l'Inde.
C'est le pays des fleurs, c'est le pays des fruits, c'est
le pays des animaux qui intéressent les enfants ; ce n'est pas la ville
qu'habite un préfet, un sous-préfet ou un juge de paix.
Ce pays, il se le figure quand il l'a modelé lui-même,
quand il en a élevé les montagnes et étendu les plaines, quand il a fait
serpenter un ruisseau dans ses vallées, qu'il a planté des arbres en miniature dans
les endroits où il y a des forêts, et qu'il a élevé des maisons dans les
endroits où il y a des villes.
C'est pour cela qu'à la place de la carte, à laquelle les
enfants ne comprennent rien, je demande du sable, non seulement dans la cour,
mais dans les salles d'exercices : c'est très pratique. Un jour, à Berne,
dans un de ces jardins d'enfants comme il y en a encore trop dans beaucoup de
pays, un jardin d'enfants où il y a beaucoup d'enfants mais pas de jardin, je
me demandais ce que les pauvres petits pouvaient faire toute la journée dans
une salle située au premier étage et où le soleil n'entrait qu'avec beaucoup de
discrétion, lorsque la directrice me montra son matériel.
Il y avait là, entre autres choses intéressantes, des boîtes
d'une trentaine de centimètres de longueur sur quinze ou vingt de largeur (la
dimension ne fait rien à l'affaire), pleines de sable légèrement humide. Chaque
enfant prit la sienne et l'exercice commença. On creusa des lacs, on éleva des
montagnes, on fit des jardins anglais avec des rivières microscopiques serpentant
autour des massifs (ces rivières étaient formées par de petites lamelles de
zinc). Dans une autre école plus pauvre encore, il n'y avait pas de boîtes :
chaque enfant avait devant lui, sur la table, son tas de sable, qu'il
travaillait avec une espèce de couteau à papier.
Après bien des efforts infructueux, j'ai fini par acclimater
le sable dans une école maternelle de Marseille. La veille de la distribution
des boîtes, le préau était morne, il était lamentable. Quelques heures après la
bienheureuse distribution, je revins pour en voir les résultats. C'était un
pays enchanté. Les yeux des enfants brillaient ; de petits rires clairs traversaient
la salle comme des chants d'oiseaux. Et quel accueil on me fit ! « Reste
encore, madame ! » « Tu reviendras, madame ? »
Et qu'on ne me dise pas que je démarque les Allemands, parce que j'engage les directrices à imiter
un procédé employé dans une école de la Suisse allemande. Le sable ! un
procédé allemand ! Lorsqu'il y a bien, bien des années, j'allais avec ma
mère sur la plage et que je forais des puits dans le sable humide, et, que j'élevais
des forteresses, et que je creusais des lacs que la vague écumante venait
remplir, est-ce que je faisais alors de la méthode allemande ? Ah! si ma mère
avait insisté pour que mes puits fussent absolument « cylindriques », pour que
mes briquettes fussent coupées à « angles droits », pour que les pignons de mes
châteaux forts fussent des« triangles » vraiment « équilatéraux », peut-être eussions-nous
fait de la méthode allemande. Mais, en cet heureux bon vieux temps, les enfants
n'étaient pas abreuvés de géométrie, et, sous prétexte de faire l'éducation de
leur œil, on ne travaillait pas à étouffer leur spontanéité intellectuelle,
leur imagination, leur esprit. Nous entendons bel et bien aujourd'hui faire de
la méthode française.
Quand je prononce ou quand je lis ces deux mots, «
méthode française », il me semble voir une clarté. C'est la méthode de la
raison, du bon sens ; c'est l'indépendance, la personnalité intellectuelle
vivifiées encore par ce fonds de bonne humeur, de vivacité d'esprit naturel qui
est le propre de notre tempérament national.
Favoriser d'abord le développement physique, la santé
du corps étant le plus sûr garant de celle de l'esprit ; laisser faire aux
enfants leur métier d'enfants, pour que, devenus hommes, ils puissent faire leur
métier d'hommes ; leur enseigner à voir ce qu'ils regardent ; à se rendre
compte de l'ensemble et des détails, et à en rendre compte dans leur langage ; à comparer les choses entre elles ; exciter la
curiosité de savoir par des leçons courtes, claires, vivantes, sur des sujets
concrets avec exemples à l'appui ; se garder de l'abstraction, qui, ne pouvant
être comprise, ne peut intéresser et habitue par degrés les enfants à
l'indolence intellectuelle ; ne se servir de la mémoire que pour graver dans
l'esprit les choses que l'intelligence s'est assimilées ; faire explorer aux enfants
le domaine de la vérité, de manière à leur laisser la joie de la découverte
n'arriver à la définition – que devra retenir la mémoire – que lorsqu'ils
auront pu la déduire eux-mêmes ; provoquer leurs observations, leurs objections
; encourager leurs saillies ; cultiver leur imagination par la description des
beautés de la nature, différentes de celles qu'ils voient tous les jours et
qu'on leur aura préalablement fait apprécier ; faire éclore dans leur cœur les germes
de bonté, de générosité, d'enthousiasme qu'il renferme, par des histoires
réelles ou non, mais toujours probables et appropriées à leur âge ; faire naître
le sentiment du beau par la vue des belles choses, le goût de la musique par
des chants bien choisis ; rendre les doigts habiles par l'habitude du travail
manuel ; se garder toujours de faire produire à l'intelligence des fruits
hâtifs. Voilà ce que j'appelle la méthode
française.
Nous voilà bien loin des préfets et des sous-préfets. Puisque
nous en avons éloigné les enfants, ne les en rapprochons plus. Quand ils seront
à l'école primaire, ils apprendront la géographie politique, et ils la
comprendront d'autant mieux qu'ils auront fait la géographie pratique et la
géographie descriptive dont nous venons de parler. Ils auront surtout acquis le
goût de la géographie ; or, quand on a le goût, il est rare que la science
ne soit pas donnée par surcroît.
J'ajoute en terminant qu'il est de toute nécessité que
les enfants apprennent à s'orienter. Rien de plus simple. Chaque matin, en
commençant les exercices, on leur demandera « de quel côté est le soleil ?
» Chaque soir, en les terminant, on posera la même question. Ces deux points
bien établis, le nord et le sud sont facilement déterminés. Toutes les fois que
l'enfant parlera d'un pays ou d'une ville, il devra savoir de quel coté il faut
se diriger pour s'en approcher.
CHAPITRE XVIII
RÉSUMÉ
Résumé. – Une réforme s’impose. – Un emploi du temps. – Progrès pour
aujourd’hui, mais qui ne réalise pas notre idéal pour demain. – La situation
morale du personnel.
En résumé, pour toute personne qui s’occupe non pas d’une
école maternelle, mais des écoles
maternelles, et qui a, par conséquent, sur ce sujet, une vue d’ensemble ;
pour toute personne qui s’est rendu compte de la délicatesse de touche que
nécessite l’éducation des petits enfants, il est incontestable qu’une réforme s’impose
; car, dans nos écoles du premier âge, l’éducation est de plus en plus
sacrifiée à l’instruction.
Les directrices rejettent la faute sur les parents. «
Ils veulent, disent-elles, que les enfants travaillent. » Nous le savons ; mais
pourquoi subir une influence si contraire à la saine pédagogie ? sans compter qu’en
obéissant ainsi aux injonctions d’un certain nombre de parents, les directrices
ne remplissent pas leur devoir envers un certain nombre d’autres. Ceux, en
effet, dont les enfants sont laissés à la femme de service, auraient le droit
de se plaindre. Si ce sont les parents qui font la loi à l’école maternelle, au
moins faudrait-il se préoccuper autant de ceux que leur ignorance empêche de se
croire lésés que de ceux que leur ignorance pousse à exiger de leurs enfants un
travail prématuré.
Encore une fois, l’école maternelle ainsi comprise est
partagée en deux sections : celle des privilégiés et celle des déshérités,
et je ne sais vraiment pas laquelle de ces deux sections est la plus à plaindre.
« Mais, nous disent parfois les directrices, nous ne pouvons
cependant pas empêcher un enfant d’avancer
! » Cela dépend de la signification que l’on donne à ce mot. S’il s’agit, pour
l’enfant, d’acquérir, par un travail spécial, des connaissances précises, la
directrice a non seulement le droit, mais le devoir de l’ « empêcher d’avancer
» ; s’il s’agit simplement de l’éclosion intellectuelle, cette éclosion se
fera tout naturellement, pour les enfants bien doués, pendant les exercices
collectifs, puisqu’il ne peut y avoir à l’école maternelle d’exercices purement
individuels.
Pour passer de la théorie à la pratique, j’ai préparé
un emploi du temps, qui est loin de
réaliser mon idéal, mais qui, dans l’état actuel de nos écoles maternelles,
avec des locaux insuffisants pour la plupart, un mobilier de salles d’asile, et pas de matériel, me paraît
cependant constituer un progrès. Tel qu’il est, cet emploi du temps est ouvert
aux modifications –, aux améliorations. Il se modifiera et s’améliorera, je
l’espère, chaque fois qu’une idée nouvelle viendra nous récompenser de notre
culte pour le « mieux ».
L’école maternelle est ouverte au moins de huit heures
du matin à six heures du soir. La directrice est généralement logée dans la
maison.
Dès le matin, à son lever, elle aérera en grand le local. Il est nécessaire,
pour que les salles soient purifiées, qu’elles soient traversées, fouettées par
le grand air et baignées de soleil. A huit heures, les fenêtres seront fermées,
si le temps est froid. S’il fait beau et tiède, on fermera d’un côté, à cause
des courants d’air.
Les jouets d’intérieur,
s’il y en a, seront en ordre dans le préau et la portée de chacun.
Les jouets de
cour ou de jardin seront en ordre dans la cour ou dans le jardin, car,
selon la saison et le temps, les enfants resteront au préau ou iront dehors.
Les enfants arrivent, un par un, par groupes peu nombreux.
Cela facilite l’inspection de propreté.
Cette inspection portera sur le corps et sur les vêtements. Si la mère est
entrée avec son enfant, la directrice lui fera, avec tact et délicatesse, les
remarques qu’aura suggérées cette inspection. En l’absence de la mère, elle les
consignera brièvement sur un carnet, pour les faire à midi ou le soir, ou tel
jour de la semaine, où il lui sera possible de lui parler.
La saleté, le désordre seront atténués, selon le
possible, immédiatement ; l’enfant sera lavé, peigné. La directrice, munie d’une
aiguille enfilée, posera un bouton, assujettira un lacet, maintiendra
sommairement une déchirure pour l’empêcher de s’agrandir.
La visite du
panier sera faite aussi séance tenante et portera sur la quantité, sur la
qualité, sur la nature des aliments eu égard à l’âge de l’enfant, à son tempérament,
à la saison, au climat.
L’enfant ira alors jouer, et, comme les jeux à l’école
maternelle sont choisis et surveillés, il ne se salira plus – sauf accident – qu’à
la surface. Aussi lui suffira-t-il d’une simple ablution des mains, après le
passage aux cabinets, au moment d’entrer en classe.
Il nous semble que l’appel peut coïncider avec la visite de propreté. Si les directrices
en jugent autrement, elles pourront le faire au préau avant d’entrer dans la
salle d’exercices. En tout cas, il doit être l’occasion d’une causerie intime
entre la directrice et les enfants. « Ta maman est-elle guérie ? ton petit frère
est-il rentré de chez ton grand-papa ? Ton mal au doigt est-il guéri ? Où ton
papa travaille-t-il maintenant ? Sais-tu pourquoi Louise, ta voisine, n’est pas
venue ? »
Un quart d’heure avant l’entrée en classe, quelques enfants,
garçons et filles, désignés pour un jour ou pour une semaine, iront disposer le
matériel nécessaire aux exercices.
Il sera alors dix heures moins un quart au moins. Cette
première partie de la journée aura été très laborieuse pour la directrice, pour
l’adjointe, pour la femme de service aussi ; mais elle n’aura, en aucun cas,
pesé sur les enfants, qui auront bougé, causé, joué comme ils l’auraient fait
librement dans la famille : heures profitables entre toutes, puisqu’ils
auront appris à vivre en société.
SECTION DES PETITS.
1° Entrée en
classe (préau, seconde salle, d’après le local).
Cet exercice nous paraît difficile à exécuter en chantant,
vu l’âge des enfants. Toute la peine est alors pour la directrice, sans grand
profit pour la masse, car, à elle seule, avec une voix souvent fatiguée et des
chants par trop connus, elle ne parvient pas à exciter la joie. II serait donc
à désirer que chaque école possédât un instrument de musique : piano,
harmonium, accordéon. Mais nos directrices ne sont pas exécutantes ! Combien
peu seraient en état de jouer une marche ! Aussi aimerions-nous à voir en
attendant, simplement en attendant,
la boîte à musique de grande
dimension obtenir droit de cité dans la petite section de nos écoles
maternelles.
2° Évolutions autour de la classe et autour des tables
;
3° Mouvements gymnastiques ;
4° Les enfants prennent place aux tables ;
5° Exercices des briquettes (de 15 à 20 minutes) ;
6°Évolutions et musique, passage dans la cour, s’il
fait beau (10 minutes);
7° Parfilage (15 minutes) ;
8° Évolutions comme au n° 6
9° Exercices de langage (causerie à l’aide d’images)
10° Sortie de classe
11° Passage au lavabo avant le repas;
12° Repas, surveillé par tout le personnel de l’école
13° Passage au lavabo;
14° Récréation sous la surveillance alternative de la
directrice et de l’adjointe, jeux libres, jouets.
Après-midi.
1° Passage au lavabo après avoir été aux cabinets
2° Entrée en classe comme le matin
3° Pliage, piquage ou tissage (15 minutes)
4° Évolutions comme le matin (10 minutes);
5° Exercices de langage et de calcul combinés avec un
jeu : ménage, bergerie, confection de jardin dans les boîtes à sable, ou
dans une table creuse pleine de sable, ou dans le jardin, si le temps le permet
(30 minutes) ;
6° Évolutions (10 minutes);
7° Dessin ou barbouillage aux ardoises (15 minutes);
8° Évolutions (10 minutes)
9° Jeux libres et jouets jusqu’au soir
Les exercices manuels alterneront de manière à donner
par semaine 3 séances de parfilage, 3 de piquage, 3 de pliage, 3 de tissage.
SECTION DES GRANDS.
Lundi matin : Entrée en classe avec chant ; évolutions (10
minutes). – Lecture et écriture [de préférence avec les lettres mobiles] (30
minutes). – Chant et mouvements gymnastiques (10 minutes). – Causerie instructive [animaux] (30
minutes). – Chant, mouvements, sortie
(10 minutes). – Repas, comme pour les
petits (précédé et suivi du passage au lavabo). – Récréation en commun, garçons et filles, première et deuxième
sections.
Lundi soir : Entrée en classe comme le matin (10 minutes).
– Calcul avec objets :
bâtonnets, briquettes ; mesurage de longueurs, de liquides ou de légumes secs,
jeu de marchands et d’acheteurs, etc. (30 minutes). – Chant et mouvements (10
minutes). – Tissage (30 minutes). – Chant (5 minutes). – Causerie à l’aide d’images
(30 minutes). – Sortie (5 minutes).
Mardi matin : Chants,
évolutions, mouvements, comme la veille et dans les mêmes proportions. – Exercice
de mémoire avec récit, explication (30 minutes). – Dessin (30 minutes).
Mardi soir : Entrée et évolutions comme ci-dessus et dans
les mêmes proportions. – Lecture et écriture avec lettres mobiles (30 minutes).
– Piquage (30 minutes). – Exercice de géographie (30 minutes).
Mercredi matin : Entrée, etc. – Lecture sur le tableau ou dans
un livre (30 minutes). – Dessin (30 minutes).
Mercredi
soir : Exercice de tricot (30
minutes). – Histoire naturelle avec plante ou image (30 minutes). – Historiette
(30 minutes).
Jeudi matin : Leçon de chant (30 minutes). – Gymnastique (10
minutes). – Dessin (30 minutes).
Jeudi soir : Exercice de calcul avec objets et jeux (30
minutes). – Couture (30 minutes). – Ce qu’on voit sur les images (30 minutes).
Vendredi
matin : Exercice de mémoire
précédé du récit et de l’explication (30 minutes). – Dessin ou écriture (30
minutes).
Vendredi
soir : Tricot et piquage (30
minutes). –Lecture au tableau ou au livre (30 minutes). – Ce qu’on voit sur les
images (30 minutes).
Samedi matin : Lecture avec lettres mobiles (30 minutes).
Leçon de choses (alimentation, vêtement, logement), 30 minutes.
Samedi soir : Historiette (30 minutes). Leçon de chant (30
minutes). Pliage (30 minutes).
Dans cet emploi du temps, les travaux manuels figurent
6 fois ; les exercices de langage, 6 fois, sur des sujets différents : histoire
naturelle, géographie, historiettes ; la lecture, 5 fois ; le dessin, 4 fois ;
le calcul, 2 fois ; la leçon de chant,
2 fois ; les exercices de mémoire, 2 fois.
La durée de chaque exercice paraîtra peut-être exagérée;
nous sommes loin, ici, de l’ancien quart d’heure réglementaire. Mais nous
savons par expérience qu’un quart d’heure ne suffit pas pour donner une leçon
intéressante à un grand nombre d’enfants et pour s’assurer que la moyenne en a
retiré un fruit quelconque. Pour une leçon abstraite à des enfants de cinq ans,
un quart d’heure, c’est trop : ici il s’agit de leçons où l’enfant sera
actif, de leçons auxquelles le corps prendra part en même temps que l’intelligence.
D’ailleurs cette durée n’est pas de rigueur et pourra être modifiée aussi
souvent que la directrice le jugera nécessaire. Non seulement je trouve que quinze
minutes ne suffisent pas pour faire un exercice profitable, mais je suis
persuadée que l’enfant, forcé d’appliquer
tous les quarts d’heure son attention sur des objets nouveaux, les effleurant
constamment, n’ayant pas le temps de s’arrêter sur une idée qui l’intéresse ou
le charme, éprouve une fatigue intellectuelle dangereuse. Je le compare à ces
pauvres écureuils pour lesquels on a remplacé la mobilité des branches d’arbres
par ces cages tournantes dans lesquelles ils ne peuvent jamais prendre pied. En
Suisse, toutes les leçons de l’école maternelle, tous les exercices manuels de
la semaine doivent servir au développement de la même idée ; en France, on
force l’enfant à sautiller d’une idée à l’autre, sans transition, sans qu’il
soit donné à l’assimilation le temps de se faire. La vérité doit être dans le
système mixte que je propose aujourd’hui.
Certes, une réforme s’impose, mais les défectuosités,
les erreurs actuelles – il faut bien avoir le courage de dire la vérité – les
erreurs actuelles ne doivent pas nous faire oublier le chemin courageusement
parcouru. De l’asile garderie à l’école maternelle, telle que nous la
comprenons aujourd’hui, il ya un monde. Aidés du personnel dont le dévouement est
au-dessus de tout éloge, nous cherchons le bien ; demain nous nous mettrons en
route vers le mieux. Nous vivons d’ailleurs à une époque où c’est à pas de géants
qu’on se dirige vers le mieux.
Après ses désastres, la France a cherché des forces nouvelles
dans le développement des facultés les plus nobles de tous ses enfants. Un
peuple qui soigne ainsi ses blessures mérite un prompt relèvement. La France
est debout.
Un coup d’œil rétrospectif sur cette marche du progrès
pendant les dix dernières années est vraiment chose réconfortante, et je suis
si persuadée qu’il fera du bien à mes lecteurs, que je leur demande la
permission de faire un petit voyage à travers ces dix dernières années. Quand
nous serons revenus à notre point de départ, c’est-à-dire à aujourd’hui, nous
serons convaincus que ce sont surtout les directrices des écoles maternelles
et, avec elles, les tout petits enfants, qui ont eu la plus grande, la
meilleure part du progrès accompli si
elles entrent dans les vues de leurs guides.
Quand nous regardons, en effet, vers un passé encore
tout près de nous, nous voyons des écoles normales primaires d’instituteurs
dans la plupart des départements, mais seulement quelques écoles normales
primaires d’institutrices : – la République n’avait pas encore eu le temps
d’inviter les femmes comme les hommes à entrer dans le Temple. – Le personnel
enseignant dans ces écoles, personnel très méritant et qui a fait ses preuves,
était recruté... un peu partout ; il y avait là des diplômes de toutes sortes ;
l’instruction ne manquait pas ; l’éducation, non plus ; ce qui manquait, c’était
l’homogénéité. Quant au programme, il était très défectueux ; l’instruction de
mémoire, j’allais dire « l’instruction de tête », y primait l’instruction de
réflexion, j’allais presque dire « l’instruction de cœur ». On apprenait les
livres imprimés, au lieu d’étudier la nature, d’étudier la vie, d’étudier l’enfant,
de s’étudier soi-même…
A l’issue des cours, les élèves-maitres (je parle ici au
masculin, parce que je parle en général), les élèves-maîtres qui avaient fait
de l’enseignement pratique dans les écoles primaires annexes, étaient envoyés,
munis les uns du brevet simple, les autres du brevet complet, dans les écoles
primaires communales, soit en qualité d’adjoints, soit en qualité de directeurs.
Les écoles publiques recevaient, comme aujourd’hui, les enfants à sept ans
quand il y avait une salle d’asile dans la commune, à cinq ans, à quatre ans, à
trois ans quand il n’y en avait pas. D’ailleurs, les parents étaient libres de
ne pas envoyer leurs enfants à l’école : ils étaient forcés de les préserver,
par la vaccine, de la petite vérole, mais ils avaient le droit de les livrer à
la pire des maladies, à l’ignorance.
Les salles d’asile, les garderies plutôt, étaient
dirigées par des femmes de dévouement auxquelles on ne demandait à peu près
aucune garantie intellectuelle ; un grand nombre étaient intelligentes,
quelques-unes étaient instruites, mais c’était un luxe dont on ne leur tenait,
pour ainsi dire, pas compte.
Or, que sont aujourd’hui les écoles normales primaires
? D’abord il y en a partout, pour les institutrices comme pour les instituteurs
; les départements les plus réfractaires ont été mis en demeure de suivre le
mouvement. Toutes ne fonctionnent pas encore, mais, partout où il n’y en avait
pas, on en crée ; les unes sortent à peine de terre, les autres en sont à la charpente
; ce n’est plus qu’une affaire de mois.
Le personnel enseignant se recrute à l’école normale
supérieure de Saint-Cloud, pour les instituteurs, à l’école normale supérieure
de Fontenay, pour les institutrices ; les aspirants directeurs ou
professeurs qui ne passent pas par ces deux écoles sont soumis aux mêmes
examens que les élèves qui en sortent, ce qui implique une culture identique.
Le personnel est donc renouvelé. Ce personnel, vibrant au souffle de l’esprit
nouveau, met en œuvre un programme renouvelé aussi, et ce souffle de l’esprit
nouveau animera bientôt toutes les écoles primaires de France, où tout père de
famille est désormais tenu d’envoyer ses enfants. C’est presque l’âge d’or.
Les salles d’asile ne sont pas restées en retard dans cette
énorme poussée en avant. Vous savez comme moi ce qui est arrivé. Garder des
enfants sans s’occuper d’eux étant impossible à des femmes de cœur, les salles
d’asile garderies sont devenues peu à peu des établissements d’éducation. Mais
tout s’enchaîne, l’être humain, si multiple en apparence, est un tout dont chaque
partie réclame sa culture : avoir près de soi un enfant et lui donner des
soins matériels implique fatalement (dans le vrai sens du mot) que l’on
cultivera aussi et en même temps son intelligence et son cœur ; or la tâche est
difficile, délicate, elle réclame du dévouement, certes, mais du dévouement mis
au service d’une bonne éducation première, d’une instruction sinon très
étendue, du moins très précise et très variée, du don de la transmettre aux
enfants, enfin de la connaissance approfondie du petit être que l’on se charge
d’élever.
De là l’obligation, pour toutes les directrices, de se
présenter devant une commission d’examen chargée de constater, non seulement
leur instruction théorique, mais leur aptitude à diriger un grand nombre d’enfants,
tant au point de vue de la discipline qu’au point de vue de l’hygiène, de l’éducation,
de l’instruction première.
Là transformation ne s’est pas arrêtée là. Notre sentiment
démocratique a été choqué par cet établissement hybride, à la fois refuge et
école, et l’école maternelle a remplacé la salle d’asile ; en même temps, le
règlement a été remanié sur les bases de la saine pédagogie et de la
psychologie enfantines, car on a compris qu’il fallait mettre l’enfant dans un
milieu normal, dans son milieu, et
non dans un milieu factice. Mais que c’est difficile ! car tout est à faire
pour ces petits enfants : ils n’ont aucune notion de base ; – la
langue maternelle même ne leur est pas familière ; ils ne la parleront
véritablement que s’ils ont appris à penser ; – ils sont sans défense au
point de vue moral comme au point de vue matériel ; toute la responsabilité
retombe donc sur leurs éducatrices. On n’y avait pas pensé jusqu’alors ; on
avait cru que tout était assez bon pour les petits ; aujourd’hui on sait au
contraire que rien n’est trop bon pour eux, et l’on comprend qu’il faudrait
appeler l’élite des institutrices à la direction des écoles maternelles.
Mais, quand il s’est agi de recruter cette élite, les difficultés
se sont dressées. La tâche si délicate est hérissée d’aggravations plutôt que
de compensations : le travail est excessif – parce que le personnel est
insuffisant, – il n’y a pas de congés, pas de vacances ; les appointements
sont inférieurs à ceux des institutrices, parce que les municipalités n’ont pas
secondé les vues de l’État ; il s’est, enfin, constitué dans le personnel de l’enseignement
primaire une sorte de hiérarchie au détriment des directrices d’écoles maternelles.
Cette hiérarchie nous afflige, mais ne nous étonne pas
; car si, en principe, il y a égalité dans la mission, supériorité même en
faveur des directrices d’écoles maternelles, il faut avouer qu’en fait ce n’est
pas cela du tout. Les instituteurs ont des titres. La plupart sortent de l’école
normale ; beaucoup sont pourvus du brevet supérieur ; le brevet élémentaire passe
lui-même, à tort, pour être plus sérieux
que le certificat d’aptitude à la direction des écoles maternelles ; les
directrices sont donc, quelle que soit leur distinction, comme les parias de l’instruction
primaire ; il leur faut une vocation bien déterminée,… à moins qu’elles n’aient
pas trouvé à faire autre chose.
Nous sommes, il faut l’avouer, bien loin de regarder l’éducation
des petits comme une mission d’honneur.
J’emploie le présent à tort. En suivant, en effet, cette
marche du progrès que nous avons constatée au début, nous nous trouvons en
présence du règlement ou du décret d’organisation des cours normaux, destinés à
former des directrices d’écoles maternelles selon l’esprit et le cœur des amis
des petits enfants, et de la création de l’école normale supérieure de Sceaux,
chargée de pourvoir au personnel enseignant de ces cours normaux, comme les
écoles de Fontenay et de Saint-Cloud pourvoient à celui des écoles normales
primaires.
Eh, bien ! ces cours normaux eux-mêmes, cette école
normale supérieure de Sceaux, ne réalisaient pas notre idéal : l’unification
absolue de l’enseignement primaire ; ils n’étaient que la dernière étape vers
la conquête de cet idéal ! Nous sommes repartis en marche, et… arrivés au
but; plus de cours normaux ; plus de culture restreinte, spécialisée :
l’école normale pour toutes les institutrices, quel que soit le genre d’enseignement
auquel elles se destinent.
Si nous reprenons, en effet, une idée que nous avons
développée tout à l’heure, il nous est facile de comprendre que, malgré l’école
supérieure de Sceaux, malgré les cours normaux, et justement même à cause des
cours normaux et de l’école supérieure, la scission entre les instituteurs et
les directrices était en quelque sorte consacrée, et l’esprit hiérarchique éloignait
de plus en plus les jeunes filles de la direction des écoles maternelles ;
car le cours normal durait un an ou deux au plus, tandis qu’on reste trois ans
à l’école normale : de là, infériorité de la directrice d’école maternelle
; de là, difficulté pour le recrutement du personnel.
Mais ce n’est pas tout encore ! La directrice,
initiée seulement à la pédagogie et à la psychologie de l’enfant de deux à sept
ans, n’étant pas mise en contact à l’école annexe avec les enfants de l’école
primaire, manquait de vues d’ensemble ; il lui était impossible de
découvrir des procédés rationnels pour préparer les évolutions ultérieures ;
elle marchait, en somme, comme un voyageur qui connaîtrait le point d’où il est
parti, la portion du chemin dans laquelle il est engagé, mais qui ignore où ce
chemin aboutit.
D’autre part, les institutrices, qui ne s’occupaient de
l’enfant qu’à partir de six ou sept ans, n’avaient pas étudié sur le vif les évolutions qu’il avait
faites, elles ignoraient le chemin qu’il avait parcouru avant d’arriver à l’école
primaire ; elles manquaient de données pour établir leur diagnostic
intellectuel et moral.
Aussi, dans leur étude consciencieuse sur les besoins
réels de l’enseignement primaire et de l’enseignement maternel, les
fonctionnaires chargés de la création et de l’organisation des cours normaux se
sentaient-ils pris d’hésitation, je dirai presque de remords ; ils comprenaient
que la vérité n’était pas là, qu’il fallait travailler encore, qu’il fallait en
finir.
Et c’est fini ! Le Conseil supérieur de l’instruction publique
a voté les dispositions suivantes :
« Les écoles normales ont pour mission d’assurer le
recrutement du personnel enseignant, non seulement dans les écoles primaires,
mais dans les écoles maternelles et les écoles ou classes enfantines.
« L’engagement décennal que les aspirantes aux écoles
normales d’institutrices doivent produire pour se présenter à l’examen d’admission,
portera expressément qu’elles s’engagent à se consacrer pendant dix ans à l’enseignement
public dans les écoles primaires, ou enfantines, ou maternelles, où elles
pourront être appelées.
« Toutes les élèves-maîtresses devront se présenter, à
la fin de la seconde année, aux examens du certificat d’aptitude à la direction
des écoles maternelles.
« L’obtention de ce brevet confère aux élèves-maîtresses
le droit de passer en troisième année. En cas d’échec, elles seraient rendues à
leurs familles si le recteur, sur l’avis favorable des professeurs, ne les maintenait
pas provisoirement dans l’école normale, pour leur permettre de subir les mêmes
épreuves à la session ordinaire ou extraordinaire d’examen. Encas de nouvel
échec, le renvoi dans la famille ne peut plus être différé.
« Dans les écoles normales qui n’auraient pas encore d’école
maternelle, il serait créé provisoirement, dans l’école primaire annexe, une
division enfantine, qui serait soumise aux règlements des écoles maternelles. »
Nous sommes donc, aujourd’hui, sûrs de la victoire
définitive… Pourvu que, dorénavant, ce soit la vocation qui pousse les jeunes
filles à entrer dans l’enseignement, car la vocation seule fera prendre de longue date les habitudes intellectuelles et
morales nécessaires à qui se charge de faire l’éducation des autres. Or, la
vocation, il faut l’avouer, manque trop souvent.
Si l’on demande à chacun des enfants de la division
supérieure d’une école primaire, à quoi il se destine, neuf fois sur dix il
répond avec une assurance qui prouve que son choix ou celui de ses parents est déjà
fait. Soit à cause de ses goûts personnels – ce qui devrait être la règle, – soit
à cause de ceux de son entourage, soit enfin à cause de certaines convenances
ou de certaines facilités, un enfant de douze à treize ans raconte qu’il
entrera bientôt en apprentissage
(retenez le mot, car je le souligne à dessein), celui-ci chez un menuisier,
celui-là chez un tapissier, tel autre chez un arpenteur, telle fillette chez
une couturière, telle autre chez une modiste. Les uns s’appliquent surtout à la
comptabilité pour entrer dans une maison de commerce, les autres se destinent
aux arts industriels, et, au sortir de l’école, tous suivent leur voie. Les
bons ouvriers se sont préparés de longue date au métier qui les fait vivre et
qu’ils honorent : il n’y a pas eu – en général – de lacune dans leur
éducation professionnelle.
En outre, le futur menuisier, le futur serrurier se rendent
à peu près compte des exigences de la profession qu’ils ont choisie ; ils l’ont
vue exercer par leur père, ou par leur oncle, ou par un cousin ; ils ont, pour
ainsi dire, « vécu là dedans » ; la future couturière, la future modiste
savent bien, l’une qu’il s’agira pour elle de faire le mieux possible, selon le
caprice de la mode, des robes et des chapeaux ; l’autre, d’imiter la nature
avec tout le goût et tout l’art dont elle sera susceptible ; il n’y a de
malentendu ni pour les uns ni pour les autres, et, pourvu qu’ils aient l’aptitude,
l’amour du travail, la bonne volonté, tout ira bien pour eux.
Si de l’école primaire nous transportions notre
enquête dans les salles d’examens, si nous demandions à chaque candidat ce qui
l’a décidé à prendre son diplôme, depuis combien d’années il se destine à l’enseignement,
si nous l’interrogions surtout sur ses devoirs futurs, les réponses seraient
moins catégoriques, et nous constaterions souvent qu’il existe un malentendu
entre eux et nous. Comme c’est ce malentendu qui fait tout le mal, il faut l’expliquer.
A cette question « Qu’est-ce qu’un instituteur ? » beaucoup, je le crains,
répondraient : « L’instituteur est un individu instruit chargé de répandre l’instruction
qu’il a acquise. Il parle et écrit correctement ; il a étudié l’arithmétique
et la géométrie, la géographie et l’histoire; il a lu et a profité de ses
lectures ; il enseignera à ses élèves : la grammaire, l’arithmétique, la
géométrie, la géographie, l’histoire ; il racontera ce qu’il a lu... »
Pour devenir cet instituteur-là, quelques années suffisent,
en effet. Il s’agit tout simplement d’avoir l’intelligence ouverte et de la
mémoire ; mais cet instituteur-là n’est pas celui que nous rêvons ; c’est un professeur, un professeur dans le sens
le plus restreint, le moins élevé du mot.
Or, ce qu’il nous faut dans nos écoles, ce sont des éducateurs,
c’est-à-dire des cœurs dévoués, non pas au développement de la mémoire, mais – sans
préjudice pour la mémoire dans une mesure voulue – à la culture des facultés
intellectuelles et morales ; des cœurs enflammés de longue date pour la cause du
progrès : ce qu’il nous faut, c’est la vocation.
La vocation se révèle plus tôt ou plus tard : cela
importe peu, pourvu qu’elle existe. Chez les uns, elle date pour ainsi dire du
jour de la naissance d’un enfant dans la famille ; chez les autres, de la
leçon vivante d’un maître ; d’autres, frappés des douleurs et des chutes
produites par l’ignorance, ont voulu avoir leur part dans l’œuvre de relèvement :
l’énumération pourrait être longue, nous l’arrêtons ici.
Supposez maintenant une jeune fille qui, à l’âge où sa
sœur ou sa compagne de choix s’est promis d’être fleuriste, s’est dit «Je serai
institutrice». Tandis que sa sœur ou sa compagne a regardé attentivement les
fleurs et a essayé de les imiter, tandis qu’elle s’est intéressée aux procédés
de fabrication des fleurs artificielles, elle a étudié, elle, les enfants de son
entourage. Pour apprendre à les connaître, elle s’est insinuée dans leurs
bonnes grâces et dans leur confiance ; elle s’est ingéniée à les amuser et
à les intéresser ; elle est devenue adroite et inventive. Pour aider à leur
développement, elle a non seulement regardé et étudié les enfants eux-mêmes, mais elle a puisé dans les
livres ; elle a voulu savoir les noms, la vie, les idées de ceux qui ont aimé l’enfance,
elle a voulu connaître les divers systèmes employés pour l’élever et l’instruire.
La lecture a étendu le cercle de ses connaissances, et l’a rendue de plus en
plus curieuse de savoir ; elle s’est intéressée à l’histoire et à la géographie ;
elle a lu nos grands écrivains ; son style est devenu correct, son élocution
facile ; l’habitude de la réflexion lui a fait vaincre les difficultés de
l’arithmétique et des sciences qui s’y rattachent.
Grâce à la vocation, grâce aux habitudes
intellectuelles qu’elle a prises, grâce à l’apprentissage fait avec les élèves
de son choix dont elle s’est depuis longtemps
entourée, elle est une institutrice aussi bien armée pour l’exercice de sa
profession que les ouvrières dont je parlais tout à l’heure sont bien armées
pour la pratique de leur métier.
Réussira-t-elle immédiatement ? Il serait téméraire d’y
compter. Tout dépendra du temps qu’elle mettra à conquérir dans la commune sa
situation morale.
On me dira pour conquérir la position morale, il n’y a
qu’une chose à faire : remplir son devoir.
Remplir son devoir, sans doute ; mais encore est-il bon
de s’entendre sur la valeur de ces trois mots. S’agit-il seulement d’être
exacte aux heures de classe, de les employer selon la lettre du règlement ? d’être
affable avec les enfants, de veiller à leur bien-être ? d’être polie avec les
parents? bienveillante avec les directrices adjointes ? respectueuse envers les
autorités, et enfin d’une conduite au-dessus de tout soupçon ?
Certes, oui, c’est le devoir. Mais c’est le devoir strict,
le devoir sec, le squelette du devoir ; c’est de ce devoir-là, sans doute, que
l’Évangile a dit «Quand vous aurez fait tout votre devoir, vous serez des
serviteurs inutiles ». D’autres, peut-être,
pourraient se contenter de le remplir ainsi, mais pas l’instituteur ; ce n’est
pas par terre qu’il doit diriger son objectif, c’est tout là-haut, vers les
régions radieuses ; son devoir à lui est un devoir qui, tous les jours, grandit
et s’élève ; le devoir, pour l’instituteur, c’est de faire mieux, toujours mieux.
Envisagé, puis pratiqué ainsi, le devoir élèvera infailliblement
peu à peu les directrices à la position morale à laquelle elles aspirent
toutes. Mais cette conquête sera lente, car il faudra grouper autour de soi
bien des éléments divers ; elle sera difficile aussi, car elle réclamera de la
part des directrices, entre autres qualités précieuses, du jugement, du tact et
du cœur : du jugement, pour reconnaître et démêler ces éléments divers,
pour les étudier et se familiariser avec eux ; du tact, pour se diriger
parmi eux sans en froisser aucun ; du cœur, pour les attirer à soi et, les ayant
attirés, se les attacher.
Quels sont les éléments divers qui rendent si
difficile et si délicate la conquête de la position morale ? Ce sont d’abord
les autorités le maire, les conseillers municipaux.
Il faut bien le répéter : les municipalités n’ont
pas toujours fait les études spéciales qui leur permettraient de traiter en
dernier ressort certaines questions relatives à l’école ; elles ne se doutent
pas toujours des difficultés de détails qui enrayent ses progrès ; elles
empiètent parfois, sans le vouloir peut-être, sans s’en douter même, sur d’autres
autorités. N’ayant pas étudié à fond les règlements pédagogiques, n’étant pas
toujours au courant des nouveaux procédés, elles ne se hâtent pas de mettre le mobilier
et le matériel scolaires en harmonie avec eux. Hier, un maire exigeait qu’un
enfant fût admis à l’école malgré certaines prescriptions réglementaires ;
un autre décide aujourd’hui, de sa propre autorité, qu’il y aura congé,
vacances : toutes situations difficiles pour la directrice, qui devra un
jour faire observer que c’est à l’inspecteur ou à l’inspectrice qu’il
appartient de prendre certaines décisions, et un autre jour faire comprendre
que l’école ne peut pas rester le seul domaine inaccessible au progrès…
Situations difficiles, je le répète, mais que la directrice doit prendre à
tâche et tenir à honneur de faire cesser.
On m’objectera, peut-être, la timidité inhérente au sexe
féminin ; la réelle souffrance qu’éprouve une femme forcée de demander, de
revenir à la charge, de revendiquer un droit, de lutter, pour son devoir professionnel,
contre un magistrat, contre un fonctionnaire, contre un groupe d’hommes influents
dont l’appui lui est utile…
La timidité, trop souvent confondue avec la modestie,
est une faiblesse qu’il faut guérir, surtout quand elle est préjudiciable à l’intérêt
général ; le sentiment de la dignité, la conscience professionnelle, le courage
moral, au contraire sont des vertus humaines essentielles à l’éducateur, homme
ou femme. Il faut que l’institutrice les possède pour conquérir la position
morale à laquelle elle aspire.
La directrice de l’école maternelle a dû, aussi, jusqu’à
maintenant, lutter contre le préjugé hiérarchique des instituteurs et des
institutrices, qui, attardés aux souvenirs de la garderie et de la salle d’asile,
n’acceptaient pas comme collègue cette éducatrice du petit enfant. La culture
commune à l’école normale, les progrès intellectuels et moraux de tout le
personnel enseignant, auront bientôt raison de cette difficulté.
Si la sympathie et l’estime des autorités, si les sentiments
vraiment fraternels des instituteurs, ses collègues, sont des éléments
nécessaires à la situation morale de la directrice, la confiance des parents, l’amour
des petits enfants sont des éléments indispensables.
Tous ceux qui s’intéressent à elle lui diront : «
Si vous voulez avoir les parents pour vous, aimez les enfants ». Rien de plus
vrai ; mais, si elle s’en tenait à ce conseil vague, elle s’apercevrait, je le
crains, au bout de peu du temps, que le procédé n’est pas aussi infaillible qu’il
en a l’air.
C’est qu’il y a, en effet, une manière banale d’aimer
les enfants, comme il y a une manière banale de remplir son devoir. Si, par «
aimer les enfants », on entend simplement les trouver adorables de délicatesse
et de grâce, avoir du plaisir à caresser leur peau satinée, à entendre leurs
gazouillements d’oiseaux, tout le monde, à moins d’infirmité morale, les aime.
Si, par « aimer les enfants», on veut dire simplement avoir horreur de les
faire souffrir, ou même de les laisser souffrir, à moins d’être des monstres, tout
le monde les aime encore de cette manière-là : mais c’est là ce que j’appelais
tout à l’heure la manière banale de les aimer.
L’amour pour les enfants, le vrai, le seul digne de ce
nom, est un sentiment d’abord, nul ne
le nie ; mais c’est aussi une science : ce dont peu de personnes semblent
se douter. Pour aimer l’enfant, il
faut donc savoir l’aimer, et nous pouvons dire, hélas ! que cette science est
ignorée même par beaucoup de mères.
Aimer l’enfant suppose une étude incessante de ses besoins,
de ses aptitudes, de ses aspirations, et un effort persévérant pour lui faire
un milieu où ses besoins seront satisfaits, ses aptitudes développées, ses
aspirations réalisées. Aimer l’enfant, c’est être convaincu qu’on a pour
mission de lui procurer la somme de bonheur à laquelle il a droit, de faire arriver
à éclosion complète tous les bons germes qu’il porte en lui. Aimer l’enfant, c’est
le protéger, parce qu’il est faible ; c’est le respecter, parce qu’il est pur.
Aimer l’enfant, c’est s’ennoblir soi-même, parce que c’est aspirer à se rendre
digne de lui.
Cette étude, attentive, raisonnée, méthodique, persévérante
et purifiante en même temps, peu de mères – je parle ici de la masse – ont eu
la possibilité de la faire ; en admettant que leur éducation le leur eût permis,
le temps leur eût manqué. Aussi les mères de famille sont-elles plus souvent
une entrave qu’une aide pour les directrices réellement pénétrées du sentiment
de leur devoir. L’une recommande de traiter son enfant avec sévérité, pis que
cela, durement ; l’autre se froisse même d’une observation faite avec bienveillance
; une troisième, ne comprenant pas l’importance de l’éducation dont elle a été
privée, n’apprécie qu’une certaine dose d’instruction matérielle réputée
indispensable, et qualifie de temps perdu celui qui a été consacré au
développement des facultés intellectuelles et morales ; elle exige que son enfant
« apprenne immédiatement quelque chose », c’est-à-dire qu’il soit mis au
supplice de la lecture prématurée et de la récitation d’après le système des perroquets.
Nouvelle difficulté pour la directrice, difficulté plus
ardue encore que celles que j’ai signalées. Mais comme la situation y gagne en
intérêt, en attrait même ! Comme l’horizon s’élargit ! comme le but, déjà si
noble, s’élève encore ! Car, enfin, il ne s’agit plus seulement de l’enfant
à diriger, il s’agit aussi de la mère à convaincre, et c’est alors que l’enseignement
devient apostolat.
De prime abord, les parents avaient deviné dans la
directrice une femme que son éducation plaçait au-dessus de la moyenne ;
ils l’avaient deviné à ses allures, à la dignité dont sa personne était
empreinte, à l’harmonie de son costume ; or voici qu’en l’entendant exprimer
des idées généreuses et élevées dans un langage simple sans être trivial, leur
impression devient une conviction ; leur déférence se double de confiance et de
sympathie ; ils font leur profit de ce qu’ils entendent ; les préjugés
perdent ainsi du terrain ; l’éducation filtre de l’école dans la famille ;
le niveau intellectuel et moral du peuple s’élève ; le progrès s’accomplit.
C’est ainsi que les nations deviennent de grandes nations. Dans les grandes
nations, l’éducateur doit avoir une haute situation morale.
L’enfant est conquis par la directrice qui l’aime. J’ai
essayé, tout à l’heure, de définir ce qu’il fallait entendre par aimer l’enfant
; je ne veux pas y revenir ; mais j’ai besoin d’ajouter que, chez l’enfant, l’amour
est fait aussi de confiance, de foi.
Les manifestations extérieures, un regard bienveillant,
un doux sourire, un mot de tendresse, un geste affectueux, l’attirent ; mais c’est
la conduite de chaque jour qui l’attache. Ce petit être sautillant et babillard
écoute plus qu’on ne s’en doute ; il observe, il compare. Si les actes de l’éducateur
ne sont pas en harmonie avec ses préceptes, il le remarque bientôt, et il en
éprouve une sorte de scandale, car il a placé tout haut dans sa vénération
celui qui lui donne ses soins. Dans son naïf enthousiasme, il en a fait une sorte
de divinité. Or, même pour un enfant, c’est un déchirement d’avoir à renier ses
dieux.
Vous l’engagez sans cesse à remplir ses petits devoirs
d’enfant : qu’il vous voie sans cesse accomplissant vos grands devoirs ;
alors, non seulement il vous aimera, mais il croira en vous.
La directrice, en qui ses élèves croient, la directrice
qui a de l’influence sur les parents, la directrice que les instituteurs accueillent
en collègue, la directrice dont les autorités respectent le caractère et dont tout
le monde reconnaît la distinction, cette directrice n’a plus rien à envier
comme situation morale.
Or c’est sur les directrices que nous comptons pour fonder,
en France, la véritable éducation maternelle dans l’école, en attendant l’âge d’or
où chaque enfant sera élevé par sa mère.
[1] Ami de l'enfance, organe de la méthode
française d'enseignement maternel. (Hachette.)
Cliquez sur l'image pour avoir accès à la suite de l'oeuvre sur le site Gallica :

















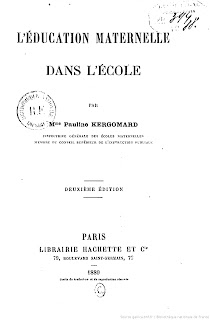
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Aidez-moi à améliorer l'article par vos remarques, critiques, suggestions... Merci beaucoup.